L’enfant ne choisit pas l’exil. Il suit ses parents d’un pays l’autre, tributaire de la décision d’émigrer que les adultes croient prendre aussi pour lui : quand tout un contexte historique, économique et social pousse à la migration, on pense aller chercher sa (mal)chance ailleurs. Il y a le voyage, puis il faut changer brutalement de monde et de vie. Cet hiver 1962, celui de l’indépendance de l’Algérie, Mehdi Charef a dix ans. Avec sa mère, son frère et sa sœur, il débarque à Paris. La famille a quitté Maghnia pour retrouver le père, ouvrier terrassier, qui l’avait précédée « chez eux, là où il n’y a qu’eux », ces Français, les colons.
 Rue des pâquerettes, le dernier livre de Mehdi Charef, est le récit de l’arrivée en France de l’auteur-réalisateur, de son enfance dans une baraque d’un bidonville à Nanterre. Les enfants immigrés portent en eux la blessure de l’arrachement au pays d’origine, qu’ils sont obligés de soigner comme ils peuvent, puisque « le retour est un mythe. On ne s’enrichit pas, quand on est ouvrier on le reste toute sa vie ». Les pères, venus en « célibataires » faire fortune en France, se résignent après quelques années à demander les autorisations pour le regroupement familial. « Certains le vivent comme une défaite, ont envoyé sans gaîté de cœur le mandat, leurs économies, à leur femme pour l’achat des billets de bateau.
Rue des pâquerettes, le dernier livre de Mehdi Charef, est le récit de l’arrivée en France de l’auteur-réalisateur, de son enfance dans une baraque d’un bidonville à Nanterre. Les enfants immigrés portent en eux la blessure de l’arrachement au pays d’origine, qu’ils sont obligés de soigner comme ils peuvent, puisque « le retour est un mythe. On ne s’enrichit pas, quand on est ouvrier on le reste toute sa vie ». Les pères, venus en « célibataires » faire fortune en France, se résignent après quelques années à demander les autorisations pour le regroupement familial. « Certains le vivent comme une défaite, ont envoyé sans gaîté de cœur le mandat, leurs économies, à leur femme pour l’achat des billets de bateau.
Ils avaient chanté qu’ils rentreraient riches. »
Le rêve de richesse est une duperie de plus : les immigrés algériens n’ont pas même obtenu un logement digne de ce pays qui a si longtemps fait du leur le sien.
L’écriture précise de Mehdi Charef, d’une justesse admirable, dresse un portrait du père à la fois aimant, tendre, mais aussi sans illusion. L’exil, pour le jeune Ahmed, son départ pour la France, a été précédé d’un premier long exil : grandir sans père alors que la guerre secoue l’Algérie. Les enfants pris dans la violence de la guerre, la bêtise cruelle des soldats français, leurs coups de crosse, les interrogatoires, les tortures et les tueries, sont terrorisés. « C’est là que mon père me manquait le plus, dans cette angoisse affreuse de cris et de larmes, de haine, de violence. Comme dans les gras et gros éclats de rire des soldats lorsque l’un d’eux ôtait violemment le foulard qui cachait les yeux de ma mère et découvrait son visage éclaboussé de boue. Elle s’était salie elle-même pour s’enlaidir, pour ne pas qu’ils l’emmènent avec eux, ils riaient et elle en rajoutait, ma si belle mère, se donnait un air idiot et se tenait de travers… Ils riaient, riaient.
Papa, tu es où ?
Il était là, ici, dans ce bidonville de Nanterre. »
On songe en lisant les lignes fortes que Mehdi Charef consacre à la période de la guerre d’indépendance, aux analyses de Karima Lazali. Dans son livre sur Le trauma colonial, la psychanalyste observe les effets profonds de la disparition du père comme référent dans l’Algérie colonisée. L’effacement des pères, à la fois symbolique et physique, opéré par les colons français avec les nombreuses exécutions pendant la conquête et le changement autoritaire des patronymes que met en œuvre l’administration coloniale tout en s’appropriant les hommes et en les dépossédant de leurs terres, se poursuit dans la guerre de libération. Au village, seules les femmes entourent les enfants, « les hommes jeunes sont au maquis ou à Nanterre. » L’émigration se lit comme la perpétuation de la disparition du père organisée par la colonialité par-delà de l’indépendance : « Quand tu es sorti de mon ventre, dit la mère à l’enfant, ton père était loin. Tu l’as senti, il t’a manqué, sa voix rauque, la voix du père pour t’accueillir. Et depuis, tu t’es mis dans le crâne que tu étais orphelin de père. […] Et tu veux te faire tout seul. »
 Le père aimé est regardé par l’enfant, de l’extérieur, telle une image vivante de l’absurdité de l’exil qui substitue une pauvreté à une pauvreté plus grande encore. Le fils admire son courage mais ne veux pas devenir un travailleur comme lui : « Jamais je ne voudrais faire le travail de mon père. Le matin, il démarre trop tôt pour qu’on ne le voie partir. […] Je le regarde se dévêtir le soir quand il rentre du chantier. Sous le bleu qu’il a ôté, il porte un caleçon gris piqué, long jusqu’aux chevilles, que ses chaussettes épaisses recouvrent. Ses mains sèches raclent leurs gerçures quand il les frotte avant de saisir avec une belle envie le verre de café chaud que ma mère a posé sur la table. »
Le père aimé est regardé par l’enfant, de l’extérieur, telle une image vivante de l’absurdité de l’exil qui substitue une pauvreté à une pauvreté plus grande encore. Le fils admire son courage mais ne veux pas devenir un travailleur comme lui : « Jamais je ne voudrais faire le travail de mon père. Le matin, il démarre trop tôt pour qu’on ne le voie partir. […] Je le regarde se dévêtir le soir quand il rentre du chantier. Sous le bleu qu’il a ôté, il porte un caleçon gris piqué, long jusqu’aux chevilles, que ses chaussettes épaisses recouvrent. Ses mains sèches raclent leurs gerçures quand il les frotte avant de saisir avec une belle envie le verre de café chaud que ma mère a posé sur la table. »
Père désemparé, piteux de montrer à sa femme et à ses enfants la pauvre cahute qui va leur tenir lieu de maison dans ce bidonville transformé en champ de boue à la première pluie, père mutique, au corps meurtri, écrasé par la lourdeur du travail, père qui a perdu le peu qu’il avait en migrant, son métier de berger, son village, le coin de reg qui porte son nom, la beauté de la montagne, et sa flûte dont il jouait comme tous les bergers. « Mes parents, nos parents n’ont pas toujours été ces gueules tristes et abîmées que l’on voit sur les photographies prises dans les années soixante devant les murs des bidonvilles de Nanterre et d’ailleurs… Ils ont été gaillards, enthousiastes, joyeux et jeunes. » L’exil les a défigurés, l’immigration, cette perpétuation de l’exploitation coloniale sur le territoire français.
La mémoire de l’enfance dans le bidonville, sans pathos, parfois mélancolique, parfois cocasse, souvent poétique, sert une critique radicale de l’exploitation postcoloniale, des rapports de domination subis par les immigrés des anciennes colonies appelés à fournir de la main d’œuvre bon marché et flexible à une France en pleine croissance économique. Mehdi Charef, alternant portraits, récits, poèmes et réflexions, met en évidence le racisme inhérent au postcolonialisme, opérant un processus de forte hiérarchisation sociale jusque dans l’intime.
La mère est à cet égard un personnage central : aimée, admirée pour sa beauté, son courage et son abnégation, elle est aussi, pour l’enfant qui voudrait se fondre dans la francité que l’immigration lui impose comme seul issue possible, un sujet de honte en public. Son habillement, le haïk qu’elle n’arrive pas à abandonner pour sortir, ses tatouages rituels, sa voix trop forte quand elle interpelle ses enfants dans la rue, sa manière traditionnelle d’emmailloter la petite sœur que lui reproche une infirmière du centre médical : la mère est un rappel des origines, qui n’est réconfort qu’en privé, à la maison et à travers les beaux souvenirs de la première enfance en Algérie malgré les drames vécus. La mère, la langue maternelle, l’oubli forcé de tout ce qui a trait à la petite enfance au pays des pères, marque profondément l’identité de celui qui doit vivre tiraillé entre deux cultures que tout oppose : « le petit berger que j’étais, l’enfant des rues de Maghnia, sans école parce que la guerre faisait rage, avec sa langue, son patois, disparaît au profit de celle du colon dont avant il se détournait. » Pour ne pas sombrer dans la folie, produit des doubles contraintes et des conflits de loyauté, le bouleversement identitaire passe par l’effacement de la première identité vécue comme un stigmate : « Intègre-toi ou crève ! »
« Aux Pâquerettes, à l’école, je me sens épié, regardé. Parce que je ne suis pas d’ici, je me sens dégingandé, tout le temps bancal. » L’instituteur de la « classe de rattrapage », assez semblable aux maîtres coloniaux, chargé d’apprendre à lire et à écrire aux enfants immigrés avant qu’ils soient envoyés à l’usine, n’est pas dénué d’un évident racisme malgré l’amour de la littérature et le goût de l’écriture qu’il décèle et encourage chez le jeune Charef. Déçu du manque de réaction des élèves à la lecture d’Alexandre Dumas, il lance : « – Vous êtes d’un milieu ou les mousquetaires, c’est pas votre tasse de thé…
En me regardant, il a dit, content de lui.
– Ni de thé à la menthe ! »
Le petit Sid Ahmed, comme le prénomme sa mère, n’est pas arrivé en France sous les pingres auspices du regroupement familial pour devenir un intellectuel et un artiste : « au fond de lui, [l’enfant immigré] sait qu’on l’a autorisé à rejoindre son père en un exil lointain pour, plus tard, prendre le même chemin que lui. Pourtant, il est différent : le père est docile, secret, l’enfant a la rage, la haine… Il porte en lui que ce n’est ni l’admiration, ni la reconnaissance de l’effort du père qui a conduit à regrouper sa famille. Il y a de la besogne, d’immenses chantiers…
On sera du bétail comme nos pères, mais avec un cartable sur le dos. »
Seule perspective d’ascension sociale pour les meilleurs élèves : le travail à l’usine plutôt que dans les travaux publics, la chaîne à la place du marteau-piqueur. Ce destin déterminé, que la France réserve aux immigrés de ses anciennes colonies, il est impossible de s’en extraire tout à fait : « Et je resterai toujours l’indigène de quelqu’un, parce que toute sa vie le colonisé garde le colon dans sa tête. »
Rue des Pâquerettes dresse un portrait du bidonville de Nanterre, tel un personnage à part entière, avec sa vie propre, ses habitants diversement souffrants, de l’exil, de la pauvreté, de la solitude, de la vieillesse et de la folie, avec sa solidarité et ses bonheurs fugaces. Entre les pauvres baraques, parmi ceux qui l’aiment, l’enfant grandit avec les mots qu’il découvre, avide d’en apprendre de nouveaux et de manier parfaitement la langue qui lui permet de dire qui il est : cette « pépite » que le père cherche dans les tranchées qu’il creuse, au plus profond.

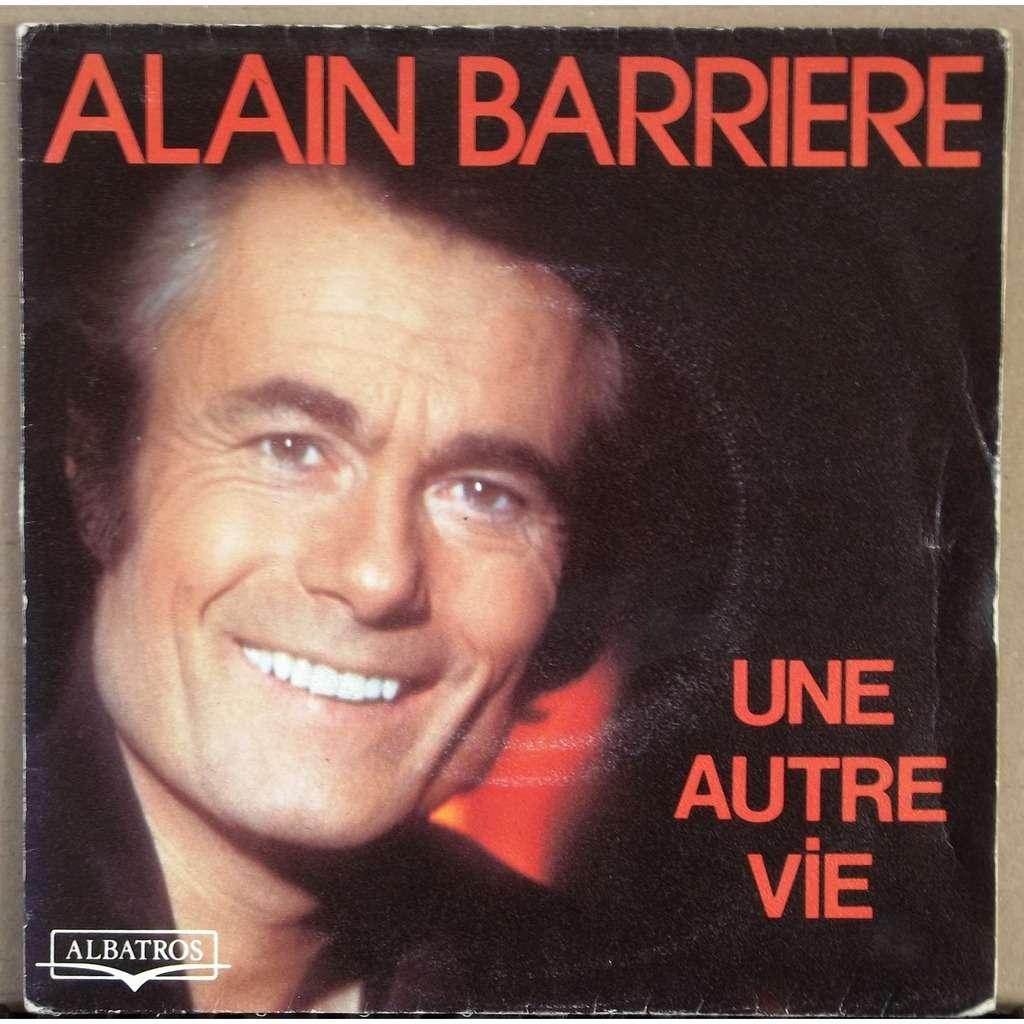

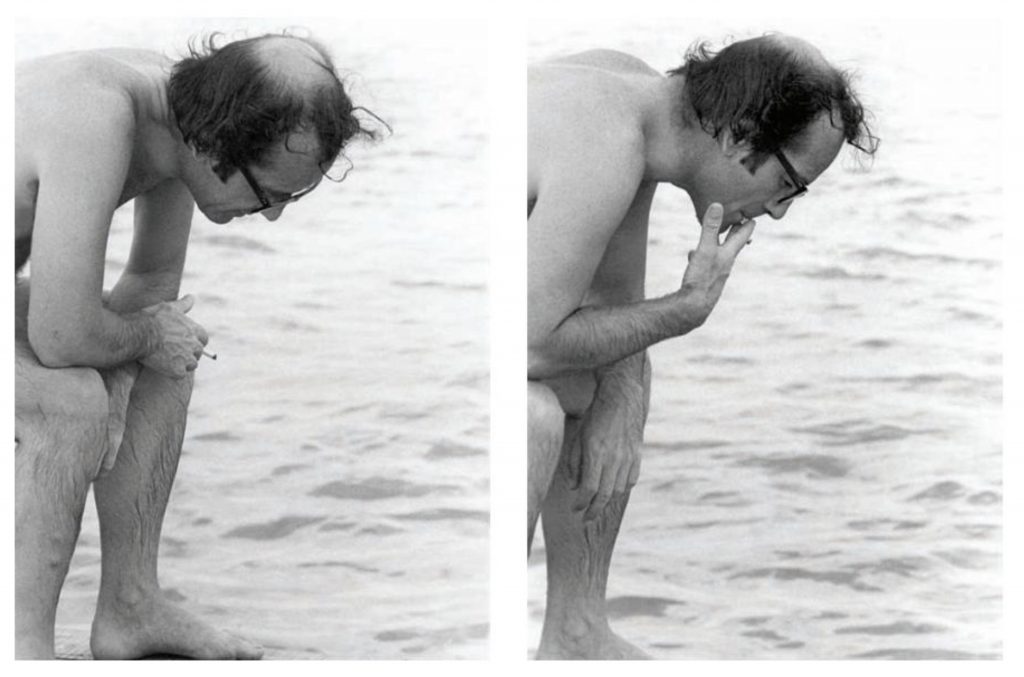

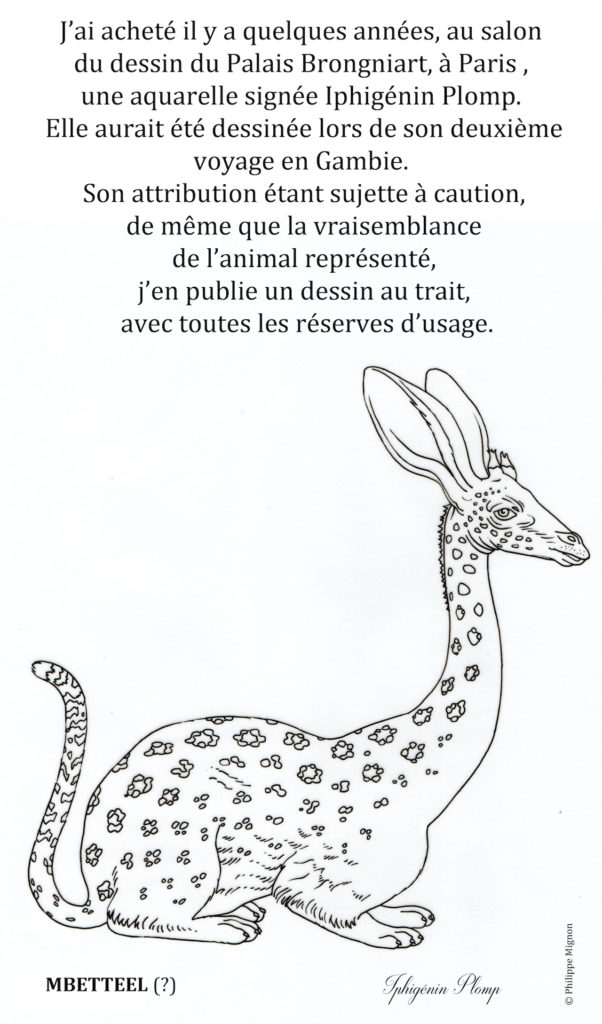
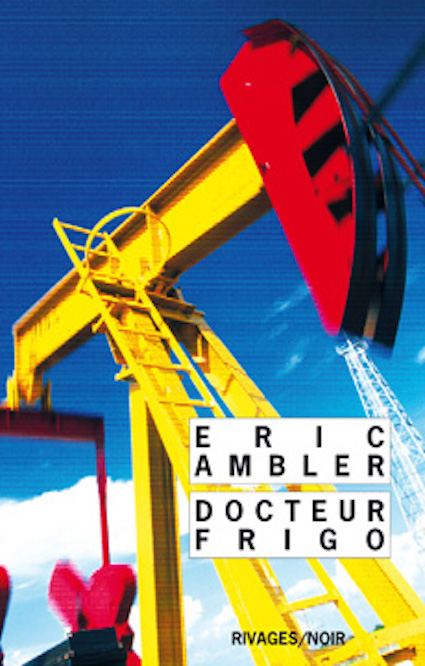


0 commentaires