Quel rapport entre Dale Carnegie, auteur de Comment se faire des amis (1936), et le Diderot du Paradoxe sur le comédien (1769)? Cette idée: la sincérité, ça se travaille, ça se feint, ça se perfectionne, jusqu’à ce que son interlocuteur ou spectateur ne puisse plus distinguer le masque du visage.
À la même époque que Carnegie, une journaliste, Dorothy Dix, distillait à ses lecteurs (surtout des lectrices) les conseils de bonheur d’une nouvelle religion séculière, le positive thinking. Décide d’être heureux. Si tu ne l’es pas, fais comme si, tu le seras bientôt. Ne te prends pas trop au sérieux… une théorie de maximes qu’elle allait plus tard réunir dans Ten Dictates for Happiness. D’où l’étrange titre de cette pièce, avec son dix au carré: Les dix commandements de Dorothy Dix.
Son autrice, Stéphanie Jasmin, s’est souvenue que sa grand-mère s’était nourrie des conseils de Dix, comme des millions d’autres ménagères états-uniennes dans les années 1930-1940. Une femme heureuse, cette aïeule, qui « règne comme une reine sur son troupeau d’enfants », quoiqu’à y regarder de plus près… « une reine qui a dit en mourant à ses petites-filles de sourire, toujours sourire »… Qu’y a-t-il derrière cet immuable sourire? Une fillette éteinte au pensionnat, mariée trop jeune à un homme trop empressé (« j’ai été trop désirée pour avoir connu pour mon propre désir »), une femme qui voulait écrire, aller au théâtre, à l’opéra, mais s’est trouvée ensevelie sous les tâches ménagères puis happée par les soins à apporter à son mari diminué. « Dire qu’il aurait pu y avoir une autre histoire… »
Dans un beau monologue en dix séquences, Stéphanie Jasmin explore l’autre côté du miroir, fait entendre « une voix plus sombre et profonde », celle d’une femme « qui déroule le film de sa vie comme un trop-plein qui déferle, en désordre et en un souffle ». Cette femme sans nom a cent ans et se maquille pour se rendre (plus agréable à regarder ». Elle a vingt ans et se pavane en fourrure sur un catwalk minable. Soixante-dix, elle reprend son violon mais l’archet tremble sur les cordes, il est trop tard, elle le range, « il ne faut pas cultiver le ressentiment ». Ainsi glisse la mémoire, par dizaines d’années rondes. Dix au cube.
Julie Le Breton, seule en scène, porte le texte avec maestria. Elle croyait, comme nous, que le théâtre, ça commençait quand on était au moins deux. Il fallait la rencontrer pour revenir sur cette croyance commune, peut-être erronée. Et parler du théâtre tel qu’il se vit et se pratique au Québec.
Vous êtes québécoise, tout comme Stéphanie Jasmin, l’autrice et scénographe, et Denis Marleau, le metteur en scène. Wajdi Mouawad, patron de la Colline, où vous jouez, c’est une vieille connaissance, du temps de ses années passées au Canada?
Oui. Stéphanie Jasmin et Denis Marleau ont tissé des liens forts avec Wajdi quand il vivait à Montréal. Stéphanie Jasmin prépare d’ailleurs la dramaturgie de son prochain spectacle à La Colline, Racine carrée du verbe être [du 30 septembre au 30 décembre 2022]. Mais l’invitation n’a pas été lancée à l’aveugle: Wajdi a eu un coup de cœur pour Les dix commandements de Dorothy Dix. Stéphanie Jasmin m’a contactée, je lui ai avoué que je n’étais pas a priori intéressée par les solos: pour moi, le théâtre est un acte grégaire, de communauté. Et puis j’ai lu le texte, qui donne de façon inédite accès à l’esprit d’une femme qui dit des choses qu’on peut trouver violentes ou moches. Elle est arrivée tard, la possibilité, dans les écritures féminines, d’aller dans des zones pas jolies, peu acceptables.
À travers le personnage principal, qui n’a pas de nom mais est inspiré par la grand-mère de Stéphanie Jasmin, j’ai retrouvé ma propre grand-mère, des échos de ma mère et de moi aussi qui comme actrice suis toujours confrontée à ma propre mise en image. J’ai quarante-six ans, je suis au mitan de ma vie si je suis chanceuse. J’ai trouvé intéressant de plonger dans les vies d’une femme et de voyager d’un âge à l’autre [de dix à cent ans]. J’ai donc fini par dire oui, avec la peur au ventre…
Il y a un air de famille entre Dorothy Dix et Dale Carnegie, l’homme qui vous apprenait à vous faire des amis. C’est un peu la même idéologie, qui apparaît à la suite de la Grande Dépression et s’épanouira dans le business du développement personnel, toujours florissant: pensez positivement, soyez responsable de votre bonheur, fuyez l’oisiveté. Comment, au Québec, cette façon de penser résonne-t-elle?
Ma grand mère disait que les dépressions étaient arrivées en même temps que les lave-vaisselles: l’injonction « keep busy » prenait du plomb dans l’aile… Au Québec, on est tiraillé entre cette américanité et notre culture européenne, longtemps lestée par un catholicisme traditionaliste. Mais la psychopop’, les thérapies du bien-être sont venues contester ces impératifs d’encaisser, de ravaler ce qu’on ressent. Avec un regard moderne, on se dit: quelle violence envers soi-même!
On est frappé par cette voix caverneuse et lente que vous adoptez au tout début de la pièce, quand votre personnage a cent ans. Il y a un petit effet L’Exorciste.
On a beaucoup évoqué le nô en cours de travail. Il est présent d’emblée avec ces toiles-parchemins qui se déroulent en fond et flancs de scène, comme des écrans sur lesquels sont projetées des images de mer. Ce début, c’est un peu du nô: un fantôme vient se déposer et raconter. C’est une voix qui revient parmi les vivants, dans la pénombre. Cela paraissait contre-intuitif de commencer dans la sourdeur et la lenteur, mais non: on installe une théâtralité, voici une femme assise derrière un rocher abstrait qui refait son maquillage: « chaque fois que je mets la crème sur mon visage, je pense à ces actrices devant le miroir encadré de lumières rondes et blanches qui se démaquillent après le spectacle, chaque fois je me dis que j’étais Phèdre ou Médée ou une impératrice ou une courtisane ou… »
En lisant le texte de scène après la représentation, on est surpris par l’aspect fluide de cette prose: pas de paragraphes, pas de points d’arrêt; c’est tout en virgules, vagues, souvenirs dérivants… Votre montage, lui, est scandé de temps forts et faibles, de mouvements vifs et lents.
J’ai réalisé un travail très technique et pointu qui s’est fait sur le souffle. Un travail ardu pour moi qui suis une actrice qui découpe, très « rythmée ». Là, il fallait créer de souplesse et de la rondeur dans le dire. À partir du travail sur la voix s’est construit le travail du rythme. Denis Marleau a une oreille très musicale, on parlait beaucoup d’accélérations, de glissando…
Il a de la nostalgie et de la déploration dans le texte, mais aussi de la drôlerie. Notamment ce passage où la femme raconte comme sa minuscule cuisine s’est trouvée envahie de poches de carottes. Son mari a frôlé un accident cardiaque, il réclame désormais du jus de carottes matin, midi et soir, pour vivre jusqu’à cent ans.
Ce registre comique est en effet souvent lié au personnage du mari. Le genre de mari qui prend toute la place et fait tout le temps les mêmes blagues. On les connaît, ces hommes-là, qui ont fait de l’ombre à leur femme qui avait peut-être plus d’intelligence et de profondeur qu’eux… C’est vrai, il y a des pointes assez drôles comme: « il a perdu la mémoire et tout oublié, sauf ses blagues ». D’autres terribles, comme lorsque cette femme dit, à propos de son mariage: « je n’aurais pas pensé à une autre fin comme début de ma vie ».
Existe-t-il au Québec une césure semblable à la française entre théâtre public et théâtre privé?
Cette séparation n’existe pas… parce que le théâtre privé est presque inexistant, il n’est pas rentable, nous ne sommes pas assez nombreux… Ce qui pourrait s’apparenter au théâtre privé, c’est le théâtre d’été – des comédies légères pour des gens en villégiature, comme Le dîner de cons qui roule depuis quatre ans… Tous les théâtres sont subventionnés. Mais la cagnotte est plus petite qu’en France et partagée entre de nombreux théâtres. Les théâtres recourent donc au mécénat, lancent des levées de fonds auprès des entreprises…
Vous aurez joué pendant trois semaines au Théâtre national de La Colline, ce qui est plutôt une bonne durée, qui laisse sa chance au bouche à oreille. En France, un récent rapport de la Cour des comptes rappelle que si les aides à la création et à la production théâtrales sont satisfaisantes, les spectacles tournent peu ou mal. En 2019, moins de trois représentations en moyenne dans les Centres dramatiques nationaux, à peine deux sur les scènes nationales! Quelle est la situation au Québec?
Dans les théâtres hautement subventionnés, il y a quatre, cinq, parfois six semaines de représentation. Dans certains espaces qui, comme le Théâtre La Chapelle de Montréal, ne produisent pas de spectacles mais les accueillent, on compte trois à quatre représentations seulement – reste l’espoir qu’ils soient repris dans un théâtre institutionnalisé.
Y a-t-il des théâtres qui comme celui des Amandiers, à Nanterre, mettent l’accent sur les auteurs contemporains?
Présentement, il n’y a quasiment que de la création de pièces contemporaines, même dans les théâtres qui comme Jean-Duceppe, à Montréal, s’étaient spécialisés dans la dramaturgie américaine. En l’espace de dix à quinze ans, on est passé d’une place mineure accordée aux auteurs contemporains, à une place dominante.
C’est formidable! Il faut importer votre système!
C’est bien, mais il faut aussi qu’on puisse voir des choses qui viennent d’ailleurs, comme dans le festival TransAmériques, qui apporte un mouvement et une effervescence salutaires.
En fait, on se trouve à l’adolescence d’un mouvement: les premiers auteurs qui ont écrit en langue québécoise, dont Michel Tremblay, c’était dans les années soixante, autant dire hier…
En langue québécoise?
Pagnol, c’est un français standard? Michel Tremblay a écrit dans un français qu’on appelle le joual. La langue québécoise est très riche et de plus en plus décomplexée, elle qui a longtemps maintenu un rapport de colonisé par rapport à la France. Dans nos librairies, les livres sont classés en trois sections: québécois, français, étranger.
Propos recueillis par JB Corteggiani






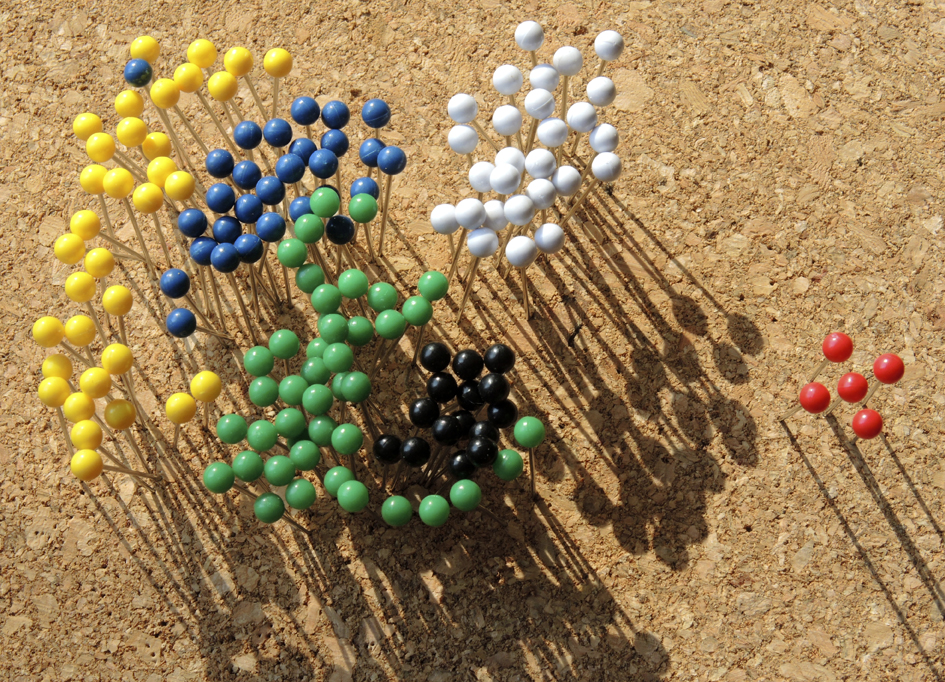



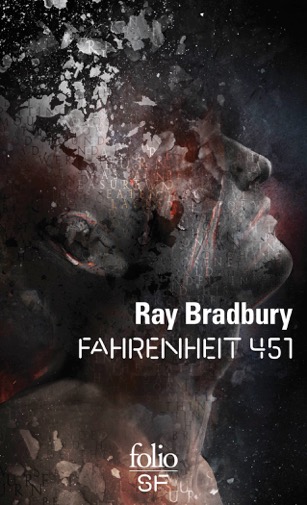
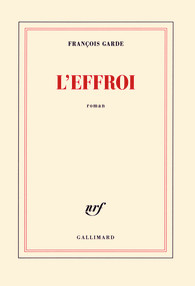

0 commentaires