
Les personnages d’Avery, comme ceux des autres dessins animés, possèdent cette merveilleuse plasticité qui assure leur survie, même après s’être fait aplatir ou enfoncer dans le sol. Mais chez Avery, on peut aussi se fragmenter, clignoter, s’effriter. Plus précisément, chaque partie du corps acquiert son autonomie, reprend sa liberté. En opposition catégorique avec la notion d’“individu”, le corps avéryen est décidément du genre “dividu”.
Un simple coup de marteau suffit à montrer que, loin d’être un assemblage visqueux de choses molles, le corps avéryen est un béton (mal) armé mais bien structuré en couches concentriques se fragmentant l’une après l’autre. Résultat, un personnage furieux réduit à sa plus simple expression, au milieu d’un tas de gravats :
Cette réduction couche par couche, inversée, rappelle la vieille théorie biologique de la “préformation” (Nicolaas Hartsoeker, 1674), selon laquelle l’être vivant se trouve en miniature, mais déjà parfaitement constitué, dans les spermatozoïdes, puis croît dans l’utérus par ajout de couches successives. Hartsoeker fut le premier à observer ces étranges bestioles à flagelle, au microscope inventé par son collègue Antonie van Leeuwenhoek, et à ressusciter ainsi l’“homonculus” des anciens alchimistes, que l’on trouvait encore chez Paracelse en 1537. Ce pourrait être un hasard, si les références à l’histoire des idées ne pullulaient chez Tex Avery.
D’une certaine façon, dans la séquence ci-dessus, la morale est sauve puisque l’individu subsiste. Mais un grand tabou du dessin animé, la mort, est sévèrement transgressé. On tue pour de vrai, chez Avery, avec de vraies armes comme au Texas, mais on tue proprement : les balles font des trous parfaitement nets, façon “ligne claire” à la Hergé, et si les explosions noircissent un peu, tout au plus, les dents tombent pour de bon. Et le spectateur a intérêt à se méfier : il peut lui-même être victime, comme on l’a vu, d’une métalepse fatale.
À la mort violente, Avery préfère cependant l’émotion pure, dont les effets sont bien plus spectaculaires. Quand invariablement, au terme d’une évasion haletante, le loup (re)tombe sur Droopy, il subit des modifications passionnantes. Sa tête part comme une fusée, puis se retrouve à l’intérieur du corps, avant que le corps entier subisse une impressionnante fragmentation, qui illustre bien l’expression “numéroter ses abattis” :
Variante plus soft : seules certaines parties du corps se déforment. Ici, les yeux subissent une extension (“Je n’en crois pas mes yeux… Allons voir ça de plus près”). Mais les yeux sont chez Avery un organe bien particulier répondant à des sollicitations très diverses :
L’angoisse, la peur, le désir, trouvent ainsi des traductions graphiques qui pourraient sembler simplistes et loufoques, mais qui ne le sont nullement. De fait, elles ont une justification neurologique bien précise. Le Canadien Wilder Penfield (1891-1976), en stimulant avec des électrodes telle ou telle zone du cerveau, a dressé une carte du cortex où apparaissent les zones dédiées aux mouvements et aux sensations.
Cela peut aussi se représenter sous la forme d’un “homoncule de Penfield” (deuxième résurgence du terme dans l’histoire de la biologie), dont les parties du corps sont proportionnelles à la surface corticale qu’elles mobilisent. Les mains et le visage (lèvres et langue) occupent une place considérable.

L’homoncule sensoriel d’Avery, qui apparaît lorsqu’un personnage est soumis à une forte émotion, procède d’une analyse analogue. La bouche et la langue sont très penfieldiennes, mais les yeux — faut-il s’en étonner de la part d’un dessinateur et cinéaste ? — prennent une importance toute particulière :
Il est difficile de ne pas voir dans l’homoncule de Penfield un bébé sur le point de téter. Ces questions de plasticité du corps et de cohésion de ses parties (le bébé tripote abondamment tout ce qui l’entoure et “prend son pied” pour vérifier que c’est bien le sien) sont évidemment les premières auxquelles nous avons tous été confrontés. Profondément imprimées dans nos méninges, elles sont une précieuse source comique. On peut même se demander si le gag lui-même, dont l’archétype “peau de banane” annule d’un coup la gravité, n’est pas une réminiscence de cette première expérience hilarante de l’apesanteur qui consiste à faire mine de lancer un bébé en l’air, pour le rattraper aussitôt, explosé de rire. En somme, bien des ressorts du rire remontent à la prime enfance, mais pourquoi s’arrêter là ? D’autres se trouvent dans les certitudes bien ancrées transmises par nos ancêtres. Et plus elles sont anciennes, plus leur effet comique est décisif : rire, c’est remonter le temps !

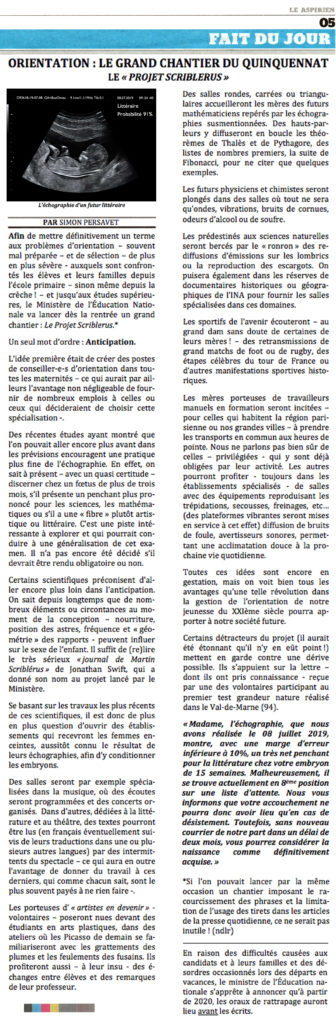







0 commentaires