Un marcheur à New York. Journal d’exploration urbaine (hiver 2016-2017)
Dernière journée de marche à New York, avec une longue balade jusqu’à la 79e rue en face de Central Park, sur la 5e avenue, où se tient la librairie Albertine, à l’intérieur du consulat de France, puis retour. Soit, deux fois, une cinquantaine de blocs dans la rue, et une vingtaine dans le parc. C’était beau car la neige, qui a désormais fondu dans la ville, salée, dispersée par les pas, les chasse-neige, les pelles, et réchauffées par l’activité urbaine, est restée dans le grand parc, préservant ainsi un peu de sa sauvagerie. Les allées étaient blanches dans la nuit éclairée par les élégants lampadaires très « Paris XIXe siècle ».
Peu de monde dans le parc, avec un temps qui reste clair et merveilleux, cependant éprouvant. D’autant que je ne suis pas absolument habillé pour cela, trop parisien. Mais bon, j’assume et j’aime mieux avoir un peu froid plutôt que d’enfiler « leurs » vestes du Grand Nord canadien. Je ne me vois pas marcher avec une « canadienne » dans une ville ; mon urbanité ne s’y résoudrait pas. Ici, dès que le thermomètre passe sous le 0, on enfile sur le dos de véritables monstres à pelisses. Seul dans le parc, à l’aller comme au retour, mon esprit divaguait vers… Paris, au gré des montées et des descentes, des chemins de neige qui longeaient un lac, une clairière, une futaie, un rocher.
Au retour, je retrouve la foule de la 5e avenue, concentrée, vivante, marchant vers je ne sais quel travail, vers je ne sais quel plaisir. Mais ma marche est entravée par la fatigue pédestre. En effet, en me baladant ainsi depuis quelques jours, j’ai été rattrapé par le mal des pieds marcheurs des grands villes froides du nord, des marcheurs peu équipés contre le froid : la gerçure ! Une petite gerçure profonde s’est glissée sous mon gros orteil du pied gauche. C’est assez douloureux, mais il n’y a rien à faire : il faut marcher dessus. Je repars donc en claudiquant : je sens la gerçure et ça pique.
Je ne sais pas si c’est lié à ma démarche plus lente et mal assurée que d’habitude, mais aujourd’hui, ce dernier jour, j’ai remarqué quelques vieux dans les rues de Manhattan. C’est la première fois, car ils sont rares. Peut-être parce que je marchais à leur rythme, avec une part de leur difficulté. New York n’est évidemment pas une ville faite pour eux : trop dure physiquement, avec des écarts thermiques violents, un rythme rapide, une idéologie individualiste très forte, des règles de marche et de circulation mais aussi beaucoup de zones et de moments out of law, qui rendent les déplacements urbains quasi impossibles pour des vieux, des vrais vieux, le grand âge.
Généralement, quand ils sortent, il le font en couple, serrés l’un contre l’autre, s’attendant, se protégeant, solidaires ; c’est assez beau ces deux corps attentifs et craintifs, se déplaçant liés en s’entraidant dans une ville hostile. Le plus difficile pour eux est la traversée des avenues, qui sont larges et pour lesquelles environ une grosse vingtaine de secondes est autorisée. Les voitures sont sans pitié, klaxonnant avec lourdeur tout ce qui traîne sur la chaussée, donc, parfois, des petits vieux qui ne peuvent pas aller plus vite. C’est le seul moment où j’ai pu remarquer une révolte solidaire des piétons contre les voitures, qui restent reines à New York. Des gens attendent les vieux pour les faire traverser et hurlent contre les voitures pressées et aveugles à la condition éphémère des ancêtres piétons.
Puis, on les retrouve dans les cafés, où ils sont plus à l’aise, avec leurs habitudes presque enfantines. Alors, dans ce confort, ils peuvent désormais se séparer : lui lit un journal, elle lit un livre ; lui se concentre sur ce qu’il mange, elle sur son portable, avec lequel elle joue à des jeux vidéos d’adolescents ; ou ils attendent ensemble, le nez en l’air, échangeant parfois quelques mots, pensant à leur vie passée de New-Yorkais et au chemin qu’il va falloir endurer pour le retour à la maison…
Il y a très peu de vieux dans les rues de Manhattan, ville jeune, ville active, ville dure, mais les quelques-uns qu’on y croise portent sur leurs épaules beaucoup de la ville, une ville que ne leur rend pas grand-chose de ce qu’elle leur doit, avec une grande injustice et une certaine violence dédaigneuse, la violence de la loi de la jungle… J’achève ce journal urbain avec ces vieux, avec lesquels je me sens solidaire. À New York, les vieux n’ont plus leur place ; moi, je ne me suis jamais senti ici à ma place. Mais c’est justement depuis cet « ailleurs » que j’ai pu tenter de traverser et d’observer cette ville.
Je reviens de New York en sauvage, avec ma longue barbe de trappeur, de retour de sa chasse saisonnière dans le Grand Nord, avec son ballot de peaux de loutres et de castors sur le dos ! (Pour moi ce sont des textes : deux livres que j’ai finis ici, et une demi-douzaine de textes écrits, environ un million de signes). Ce soir, je me couche un peu plus tôt. Et là, dans la nuit, un énorme écureuil passe sur une branche, à trois mètres de ma fenêtre, et, dans la lumière, me regarde.
Antoine de Baecque
Degré zéro
[print_link]




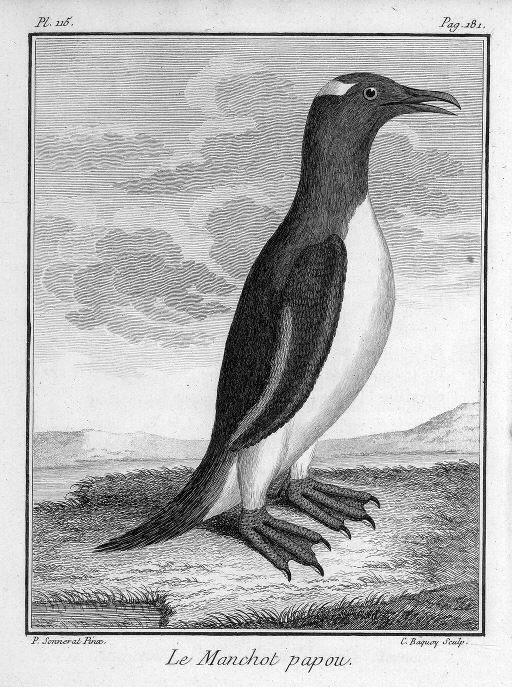



0 commentaires