De la joie, aussi. Pas celle, insouciante, que l’on éprouve aux bonheurs quotidiens. Mais la joie d’amour, qui envahit les êtres quand leur vient la satisfaction profonde d’avoir fait ce qui était leur devoir face à l’autre, face à l’humanité. Si le religieux relie les hommes, les femmes, il y a du religieux et pas seulement sous la forme du rite funéraire que l’on doit au fils, au cousin, au frère mort d’avoir entrepris de passer une frontière fermée. L’empêchement de circuler librement, de voyager en sécurité, de passer la frontière, est politique.
Entre la France et l’Espagne, il y a ce fleuve européen, nommé la Bidassoa, dont l’étymologie nous dit qu’il pourrait venir du mot basque pour chemin. «La Bidassoa sépare Irun d’Hendaye. Trois ponts relient les deux villes. Pourtant, comme à d’autres époques, les époques de guerre, de dictature, des époques d’avant la construction européenne, les voyageurs prennent la montagne, le fleuve ou suivent les voix ferrées. En un an et quelques mois, il y aura dix morts. Neuf attestés, neuf corps, et un disparu.» Marie Cosnay vit au Pays basque, sur cette frontière liquide qu’on passe par le pont, ou pas si l’on fait partie de ceux et celles qu’illégalisent les politiques migratoires européennes, fermant le chemin à certains étrangers, certaines étrangères.
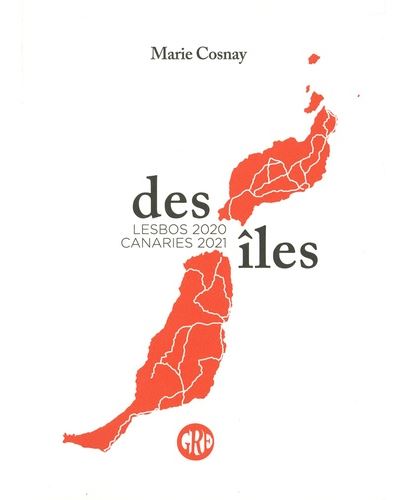 Îles des faisans 2021-2022, est après Lesbos 2020 – Canaries 2021, le deuxième volume de la série Des îles que Marie Cosnay consacre à celles et ceux fuyant leur pays, porté·e·s par l’espoir d’une autre vie, qui disparaissent par milliers au cours de leur voyage, aux proches séparé·e·s par les aléas des tentatives de traversées, mers, déserts, frontières. Agir et écrire, indissociablement mêlés, tant écrire c’est agir encore.
Îles des faisans 2021-2022, est après Lesbos 2020 – Canaries 2021, le deuxième volume de la série Des îles que Marie Cosnay consacre à celles et ceux fuyant leur pays, porté·e·s par l’espoir d’une autre vie, qui disparaissent par milliers au cours de leur voyage, aux proches séparé·e·s par les aléas des tentatives de traversées, mers, déserts, frontières. Agir et écrire, indissociablement mêlés, tant écrire c’est agir encore.
Agir, nommer le jeune homme noyé dans la Bidassoa, contacter sa famille, se perdre des mois dans le dédale administratif global, France, Maroc et l’ouest de l’Afrique, obtenir le permis de rapatriement, le permis d’inhumer. Agir, relier l’enfant isolé·e dans un camp des Canaries, à sa mère en France, à son père, pendant des mois s’acharner à surmonter les aberrations administratives, obtenir le regroupement familial. Marie Cosnay n’agit pas seule, mais combien sont-elles, ces personnes impliquées ? Très peu, « une poignée de volontaires ».
Des Îles II, Îles des faisans 2021-2022, est composé de courts chapitres intitulés du prénom, du nom, de l’enfant bloqué en Espagne, du mineur isolé homonyme d’un autre, des jeunes hommes décédés dans la Bidassoa, sur les rails d’un train aveugle, du rescapé autour de qui s’active le petit groupe de volontaires : Souleyman, Fatou, Yaya Karamoko, Sory, Abdoulaye Koulibaly, Seydou, Mohamed Saoud, Sohaïbou Billa, N’Diaye Seck. Quelques noms parmi les milliers de disparu·e·s, d’éparpillé·e·s, de retenu·e·s dans des camps.
«On cherche des gens, c’est devenu une habitude. Quand le corps est sorti de l’eau, on cherche un nom. Puis une famille. Plutôt que des histoires, des traces, n’importe lesquelles.»
Les histoires des hommes et des femmes qui voyagent sont leurs biens propres, que Marie Cosnay délivre prudemment par bribes, convaincue qu’elles leur appartiennent. Elle rapporte des discours, ceux des rescapé·e·s, des proches qui sont resté·e·s là-bas ou arrivé·e·s ici, des témoins: «Quant à mon petit frère disparu, sur lui aussi il y a eu des témoignages. On a raconté qu’il avait beaucoup pleuré avant de s’acheminer vers le bord de l’eau. Il avait beaucoup pleuré et ce n’était pas dans ses habitudes. Ils partaient vers le bord de l’eau et mon petit frère pleurait. Mon demi-frère a dit au coxeur que mon petit frère était un peu malade mentalement, voilà pourquoi il pleurait, même si ce n’était pas dans ses habitudes. Le coxeur l’a fait descendre de voiture. L’a confié à des gens qui retournaient en ville. L’ont-ils laissé quelque part sur la route, lui qui n’était pas capable de s’identifier ?»
Dans les histoires de ces hommes, de ces femmes, de ces familles, Marie Cosnay entre pour un temps, elle les porte «à égalité». Des Îles, est une réflexion essentielle sur ce que signifient le mot frère, le mot sœur.
Les histoires croisées que ce livre raconte, et qui tiennent les lecteurs en alerte jusqu’au bout, sont celles que l’on dirait kafkaïennes si ce n’était un lieu commun. Mais c’est cela, le lieu commun aux individus sur toute la planète, ces entrelacs de lois, de règlements, qui se superposent, se neutralisent, se compliquent de corruption, de mauvaise volonté, d’embarras diplomatiques, de conflits politiques et de malentendus. Ces piles de documents, ces dossiers, ces mille papiers des sans papier comme des régularisés, ces abstractions bien concrètes qui blessent, tuent, rendent fous, ces problèmes administratifs dont la résolution comporte sa part plus ou moins lourde d’arbitraire, c’est l’humaine condition dans un monde où il est interdit à certains, à certaines, de librement circuler, et qui ne cessent pas de le faire parce qu’il n’est d’autre choix que le voyage.
Joie quand un fils va pouvoir enfin être dignement enterré. Bonheur intense des retrouvailles d’une mère séparée tant d’années de sa fille. Soulagement quand agir impose l’ordre humain, par-delà les frontières et malgré le chaos politique qui fait du simple passage d’un pont une entreprise pleine de dangers : «La police est sur le trottoir de droite. Nous prenons des photos sur le trottoir de gauche, essayons la trottinette, pas trop vite, nous nous arrêtons pour boire. Djeneba me souffle de ne pas trembler et nous rions. Si visibles que pas tant que ça. Dans le doute, nous ne sommes pas contrôlées. Fin du pont, plus que quelques pas. Djeneba, je ne sais pas, mais moi j’exulte. On est en France, rien n’est gagné, se presser à présent, le commissariat est en face, on oblique, on rejoint la voiture, on se débarrasse des accessoires, trottinette, casque, genouillères, on plie la poussette direction la France, on est en France, je suis une Parisienne dit Fatou, une princesse parisienne. L’océan est à notre droite. Le même que celui de la Côte d’Ivoire. Il se déchaîne, il est gris sous un ciel blanc.»
Des Îles de Marie Cosnay n’ont rien d’une fiction. On le voudrait tellement, replier ces récits de vies brisées dans le genre dystopique, on se plaît à y retrouver d’indéniables échos mythologiques. Mais c’est la réalité qui est ici écrite, avec précision, concision, gravité malgré l’humour qui perce l’obscurité de notre époque, avec l’amour pour fil d’Ariane. La littérature ne doit pas seulement s’engager et témoigner du réel, elle questionne notre raison d’exister parmi les autres, avec les autres. Lire Marie Cosnay, quand nous nous sentons impuissant·e·s à empêcher ces disparitions, c’est reprendre courage, chercher dans notre humanité la force d’encore et toujours les dénoncer. Puiser à l’océan «qui nous sépare, qui nous réunit» dans la beauté de ce texte.



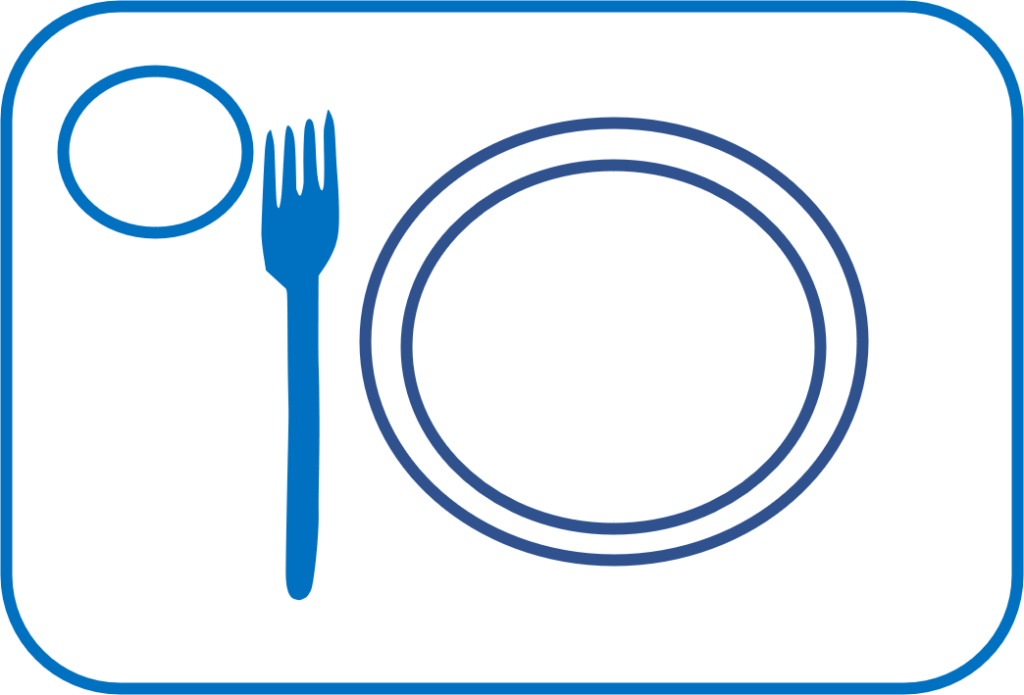





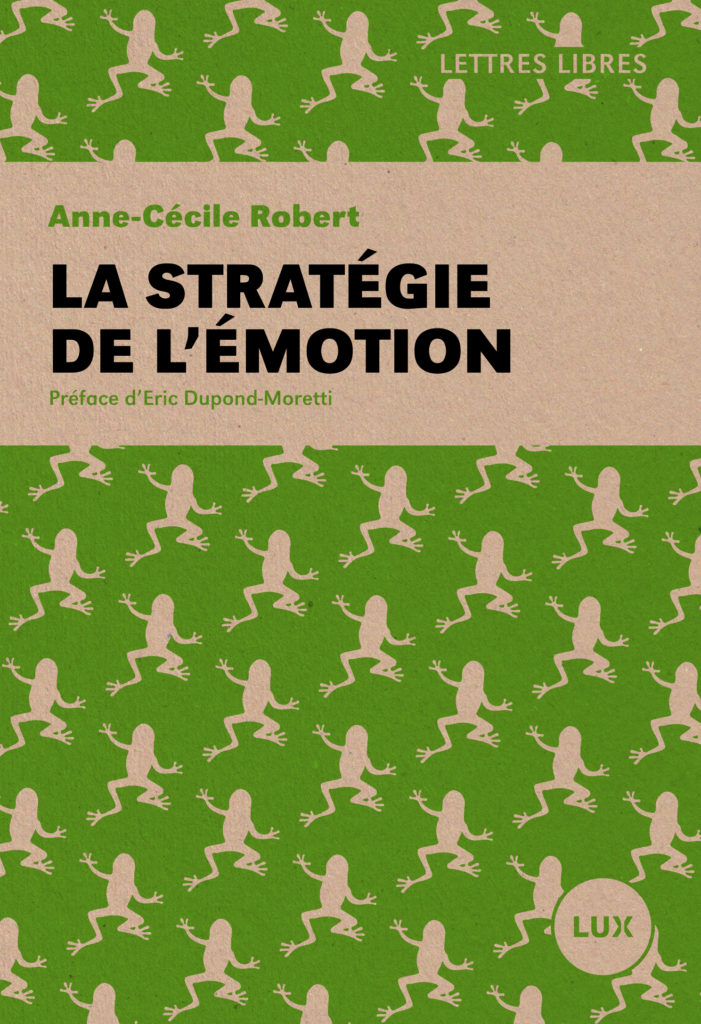
0 commentaires