Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
La récente et énième fusillade qui s’est produite le 18 mai dernier dans une école du Texas, à Santa Fe, me conduit à m’interroger sur ce que Nietzche appelle « l’avenir de nos établissements d’enseignements » (cycle de cinq conférences données à Bâle en 1872).
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, peut-être faut-il rappeler Elephant (2003), l’extraordinaire film de Gus Van Sant où le réalisateur met en scène la tuerie de Columbine. En 1999, deux adolescents décidaient sans raison de tuer le plus de monde possible au sein de leur école. Gus van Sant filme le parcours mortifère de ces garçons avec une froideur qui interdit tout pathos et qui refuse toute explication. Le film retrouve ainsi la leçon des tragiques grecs qui est celle de la nécessité. La fusillade, pour incompréhensible qu’elle soit, apparaît peu à peu, à mesure que progresse l’action, comme inévitable. Le film est glaçant, les plans sont géométriques, l’effet produit sur le spectateur est de l’ordre de la stupéfaction.
Nous avons encore la chance, en Europe, de ne pas connaître ce genre de massacres réguliers, peut-être parce que la vente des armes à feu est strictement contrôlée chez nous, peut-être aussi parce que notre jeunesse n’a pas encore atteint ce degré de désespoir ou plutôt de nihilisme qui semble caractériser certains adolescents américains.
Pourtant les choses sont loin d’être idylliques dans nos écoles. Les collèges connaissent une violence récurrente (racket, agressions verbales et physiques, harcèlement moral ou sexuel, etc.). Dans nos lycées, on voit parfois des gangs armés de barre de fer pénétrer dans l’enceinte de l’établissement afin d’y semer la panique. Certains élèves y mettent aussi le feu.
La violence de la société s’immisce peu à peu dans nos écoles qui ne sont plus des sanctuaires, pas davantage du reste que nos universités où la police entre désormais de façon régulière sans susciter d’indignation excessive (sauf bien sûr de la part des étudiants qui se font déloger manu militari). Collèges, lycées, universités sont devenus des endroits comme les autres. Une école n’est pas plus à l’abri de la violence qu’une salle de spectacle par exemple ou qu’un supermarché.
Et c’est peut-être là le début du problème. Nos établissements d’enseignement ne sont plus considérés, depuis des décennies, comme des havres de paix destinés à l’éducation. Beaucoup dénoncent sur ce sujet ce qu’il est convenu d’appeler la marchandisation du savoir. Et de fait certains de nos élèves ont à l’égard des cours une attitude de consommateur, une attitude à la fois très passive (ils attendent qu’on les serve) mais aussi parfois très agressives : ils n’hésitent pas à faire connaître leur mécontentement quand le produit n’est pas à leur goût. Et pour être honnête, il faut dire que le produit est rarement à leur goût. Les élèves digèrent de plus en plus mal ce que les professeurs tentent encore bon an mal an de leur apprendre. La faute n’est pas seulement du côté des élèves : notre système scolaire, du moins dans les classes de lycée, privilégie encore trop souvent l’érudition sur la formation.
C’est sur ce point précisément que le texte de Nietzsche continue de nous interroger. Sans doute faut-il dépoussiérer ces conférences données par un philosophe de 28 ans de ce qu’elles ont de romantique, leurs allusions constantes à la beauté du Rhin et à la nature de façon plus générale, leurs références à la grande tradition allemande représentée par Winckelmann, Goethe et Schiller, tradition où l’étude du grec et du latin prime sur tout autre chose.
Dans ce texte Nietzsche dresse un constat accablant des établissements scolaires qui ne sont plus capables de promouvoir une culture digne de ce nom. Ils ne font plus, constate le philosophe, qu’enseigner une « culture journalistique » quand ils ne donnent pas la préférence aux études scientifiques. Il y a en effet dans ces conférences une diatribe contre les sciences qui pourrait nous surprendre si elle n’était pas toujours autant d’actualité. Ce que Nietzsche écrivait au XIXe était, selon son mot favori, « inactuel », mais est aujourd’hui bien présent à notre esprit : malgré ses excès, aurions-nous affaire à un texte prophétique comme l’envisage Nietzsche lui-même ?
Mais que reproche-t-il au juste au Gymnasium de son temps (les lycées classiques allemands) ? Ses critiques sont nombreuses mais l’une d’entre elles est récurrente : les lycées n’enseignent plus la maîtrise de la langue. Les professeurs apprennent à leurs élèves l’histoire de la langue, ils la décortiquent comme on fait d’un objet de laboratoire qu’on manipule avec des gants mais ils n’apprennent pas le génie de cette langue et ils ne permettent pas aux élèves de la considérer comme vivante. La culture, que porte une langue, a cessé d’être la source de la formation intellectuelle et n’est plus qu’un outil destiné à engranger des profits dans la vie active. Les lycées classiques ne sont pas loin au fond de ressembler à des lycées techniques.
Plus précisément Nietzsche regrette que la langue ne soit plus l’occasion d’un « dressage » (le terme revient de nombreuses fois dans la seconde conférence) :
« … tant qu’ils (les Allemands) ne prendront pas comme un devoir sacré le dressage pratique le plus minutieux à la parole et à l’écriture, tant qu’ils traiteront la langue maternelle comme si c’était un mal nécessaire ou un corps mort, je ne compterai pas ces établissements au nombre des institutions consacrées à la vraie culture. » (traduction de Jean-Louis Backès)
La notion de dressage a de quoi étonner sous la plume d’un philosophe qui se pique de plus de jouer au pédagogue. Elle renvoie pourtant à une idée forte : l’homme apprend non seulement à penser mais aussi à vivre dans la langue. Celle-ci est donc beaucoup plus qu’un simple instrument, beaucoup plus qu’un simple objet d’analyse linguistique : elle est un milieu de vie. Or les hommes n’apprennent pas à vivre ni à penser sans se plier à quelques rudes contraintes. Et si Nietzsche considère que les Allemands de son époque se sont abâtardis, s’il évoque même la barbarie pour qualifier les mœurs de son temps, c’est parce que la langue n’y est plus prise au sérieux.
Il semble que nos établissements scolaires en soient aujourd’hui au même point, du moins dans l’esprit qui les anime, car, dans les matières enseignées, les choses ont évidemment bien changé.
Je crois que nous pouvons faire remonter au septennat de Valéry Giscard D’Estaing la survalorisation des études scientifiques dans nos lycées : les mathématiques sont devenues peu à peu le sésame capable d’ouvrir toutes les voies d’accès aux différentes études supérieures. En même temps le bac littéraire perdait régulièrement de son intérêt et ses effectifs par contrecoup. La réforme du lycée qui se met en place l’an prochain ne semble pas devoir changer fondamentalement la donne : les mathématiques continuent d’être omniprésentes, l’enseignement de la philosophie voit ses horaires diminuer de façon très sensible.
En même temps nous constatons depuis des décennies une baisse très sensible du niveau de maîtrise de la langue française aussi bien au collège qu’au lycée. Il n’est pas rare de constater chez des élèves de terminale du bac général une méconnaissance grave de la syntaxe ainsi qu’une ignorance d’un certain vocabulaire de base.
Il est donc certain, pour reprendre le mot de Nietzsche, que nous ne prenons plus l’étude de la langue au sérieux. Sur ce point, il faut au moins rendre justice à Jean-Michel Blanquer d’avoir voulu revaloriser l’étude du français à l’école élémentaire.
Que formons-nous alors ? Il n’est pas certain que nos établissements scolaires forment de véritables scientifiques (avec cet esprit de curiosité, de découverte et d’invention qui devrait accompagner toute recherche) : ils forment des ingénieurs et des techniciens, des individus capables de répondre docilement aux sollicitations du marché. Aux mieux ceux-ci deviendront des « businessmen », des traders… Quant à nos littéraires, ils sont souvent encore plus démunis en français que nos matheux pour la simple raison que les meilleurs élèves s’orientent vers les filières scientifiques.
Il paraît donc légitime de reprendre le diagnostic posé par Nietzsche : le déclin de nos établissements scolaires est lié à la régression de l’étude du français à l’école. Moins les élèves maîtriseront la langue et plus nous aurons de problèmes, aussi bien au niveau de l’acquisition des « compétences intellectuelles » que du comportement. Trop d’élèves regardent aujourd’hui la langue comme un simple accessoire qu’ils peuvent ou non utiliser pour communiquer. Les images que les téléphones portables leur permettent d’envoyer instantanément aux quatre coins du monde, quand ce n’est pas simplement à l’autre bout de la salle de classe, font aussi bien l’affaire pour eux qu’un discours, une lettre ou une conversation. Et sans doute ces images leur paraissent-elles plus » vraies » qu’aucune phrase : elles ont pour elles le charme de l’immédiateté.
Or cet appauvrissement de la langue, cet usage réducteur qui en est fait aujourd’hui, un usage qui réduit la parole à un simple instrument de communication, ce mépris du discours interdit au fond à nos élèves de développer une pensée.
Mais à qui profite le crime ? À l’État tout d’abord qui a lui-même orchestré ce déclin de l’école, au marché ensuite qui trouve prête à l’emploi une main d’œuvre docile car inculte, aux religieux de tous poils enfin qui n’ont pas trop de difficultés à embrigader une jeunesse incapable de lire un texte. Les slogans publicitaires ou djihadistes passent d’autant plus facilement qu’ils s’adressent à des individus dont le selfie et le texto sont les modes privilégiés d’expression. Les images de propagande font le reste.
Pour en revenir aux tueries qui ensanglantent les écoles américaines, que ce soit à Santa Fe, à Miami (2018) ou encore à Columbine, il est probable que les auteurs de ces carnages souffraient non seulement de problèmes psychiques mais aussi d’une incapacité à se penser eux-mêmes et à comprendre le monde. Je les imagine accablés par une langue pauvre réduite à quelques oppositions simplistes (to fuck / to get fucked, les bons / les méchants, les mecs / les salopes, les hommes / les PD, les forts / les faibles.). L’absence de maîtrise de la langue rend les gens à la fois étrangers à eux-mêmes et au monde. Mais si certains jeunes gens sont aujourd’hui incapables d’exprimer leurs idées ou leurs affects et de développer une réflexion, comment pourraient-ils résister au passage à l’acte le plus sanglant qui a toujours le mérite de mettre fin d’une façon radicale aux différents problèmes que tout être humain doit affronter dès lors qu’il est vivant ? Il est frappant que le film de Gus van Sant montre des adolescents peu bavards, pour ne pas dire mutiques.
Gilles Pétel
La branloire pérenne


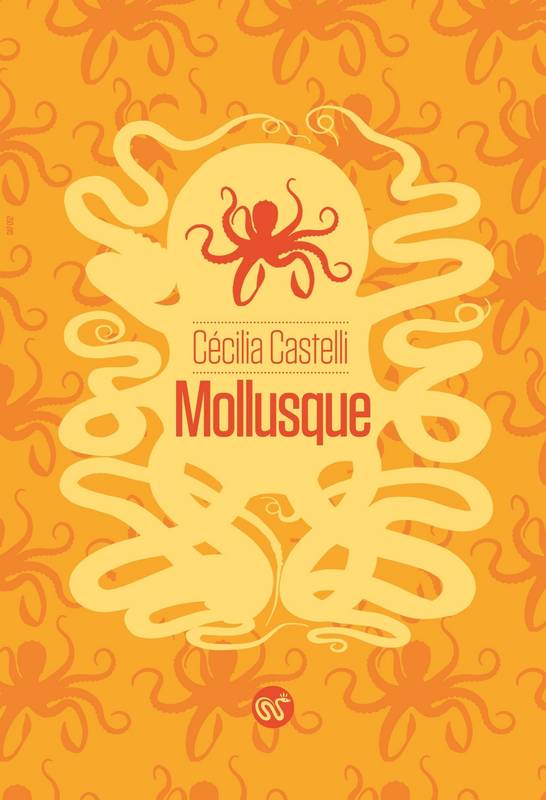






0 commentaires