Il y a un décalage certain entre les critiques de toutes disciplines et le public. Combien de critiques cinéma ont-ils vu Les nouvelles aventures d’Aladin, qui cartonne au box-office ? Hormis ceux des médias généralistes et populaires, sans doute assez peu. Quel public sera à l’inverse touché par le prix Marcel Duchamp, décerné lors de la dernière FIAC à Melik Ohanian ? Un tout petit nombre, déjà amateur d’art contemporain. Alors que sort Le fils de Saul, un film exceptionnel de justesse du jeune Laszlo Nemes, auréolé du Grand Prix du Festival de Cannes, on ne peut raisonnablement espérer que le film flirte avec les sommets du box-office, là où La liste de Schindler avait mis spectaculairement en avant ce qui ressemble à un grain de sable à l’échelle de la solution finale.
Exception notable, le prix Goncourt, décerné ce mardi à Boussole, de Mathias Enard, chez Actes Sud, verra à coup sûr son lauréat arriver en tête des listes de vente dans les semaines à venir. Mais, contrairement à une place de cinéma ou une entrée au musée, l’achat d’un livre ne garantit en rien sa lecture, et l’on sait bien que le prix Goncourt migrera rapidement du pied du sapin à l’étagère de la bibliothèque, sans toujours passer par les mains et surtout les yeux de son propriétaire. La question des prix, tous champs confondus, mériterait à elle seule une analyse extrêmement fouillée, dans laquelle on pourrait sans doute s’apercevoir aussi de l’étendue des grandes manœuvres de l’industrie discographique pour les cérémonies des Victoires de la Musique.
Alors, à qui la victoire ? Rarement aux artistes, mais le plus souvent aux industries. Pour quelques instants sous les lumières des projecteurs, au sortir, hébété, de chez Drouant, le lauréat du prix Goncourt aura tôt fait de retourner dans l’ombre de son bureau d’écrivain. Rares sont, en effet, les lauréats du prix littéraire majeur dont on se souvient, d’une année sur l’autre, et les critiques professionnels eux-mêmes ont bien souvent du mal à s’en souvenir. Ce qui domine, de plus en plus, ce sont les chiffres. Entrées en salles, ventes en librairies, nombre de visiteurs d’une exposition, nombre de téléchargements d’un disque, le quantitatif domine tant les esprits que c’est à cette aune unique que se jouent les carrières des artistes.
Les théâtres et autres lieux de spectacle vivant ne dérogent pas à la règle, et les tutelles ont tôt fait de pointer un taux de remplissage trop faible, sans jamais ou presque prendre en considération l’expérience individuelle des spectateurs, sans jamais ou presque s’intéresser à la prise de risque des programmateurs, qui peuvent et doivent permettre à des jeunes et des moins jeunes de proposer des formes nouvelles de représentations, de faire entendre de nouvelles écritures. D’où la multiplication des classiques sur les plateaux, les spectateurs étant réputés vouloir être rassurés par du “même”.
C’est bien sûr oublier que les courants majeurs, toutes disciplines confondues, se sont bien souvent fondés en rupture avec les formes établies. C’est oublier que les impressionnistes, aujourd’hui recordmen des ventes, passaient à leurs débuts pour des fous, ou que les premiers disques de rock étaient présentés comme satanistes.
Si une récente loi vient d’instituer la liberté de création, il nous faut imaginer aujourd’hui un devoir de création, une société dans laquelle les responsables de structures artistiques auraient droit à l’innovation, et donc droit à l’erreur. C’est à ce prix que notre pays pourra redevenir la terre d’élection des avant-gardes du monde entier.
Arnaud Laporte
[print_link]

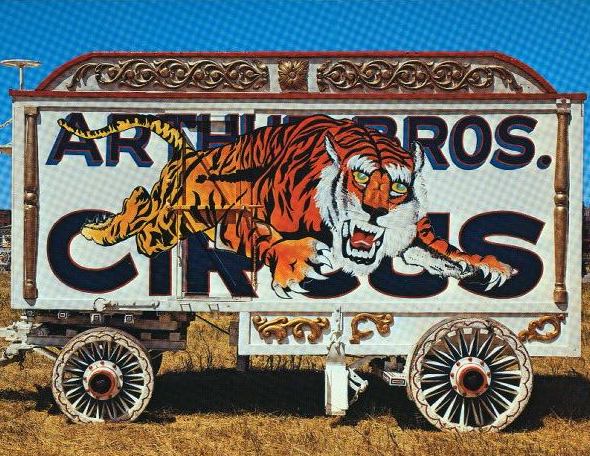





0 commentaires