Un cri, une ovation : samedi 25 août, au Jardin des Carmes, là où le festival d’Aurillac a été fondé en 1986 par Michel Crespin, artistes et spectateurs ont salué Jean-Marie Songy, directeur de la manifestation depuis 1994. « Le moment est venu de passer la main », avait-il annoncé dans un communiqué publié à la veille du festival. Une décision sans surprise mais qui laisse un sacré vide. Sous l’égide de Songy, le festival d’Aurillac n’est pas seulement devenu un phénomène de masse, attirant chaque été plus de 500 compagnies de rue et des dizaines de milliers de spectateurs. Il est aussi un lieu de création – sur la vingtaine de spectacles de la programmation officielle, la majorité sont des nouveautés –, de recherche, et de production depuis l’inauguration en 2004 du Parapluie, Centre international de création artistique, qui accueille toute l’année compagnies et artistes en résidence. Un gros héritage pour le ou la successeur.e de Songy qui devrait être choisi.e cet automne.
Rien de crépusculaire par ailleurs dans le dernier festival dirigé par Songy. Clins d’œil historiques, projections vers l’avenir, diversité des formes : le directeur sortant a déployé sur l’affiche du festival 2018 l’éventail de ses goûts. Il est même remonté à la préhistoire en invitant des dinosaures, comme ils se qualifient eux-mêmes : le Théâtre de l’Unité, déjà présent en 1986. Jacques Livchine et Hervée De Lafond, les fondateurs, ont toujours bon pied bon œil. Et même pas sommeil. La Nuit Unique, c’est le titre de leur spectacle, se déroule entre 23 heures et 7 heures du matin. Aucun mal de dos à redouter : les spectateurs sont couchés, et dormir y est possible, voire recommandé. Aux dires de ceux qui l’ont vécue, l’expérience était réussie, une immersion en douceur dans des musiques, des poèmes, des textes et des images oniriques à connotation historique.
Autres dinosaures en grande forme, Délices Dada. Qui convient le public à un concert nocturne dans la cour d’un lycée. Au programme, Les 4 Saisons de Vivaldi, réarrangées par Chris Chanet avec la participation active de la chanteuse lyrique Clarisse Piroud. Une petite heure délicieusement dada en effet, parsemée de touches loufoques -pantomimes, digressions, jeux de mots et questionnements philosophiques-, sans lâcher pour autant le fil mélodique. Un petit objet théâtral et musical parfait, dans le fond comme sur la forme, avec notamment un dispositif scénique en carré qui permet de ne pas faire de jaloux ; à chacun des mouvements, la position des spectateurs est redistribuée : ceux au premier rang pour écouter Le Printemps se retrouveront derrière quand viendra L’Hiver.
À propos d’hiver, quand la nuit fraîchit sur Aurillac, on peut aller se réchauffer chez Carabosse. À peine plus récente – elle a été fondée en 1988 –, la compagnie, spécialisée dans le feu et les flammes, est un autre repère majeur dans le paysage de la rue. Par les temps qui courent, son nouveau spectacle, est une immense installation, un jardin nocturne imaginé avec des artistes –musiciens, plasticiens, comédiens – qui ont eu carte blanche pour y déployer leurs Carnets de voyage. On s’y promène de braseros en grappes de bougies, on suit un tricycle et sa lanterne magique, on y rencontre des acrobates et des peintres au travail, on se recueille devant des autels profanes, on déchiffre dessins, sculptures, photos ou projections. Cela tient du bivouac et de la cathédrale en plein air, c’est beau, bien fait et quelque peu obscur quant au contenu (il est question de voyages, de migrations, d’exils, de figures féminines combattantes) ; on cherche dans le labyrinthe des fils peut-être absents, et l’on ressort sans être tout à fait entré.
Hiver, été, les nuits aurillacoises sont décidément trompeuses. Dans Bains Publics et plus si affinités, les spectateurs sont invités à venir avec leurs maillots de bain – les peignoirs sont fournis. Si l’on craint le froid ou que l’on n’a tout simplement pas envie de se déshabiller, ce n’est pas grave. Seule obligation : le port d’un masque blanc sur les yeux. À l’initiative de cette installation balnéaire « performative et participative », la compagnie 3615 Dakota, basée à Genève et associée au Collectif Les 3 points de suspension. Les baigneurs ont le choix entre plusieurs jaccuzis, aux propriétés diverses : selon que vous choisirez le bac « punks à chiens » ou le bac « festivaliers heureux », les huiles essentielles diffèrent et les effets aussi. Il y a un sauna, un bar à l’enseigne du « Temps perdu », des tables de massage et des stands derrière des draps blancs. Dont un karaoké à salades : les voix des volontaires sont censées simuler la croissance végétale. On trouve aussi une étable avec des moutons. Le tout formant un petit monde parallèle aux règles inattendues, une mini cure de désintoxication en forme de happening désinhibé et souriant.
Associer les spectateurs, les artistes de rue savent faire. Il y a le mode déambulatoire (Suivez le guide), la mise à contribution impromptue (Zut, pourvu que ça ne tombe pas sur moi), la transe collective (Eh bien dansez maintenant), l’ambiguïté entretenue (Acteurs ou spectateurs, cherchez l’erreur). Autant de formes redéclinées cette année dans plusieurs spectacles.
Dans Souffle, François Rascalou, qui vient de la danse, embarque les spectateurs tout en les ignorant. Avec son compère Yann Cardin, il orchestre une sorte de marche qui tient du cortège funèbre et de la cérémonie expiatoire. Seuls dans leur monde, les deux comédiens qui mènent le petit groupe font halte de temps en temps sur le trottoir pour se livrer à des chorégraphies mystérieuses, avec pour seuls accessoires des cannes à pêche pliables et des clochettes. Ils parlent aussi et le texte raconte par bribes la mort d’un père et la difficulté d’un deuil. Si l’on entre dans leur jeu (ce n’est pas si simple), cela peut devenir très beau, on ferme les yeux en se disant que les sonnailles de la transhumance marquent le chemin entre les morts et les vivants.
Autre déambulation sous la conduite d’un guide, Attentifs, ensemble ne laisse personne au bord du chemin. Cette création de la compagnie Ici-même entraîne deux groupes de spectateurs dans une promenade urbaine matinale, à la rencontre de personnages si familiers qu’ils sont presque invisibles : vieille porteuse de cabas, militaire en patrouille, balayeur municipal, femme SDF, gardien de parking, vigile de magasin… Autant d’anonymes qui sous le regard de la petite foule sortent de l’ombre. Ni misérabilisme ni message culpabilisant dans cette série de portraits in situ beaucoup moins réalistes que ce que l’on pourrait craindre ; l’humour – voire le fantastique – ne sont jamais loin. Et la réappropriation du slogan sécuritaire emblématique de l’état d’urgence ne se fait pas sur le mode compassionnel mais prend la forme d’un éloge de la curiosité.
Quelle place pour les spectateurs dans Cegos, de la compagnie brésilienne Desvio Coletivo ? Debout sur le trottoir, tout simplement. À l’inverse du car de l’équipe de France descendant en trombe ou presque les Champs-Élysées, les quelque cinquante participants de ce drôle de défilé avancent au ralenti des heures durant, statues d’argile muettes, zombies pétrifiés victimes du système (s’agenouiller devant une banque constitue l’une de leurs rares actions) ou pionniers d’un ralentissement souhaitable.
Qui berne qui dans Las Vanitas de la Compagnie Chris Cadillac ? Tout commence par l’irruption volcanique d’une comédienne, Mélanie Viñolo, partie pour tout déballer, sa vie, son métier, son intimité, nerfs à vif et sourire collé sur le visage. On s’y laisse d’autant plus prendre que l’enthousiasme du début se fissure. Interpellant sans cesse le public, qui lui répond volontiers, elle finit par se blottir dans les bras d’une spectatrice, plutôt gênée. Un moment de flottement dont se saisit une autre spectatrice pour accaparer l’attention : elle a forcé sur la bière et son propos est confus. Et c’est là que ça dérape : chacune à sa façon, les deux spectatrices finissent par voler la vedette à l’actrice (qui semblait pourtant douée pour ça), jusqu’à la déposséder entièrement de son spectacle. Tout est bien sûr prévu d’avance, mais on met un moment avant de l’admettre, alors que le spectacle a déjà viré au grand délire. Et même devant l’évidence, la sensation de ne pas savoir sur quel pied danser perdure, comme si, de même que l’actrice, on avait été dépossédé de son rôle.
Trafic, spectacle de la Compagnie Plateforme, dérape aussi à partir du moment où le public intervient. Mais il s’agit cette fois de vrais spectateurs. Le registre de la metteuse en scène Guillermina Celedón semble tendre vers un théâtre documentaire à visée politique. Avec un sujet, la prostitution, et un propos assumé : la dénonciation de l’esclavage sexuel. Le début de Trafic parle de tout cela, de façon aussi frontale qu’efficace. Jusqu’au moment où un comédien, mi-bonimenteur de foire, mi-proxénète, parvient à faire monter un petit groupe de spectateurs dans un fourgon où il les enferme avant de démarrer. Un rapt en direct – illustration radicale du propos – qui marque une rupture. Après cela, tout devient plus confus, plus inattendu, plus ambigu, plus fou, donc bien mieux.
Directement politique aussi The legend of Burning man par la compagnie catalane Insectotropics. Une variation obsessionnelle autour de la figure de Mohammed Bouazizi, le vendeur ambulant tunisien de 26 ans dont l’immolation par le feu le 17 décembre 2010, devant la préfecture de Sidi Bouzid, déclencha le « Printemps arabe ». Images, dessins, photos, documents sont projetés non stop sur un énorme cube autour duquel s’activent musiciens, comédiens, artistes graphiques, tous œuvrant à un kaléidoscope multimédia dont la puissance vitale touche et impressionne.
Documentaire aussi, l’énorme travail réalisé par la compagnie Uz et coutumes, animée par la metteuse en scène Dalila Boitaud Mazaudier. Après Hagati Yacu, spectacle réalisé en 2013 avec des acteurs rwandais, sur le génocide perpétré contre les Tutsi en 1994, la même équipe revient, dans Éjo N’Éjo Bundi (Hier Aujourd’hui Demain) sur tous les génocides du XXe siècle, à partir de témoignages de survivants ou de leur descendants, d’entretiens avec des philosophes, des historiens… Le spectacle se double d’une exposition, Installation d’une Catastrophe, où l’on peut écouter des enregistrements de toutes ces paroles, dans un dispositif plastique où les vêtements brûlés tiennent une place importante. L’installation se révélant beaucoup plus convaincante que le spectacle, qui peine à relever le défi de l’énormité de son sujet.
On sort de l’expo, plutôt secoué et l’on tombe sur une multitude dansant à midi, place de l’Hôtel de ville : c’est Vendredi, chorégraphie de foule imaginée par La Fabrique fastidieuse. Infiltrés dans les spectateurs, les danseurs changent souvent de registre et de direction, et ne se prennent pas pour des maîtres de ballet ; l’invitation à la danse est contagieuse mais pas impérative ; balancement de l’ours ou farandole, chacun fait comme il le sent.
Le grand bal d’Aurillac, c’est la bien nommée compagnie Transe Express qui l’organisait. Encore une compagnie historique (fondée en 1982), qui pour l’occasion a vu très grand. Les musiciens de l’orchestre jouent dans des nacelles suspendues à un lustre monumental accroché à une grue, au dessus de la place Michel Crespin. Un lustre où s’accrochent aussi des acrobates. Cristal Palace, bal au clair de lune, renvoie à une autre dimension du théâtre de rue : le gigantisme mécanique, dont Royal de Luxe fut l’un des grands propagateurs. Il ne s’agit pas seulement d’en mettre plein les yeux, mais de booster la fête, même si la cohue ne facilite pas la mise en place du bal populaire.
Le chapiteau du Cirque Trottola offre un cadre beaucoup plus minimaliste. Encore une autre face de l’éventail du théâtre de rue. Particulièrement chère à Jean-Marie Songy qui, outre Aurillac, dirige le festival Furies de Chalons-en-Champagne, où le cirque se taille la part du lion.  Campana, le spectacle de Trottola, est un modèle d’exigence réfléchie. Avec au centre de la piste, un couple qui peut rappeler Zampano et Gelsomina, les protagonistes de La Strada de Fellini. Un duo de contraires donc, avec un colosse mal léché (Bonaventure Gacon) et une clown acrobate (Titoune), plus deux musiciens comparses (Thomas Barrière et Bastien Pelenc). Impeccables, les numéros d’équilibre et de trapèze baignent dans une atmosphère étrange, doucement inquiétante ; sous les planches qui recouvrent la piste s’ouvre un drôle de trou noir qui pourrait bien être une bouche de l’enfer. Ils finissent par en extraire un gigantesque carillon dont le hissage, l’installation et la mise en branle (pour qui sonne le glas ?) supposent une succession d’étonnants efforts. Difficile de trouver plus belle image de l’art au travail.
Campana, le spectacle de Trottola, est un modèle d’exigence réfléchie. Avec au centre de la piste, un couple qui peut rappeler Zampano et Gelsomina, les protagonistes de La Strada de Fellini. Un duo de contraires donc, avec un colosse mal léché (Bonaventure Gacon) et une clown acrobate (Titoune), plus deux musiciens comparses (Thomas Barrière et Bastien Pelenc). Impeccables, les numéros d’équilibre et de trapèze baignent dans une atmosphère étrange, doucement inquiétante ; sous les planches qui recouvrent la piste s’ouvre un drôle de trou noir qui pourrait bien être une bouche de l’enfer. Ils finissent par en extraire un gigantesque carillon dont le hissage, l’installation et la mise en branle (pour qui sonne le glas ?) supposent une succession d’étonnants efforts. Difficile de trouver plus belle image de l’art au travail.
Dernière vision, comme en écho. Un spectacle du off, sur une placette, sous la pluie à onze heures du matin. Du cirque encore : deux acrobates avec pour seules armes un portique détrempé, un tapis de sol glissant et des sacs en papier qui recouvrent leurs têtes. Il serait plus prudent d’annuler ; même si le portique n’est pas haut, le danger est maximum. Mais elles ont décidé de jouer coûte que coûte. Et elles parlent, entre appuis instables, équilibres et portées précaires. De leur travail. De leurs corps. Journal de nos corps, c’est le titre du spectacle de Magali Bilbao et Violette Hocquenghem de la Compagnie Aller-Retour, clin d’œil au livre de Daniel Pennac, et surtout réflexion absurde et joyeuse sur les bizarreries de la morphologie et l’usure du temps. Implacable. Impeccable.
René Solis
Théâtre












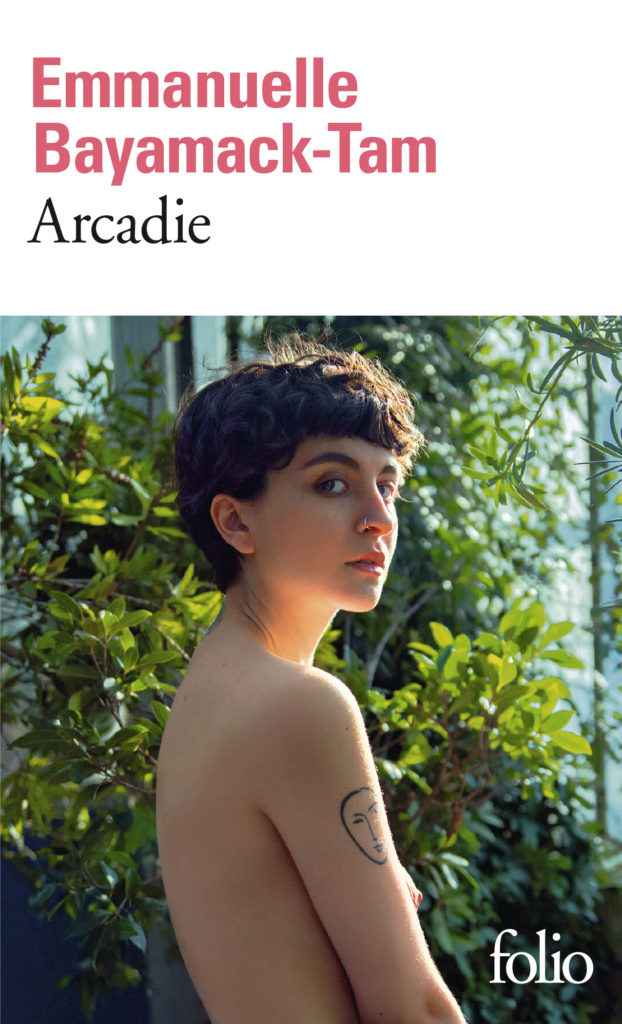






0 commentaires