Avouons-le tout net, ce premier Euro à 24 équipes (contre 16 depuis 1996, une décision prise alors suite à l’éclatement du bloc de l’Est et à l’apparition de nouveaux pays) n’a offert jusqu’ici presque que des matchs ennuyeux. Très vite, hélas, je comprends que ce Belgique – Eire risque de s’inscrire dans cette lignée. À 24 participants, les droits de retransmission explosent, des poches se remplissent, le téléspectateur peut bien s’ennuyer un peu, que diable ! Heureusement, on peut participer au grand jeu organisé par le diffuseur et gagner plein de cadeaux, il suffit d’envoyer un SMS surtaxé.
D’un côté, les Belges, deuxième équipe au classement mondial, première européenne. De beaux joueurs de ballon, un peu surcotés à mon avis à part Thibaut Courtois, le gardien qui fait 15 ans de plus que ses 24 ans, et Kevin de Bruyne, le joueur de Manchester City, qui a éliminé le PSG de la Champions League à lui tout seul. Face à eux, les Boys in Green (qui jouent en blanc), 33e nation footballistique mondiale, péniblement qualifiée pour cet Euro, on comprend pourquoi en les voyant ne pas réussir à se passer le ballon (pourtant le moyen le plus efficace pour tenter de marquer des buts, je le précise pour les béotiens). Sur la pelouse, les joueurs ne semblent guidés que par une obsession : faire n’importe quoi n’importe comment. Alors mon esprit vagabonde.
16 juin 1984. Je suis au Stade de la Beaujoire, à Nantes. L’Euro se déroule en France. Ce jour-là, les Bleus affrontent la Belgique. Mon club, l’US Clohars-Carnoët, nous a invités au match. (Les Irlandais n’alignent toujours pas trois passes. 70% de possession de balle pour les Belges, qui tournent en rond.) Deux ans plus tôt, j’ai compris que tout le monde m’avait menti, ou que je m’étais menti à moi-même : l’univers des adultes n’est ni juste ni équitable, puisque les Allemands ont éliminé les Français en demi-finale de la Coupe du Monde, alors que leur gardien de but, Harald Schumacher, aurait dû être expulsé pour un attentat sur Patrick Battiston, juste après un but refusé à Rocheteau pour une faute inexistante. (Eden Hazard envoie une mine 20 mètres au-dessus alors qu’il est seul face au but.) Sur le terrain, ce 16 juin 1984, une grosse équipe de Belgique – Pfaff, Scifo, Ceulemans, Vercauteren, etc. – s’en prend cinq par les Français sans en rendre un, triplé de Platini.
18 juin 2016, 15h25. Les Belges marquent mais Carrasco est hors-jeu. Dommage, sa coupe de cheveux est très réussie. Les Diables Rouges dominent mais ne savent plus quoi faire du ballon une fois arrivés à 30 mètres des buts adverses ; les Irlandais ne s’approchent pas à moins de 50 mètres de Thibaut Courtois, contrôles approximatifs et transmissions foireuses. Ils défendent en bloc avec cœur et hargne, opposant un collectif tâcheron aux individualités impuissantes d’en face. Ça donnerait presque envie de les aimer si ça ressemblait un peu plus à du football.
Je me demande combien d’argent rapportent à la chaîne les SMS que le commentateur nous encourage de nouveau à envoyer pour gagner une bagnole et des téléviseurs plus larges que mon studio. Comme pour nous inciter à jouer, une jolie supportrice irlandaise apparaît à l’écran, rousse comme il se doit. Je pense à Niamh Halligan. Ah, tiens, c’était en 1984 aussi. Quelques semaines après France-Belgique, voyage en Irlande avec le comité de jumelage. Premières clopes, premières pintes. Je suis adopté tout de suite car je porte un t-shirt “Destroy England” avec une tête de punk énervé. Je suis amoureux de Niamh. Je crois qu’elle préfère les garçons un peu plus âgés et je ne sais comment on flirte (je n’ai pas encore de poils, ce qui m’inquiète pas mal). Je bats mon correspondant au Scrabble en anglais, il est mort de honte. Ses parents, quand ils font la vaisselle, ne la rincent pas. Je suis effaré : je ferai la vaisselle durant tout mon séjour, histoire de ne pas bouffer trop de Paic. J’embrasserai Anita dans le parc du château. Un baiser furtif, un peu nul, emprunté, mais qui restera longtemps trésor dans la boîte à souvenirs.
Début de seconde mi-temps, je chasse Anita. Les Belges marquent un (très joli) but. Je comprends que le match est plié – les Irlandais jouent vraiment comme des cochons, pas une occasion, rien, ils essaient de se révolter mais sont vraiment trop limités, je suis triste face à leur impuissance. Je m’ennuie. Je me demande pourquoi j’aime ce sport. Dans la famille, seul mon grand-père maternel était foot. Il était abonné en tribune présidentielle au Stade Lavallois. Il m’emmenait au match parfois, et aux entraînements. Je côtoyais alors les joueurs avec des billes écarquillées. Je me souviens qu’une des stars de l’équipe, Eric Stéfanini, avait une 205 GTI, trop la classe. Pierre Aubame, le père de Pierre-Aymeric Aubameyang, m’avait fait entrer dans les vestiaires. Cela suffit-il pour faire naître une passion ? Je voulais devenir professionnel, quand j’avais une dizaine d’années. Je lisais Onze. Les Belges marquent un deuxième but, c’était couru d’avance. J’étais plutôt un bon gardien vers 12 ans, mais l’entraîneur me faisait jouer dans le champ deux matches sur trois parce que le second goal était trop gros pour jouer à un autre poste. À quoi ça tient, une carrière ? Si ça se trouve, en persévérant dans les cages, j’aurais attiré l’œil de recruteurs. En même temps, aucun joueur passé par l’US Clohars-Carnoët n’est devenu pro, à ma connaissance. Mais surtout, alors que je déteste tout ce qu’il y a autour (la corruption, les salaires indécents, les hooligans, la publicité à outrance, la starification de crétins décérébrés, les paris sportifs, etc.), pourquoi diable continué-je à suivre le football ? Peut-être pour voir des joueurs comme Mertens, qui remplace Carrasco. J’aime bien Mertens. Un attaquant subtil, fin, technique. Je n’ai jamais su dribbler. Quand je n’étais pas dans les buts, je jouais avant-centre et je mettais des têtes parce que j’étais grand. Souvent, le dimanche matin, il fallait aller chercher chez eux des coéquipiers qui dormaient encore, cuvant la cuite de la veille. Les Belges marquent un troisième but. Leur victoire ne rassure pas sur leur capacité à faire de leurs individualités une équipe.
Dans les travées du stade, les supporteurs irlandais chantent, l’occasion pour le commentateur, après nous avoir encore incité à envoyer un SMS pour gagner une bagnole, de balancer quelques clichés. Ce n’est pas lui qui rappellerait aux téléspectateurs (est-ce son rôle ? me rétorquerez-vous) que le Conseil d’État a annulé voici quelques semaines pour “vice grave” le contrat de partenariat public-privé (PPP) signé entre la ville de Bordeaux et les groupes de BTP Vinci et Fayat pour la construction et l’exploitation du stade Matmut Atlantique où se déroule ce soporifique Belgique-Eire. Entre autres parce que le contrat “prévoyait que le titulaire refacturerait à la commune les impôts et taxes qu’il aurait acquittés”, soit 2,6 millions d’euros annuels, ce qui n’était pas intégré dans le coût prévisionnel soumis aux conseillers municipaux. Oui, oui, vous avez bien lu, le consortium d’entreprises gérant le stade ne paiera pas d’impôts locaux, ce pendant 30 ans. Bordeaux, Marseille, Nice, Lille : au moins quatre des dix stades rénovés ou construits pour cet Euro l’ont été, avec irrégularités à la clé, voire procès, sous le régime du PPP. La Cour des comptes lui a consacré un chapitre de son rapport annuel. Avec une conclusion tranchante : “Sur le long terme, l’équilibre économique du contrat est souvent défavorable aux collectivités territoriales”. La commission des lois du Sénat, elle, soulignait en juillet 2014 que les PPP sont “une bombe à retardement budgétaire souvent ignorée par des arbitrages de court terme, […] une formule ‘clés en mains’ rassurante, mais aussi infantilisante” et provoquent un “effet d’éviction des petites et moyennes entreprises.” Des poches se remplissent, le contribuable regarde du foot à la télé.
Le match est terminé. J’aurais vraiment perdu 90 minutes de ma vie s’il ne m’avait pas permis de retourner dans les gradins de la Beaujoire, sur la plage de Dunmore-East, les pelouses dominicales du Finistère Sud où vomissaient mes coéquipiers, de me renseigner plus avant sur le scandale des PPP. Finalement, il se passe toujours quelque chose sur un terrain de foot.
Erwan Larher
Erwan Larher a joué au football, au tennis, au football américain et au squash. Il n’a excellé dans aucune de ces disciplines et, sans relation de cause à effet, a publié chez Michalon Qu’avez-vous fait de moi ? et Autogenèse, chez Plon L’abandon du mâle en milieu hostile et Entre toutes les femmes, puis, en avril 2016 chez Quidam Éditeur, Marguerite n’aime pas ses fesses.



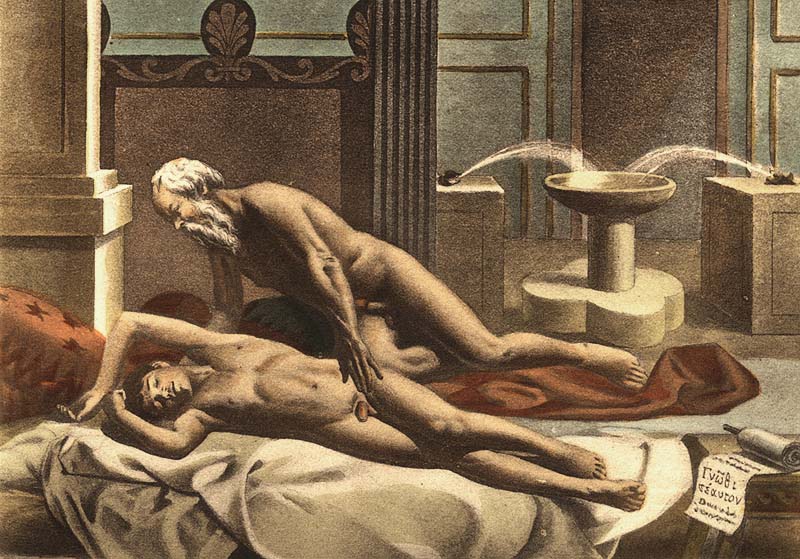





0 commentaires