Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
La controverse passionnée suscitée par la tribune du Monde du 9 janvier cosignée, entre autres, par Catherine Millet et Catherine Deneuve, donne, et c’est le moins que je puisse dire, matière à réfléchir.
Pour le moment, car les positions évoluent, les lignes d’affrontement bougent sans cesse, pour le moment donc, le débat semble se résumer à une opposition entre tenantes d’un féminisme communautaire et représentantes d’un féminisme individualiste, car ni les unes ni les autres ne sont hostiles à l’émancipation des femmes, peut-on penser.
En tant qu’homme, je ne me hasarderai pas à prendre parti dans ce débat, mais j’aimerais simplement tenter de prendre un peu de recul et placer le problème des violences faites aux femmes – et justement dénoncées – dans un problème plus vaste qui est celui de la violence sociale.
Après les premières révélations liées à l’affaire Weinstein, on pouvait espérer qu’il s’agissait d’un cas isolé. L’ampleur des dénonciations qui ont suivi a rapidement montré qu’il n’en était rien. Parti des États-Unis (#MeToo), le mouvement a gagné la France (#BalanceTonPorc). Une véritable traînée de poudre, en somme.
La première remarque que je voudrais faire porte sur le décalage entre l’image que nos sociétés modernes renvoient volontiers d’elles-mêmes au reste du monde et la réalité de la misère de la condition des femmes qu’attestent les très nombreuses prises de parole. C’est en quelque sorte le vernis de nos sociétés qui s’est écaillé pour laisser apparaître une réalité rugueuse et sale.
On pouvait pourtant croire que les mouvements féministes avaient abouti à quelques belles conquêtes en termes de droits : droit de vote, droit d’avorter, droit d’exercer une carrière dans le métier de son choix, droit encore à l’égalité salariale, etc. On pouvait alors légitimement condamner les sociétés où de tels droits ne sont pas encore acquis. La liberté sexuelle enfin, rendue possible par la généralisation des contraceptifs, semblait avoir fait de la femme l’égale de l’homme puisqu’elle aussi pouvait désormais entretenir des relations sexuelles débarrassées du fardeau de la maternité.
Mais #MeToo et #BalanceTonPorc laissent apparaître le dessous des cartes. Nous découvrons ou nous faisons semblant de découvrir que les femmes continuent d’être exploitées. Elles le sont d’abord dans le domaine du travail où leur carrière avance moins rapidement que celle des hommes et où leur salaire reste presque systématiquement inférieur à celui de leur homologue masculin à travail égal et pour une même qualification, elles le sont encore dans le domaine de la politique où elles sont sous-représentées aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, elles le sont enfin dans la vie quotidienne où elles sont régulièrement harcelées, parfois battues, parfois violées. Le constat est accablant. Il n’est malheureusement ni neuf ni original.
Ce constat est tellement banal que nous en oublions le problème qu’il pose : que valent nos droits ? Et plus largement quel est le sens du droit ?
Dans la Critique du programme de Gotha, Marx écrit à propos de la Déclaration des droits de l’homme : « Ce droit égal est un droit inégal pour un travail inégal. Il ne reconnaît aucune distinction de classe, étant donné que chacun est un travailleur comme un autre, mais il reconnaît tacitement l’inégalité des talents individuels et par suite des capacités productives comme des privilèges naturels. C’est donc d’après son contenu un droit de l’inégalité comme tout droit. »
L’égalité en droits que reconnaissent nos États n’est pas une égalité matérielle (ou égalité de condition) mais une simple égalité formelle. Par exemple, chacun a le droit d’accéder à la propriété (droit fondamental) mais beaucoup sont dans l’incapacité de jamais y parvenir faute de moyens. De même, une femme aujourd’hui a le droit d’exercer n’importe quel métier de son choix (il doit encore y avoir, j’imagine, quelques exceptions) et d’y faire carrière. Mais le droit qu’elle a d’avoir des enfants, plus le désir éventuel de procréer, lui-même parfois appuyé sur le devoir social d’être mère (ce qui, reconnaissons-le, fait beaucoup d’impératifs pour un seul être), retarderont sa carrière : traitées « à égalité » avec les hommes, les femmes ne peuvent que pâtir de cette égalité toute théorique et en somme très « inégale » pour reprendre le mot de Marx.
Pour revenir à la question des violences faites aux femmes, il est certain qu’elles s’inscrivent dans un contexte beaucoup plus large d’inégalités réelles qui explique en partie leur banalisation. Mais la violence faite aux femmes en quelque sorte autorisée par l’esprit même de notre droit ne concerne-t-elle pas également tout individu placé dans une position d’infériorité économique et sociale ? Il me semble que nous découvrons avec une fausse naïveté que le droit n’est bien souvent que le masque de la force.
Pourtant cette violence faite aux femmes n’est pas n’importe quelle forme de violence : il s’agit d’une violence sexuelle qui va du simple fait d’être importunée par un homme (par exemple sifflée ou apostrophée en pleine rue) au viol caractérisé. Dans tous les cas, cette violence est insupportable. Mais peut-elle être supprimée ? Et comment ?
C’est là que le bât blesse. #MeToo et #BalanceTonPorc incitent à la dénonciation. Celle-ci est distincte de la délation qui prend appui sur « des motifs méprisables » précise Le Robert (vengeance, jalousie, racisme, etc.). Ainsi le droit français reconnaît la dénonciation et, depuis peu, va même jusqu’à l’encourager (en rémunérant par exemple les indicateurs de la police), mais condamne la délation. Pourtant la frontière qui sépare ces deux démarches est-elle toujours clairement délimitée ? Les passions humaines sont, pour la plupart, des passions sociales et il est donc inévitable que nous les retrouvions chez nos concitoyennes comme chez nos concitoyens. Les journaux américains, très largement favorables au mouvement #MeToo, soulignent qu’il n’y a pas eu d’abus lors de la campagne de dénonciation qui n’en est encore qu’à ses débuts. Un seul cas, semble-t-il, de diffamation a pour le moment été établi. Le risque pourtant d’un dérapage ne peut être écarté. Mais admettons que ce risque soit minime et que le jeu en quelque sorte en vaille la chandelle, que mettons-nous en place à travers cette campagne de dénonciation généralisée sinon ce que Foucault appelait « une société de contrôle » ?
Dans Huis clos, Sartre imagine un enfer moderne. Trois personnages, deux femmes, Estelle et Inès, et un homme, Garcin, se retrouvent enfermés pour l’éternité dans une pièce sans fenêtre ni miroir. Ils ne peuvent rien faire d’autre que se regarder et parler. Il n’y a cependant ni instrument de torture ni bourreau. Très vite les trois larrons de la farce se demandent quand commenceront les supplices jusqu’au moment où Inès comprend le sort qui les attend :
Inès.– Eh bien, ils ont réalisé des économies de personnel. Voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs.
Estelle.– Qu’est-ce que vous voulez dire ?
Inès.– Le bourreau, c’est chacun de nous pour les autres.
À la fin de la pièce, Garcin résume la situation dans un mot célèbre : « L’enfer, c’est les autres. »
Je crains que nous nous dirigions allégrement, et avec les meilleures intentions, vers ce type d’enfer où chacun se doit de contrôler les faits et gestes de son voisin, épargnant ainsi à la police le travail de maintien de l’ordre qui lui est traditionnellement dévolu, épargnant également à l’État un nombre considérable de dépenses. Il est d’ailleurs remarquable que nous possédions déjà les moyens nécessaires à ce contrôle permanent grâce à nos smartphones capables de photographier et de filmer à tout moment n’importe quelle scène de la vie ordinaire.
Contrôler les allées et venues de certains individus, empêcher les actes répréhensibles, punir enfin sont sans doute des nécessités mais celles-ci restent tolérables tant qu’elles sont dévolues à une autorité clairement identifiée. Lorsque chacun au contraire croit pouvoir se substituer à l’État et à la justice, nous ne sommes pas loin de perdre une bonne partie de ces libertés qui, dit-on, constituent le privilège de nos démocraties. En ce sens #MeToo et #BalanceTonPorc ont quelque chose d’inquiétant.
Autrefois nous trouvions à bord des autobus un contrôleur qui venait épauler le conducteur. Lui étaient attribués le rôle de vérifier les tickets mais aussi celui de veiller à la sécurité des passagers. Nous avons supprimé les contrôleurs et nous avons commencé, dans les métros, à supprimer les conducteurs comme nous avons encore supprimé les employés chargés de vendre les tickets désormais remplacés par des machines. Nous avons effectivement « réalisé des économies de personnel ». Il n’est dès lors guère surprenant que les cas de harcèlement à l’égard des femmes se multiplient dans les transports en commun. Il n’est pas non plus surprenant que les États-Unis, pays au libéralisme exacerbé, encouragent le mouvement #MeToo. Faute de fonctionnaires, c’est alors aux citoyens de « faire le service eux-mêmes ».
Gilles Pétel
La branloire pérenne





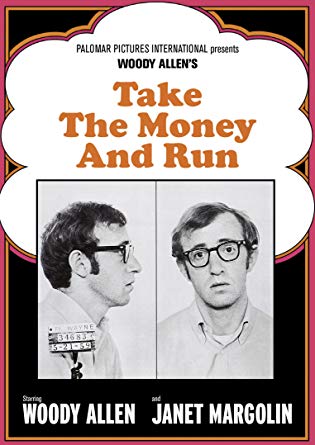



0 commentaires