Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019, Lucette Destouches, Lulu pour les intimes, la veuve de Céline, Louis-Ferdinand Destouches, a cassé sa pipe à l’âge abrahamique de 107 ans. Hasard prémonitoire du calendrier nécrologique, Gallimard venait de tirer des fagots Les Cahiers de prison de l’époux, soixante ans après sa mise en bière, dans lesquels le défunt, alors vivant, ruminait contre l’injustice faite au grand pacifiste qu’il fut de toute éternité. Pensez donc, l’obliger à détaler au Danemark pour récupérer ses lingots et se soustraire au peloton d’exécution ! Fallait-il que la Patrie ait tout oublié des sacrifices sur le champ de bataille de Poelkapelle et sur le champ littéraire grouillant de tireurs embusqués… Les porteurs d’encensoirs ont tenté d’effacer l’opprobre des geôles danoises et l’ont sitôt remis en selle sur le canasson des rentrées littéraires. Souffrez qu’on contribue au commentaire, en nuançant toutefois l’oraison.
Globalement, Céline, c’est de la vraie monnaie humaine : pile, que du sublime, face, que des saloperies. Avec ça on peut tout acheter : Pétain au bon moment, Gallimard pour la postérité. Entre les deux, après son amnistie, dans sa bicoque de Meudon, avec son chat Bébert et la Lucette qui fait des entrechats à l’étage, le père Destouches claudique en psalmodiant sur les misères qu’on lui inflige, vacille dans son costard de clodo, maudit, regrette un peu, persiste et signe… Et Gallimard, éditeurs de père en fils, comme par transsubstantiation, d’envisager aussi – si la bien-pensance voulait bien ne pas interférer dans les affaires familiales des marchands avisés – de rééditer les pamphlets antisémites… Pourquoi pas ?
Si l’on entend les critiques littéraires et amateurs éclairés, les spécialistes des belles lettres et de l’argot, les écrivains tout au fait du fait littéraire, les experts en Pléiades dorées sur tranche, aimer Céline, c’est aujourd’hui obligatoire ! On voit les laudateurs, chacun à sa manière, Messieurs Sollers, Nabe, Zagdanski, et Céliniens en pagaille, palpiter devant l’affaire. Pas un qui ne s’incline, peu ou prou, devant le révolutionnaire des belles lettres. Même si les pamphlets anti-juifs sont là pour donner du fil à retordre, embarrasser l’admirateur, il y a quelque chose de plus fort que l’abject qui le maintient en prosternation devant le maître, devant l’icône qui étend sa grâce sur ses plus proches dévots. Quelque chose de l’ordre du transfert dont parle Freud. Lacan le dit comme ça : « de l’amour qui s’adresse à du savoir ». Et pour savoir, le père Céline, il en savait un sacré bout sur cette chienne de vie. D’ailleurs, il n’a pas tort l’admirateur, les artistes délictueux aussi ont à se prononcer sur le sens de ce monde. Qu’on pense à Lacenaire montant sur l’échafaud comme sur les planches désirées par un grand comédien. Garance, la divine Arletty, une copine de Céline, lui donne la réplique dans le film de Carné.
Que Céline ait été une fripouille ne change rien au fait qu’il ait été un assez grand écrivain. Allez, n’ergotons pas, un grand écrivain, ce qui ne veut rien dire. Que faut-il entendre par « grand » ? Qu’il a quitté la corporation des moyens et des petits ? Qu’il a chaussé de grands souliers qui font la différence sur la distance, qui permettent de creuser l’écart ? Et pour creuser l’écart, aucun doute, Céline creuse. Il part de la vie commune, saisie dans sa trivialité, celle des crève-la faim, à laquelle le grand humanisme, encyclopédistique, opposait jusque-là sa parole souveraine, pour la doter d’un verbe transfiguré, refiguré, soit. C’est un jeu sérieux, en effet, que de jouer avec le langage, c’est jouer avec le lecteur. Être pris au sérieux, c’est être pris à la lettre, et c’est prendre au collet aussi. La lettre célinienne ne laisse pas de place au doute, elle dit ce qu’il pense, « Voilà comment je pense, moi », comme il le répète à l’envi, une envie d’en découdre.
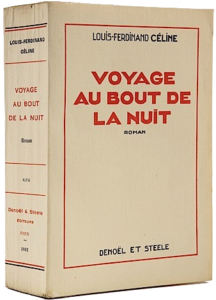 Au succès du Voyage, il frétille de morgue, de lui tenir la dragée haute au monde littéraire, de l’époustoufler… Soit dit en passant, conchier le monde littéraire, de son propre aveu, et fulminer de ne pas recevoir un prix littéraire, ça jette un doute sur les aspirations de l’homme de plume. Impétrant du Renaudot, inconsolable du Goncourt, le voilà qui fulmine. Et pas un fifrelin pour Mort à crédit, une histoire qui ne mégote pourtant pas sur les haut-le-cœur de Ferdinand. Parce que la littérature, comme la mort ou la vie à crédit, c’est aussi une affaire d’argent. L’argent, il doit bien le dire quelque part, même en d’autres mots, n’est pas seulement de la valeur d’échange, c’est aussi la vérité des relations humaines, surtout quand on n’en a pas beaucoup, de l’argent s’entend. Les laudateurs ont peu raconté sur les dessous des sous à Céline. Prenons le temps de le relire : par exemple à New York, Bardamu, en bon délégué célinien, veut anéantir Lola en lui ôtant tout espoir de voir sa mère guérir du cancer qui la ronge.
Au succès du Voyage, il frétille de morgue, de lui tenir la dragée haute au monde littéraire, de l’époustoufler… Soit dit en passant, conchier le monde littéraire, de son propre aveu, et fulminer de ne pas recevoir un prix littéraire, ça jette un doute sur les aspirations de l’homme de plume. Impétrant du Renaudot, inconsolable du Goncourt, le voilà qui fulmine. Et pas un fifrelin pour Mort à crédit, une histoire qui ne mégote pourtant pas sur les haut-le-cœur de Ferdinand. Parce que la littérature, comme la mort ou la vie à crédit, c’est aussi une affaire d’argent. L’argent, il doit bien le dire quelque part, même en d’autres mots, n’est pas seulement de la valeur d’échange, c’est aussi la vérité des relations humaines, surtout quand on n’en a pas beaucoup, de l’argent s’entend. Les laudateurs ont peu raconté sur les dessous des sous à Céline. Prenons le temps de le relire : par exemple à New York, Bardamu, en bon délégué célinien, veut anéantir Lola en lui ôtant tout espoir de voir sa mère guérir du cancer qui la ronge.
« De quoi souffre-t-elle votre mère ?
– D’un cancer au foie… Je la fais soigner par les premiers spécialistes de la ville… Leur traitement me coûte très cher, mais ils la sauveront. Ils me l’ont promis. »
[…] Devenue soudain toute tendre et familière elle ne pouvait plus s’empêcher de me demander quelque intime réconfort. Je la tenais.
« Et vous, Ferdinand, vous pensez aussi qu’ils la guériront n’est-ce pas ma mère ?
– Non, répondis-je très nettement, très catégorique, les cancers du foie sont absolument inguérissables. »
Du coup, elle pâlit jusqu’au blanc des yeux. C’était bien la première fois la garce que je la voyais déconcertée par quelque chose.
« Mais pourtant, Ferdinand, ils m’ont assuré qu’elle guérirait les spécialistes ! Ils me l’ont certifié… Ils me l’ont écrit !… Ce sont de très grands médecins vous savez ?…
– Pour le pognon, Lola, il y aura heureusement toujours de très grands médecins… Je vous en ferais autant moi si j’étais à leur place… Et vous aussi Lola vous en feriez autant… »
Ce que je lui disais lui parut brusquement si indéniable, si évident, qu’elle n’osait plus se débattre.
Pour une fois, pour la première fois peut-être de sa vie elle allait manquer de culot.
« Écoutez, Ferdinand, vous me faites une peine infinie vous vous en rendez compte ?… Je l’aime beaucoup ma mère, vous le savez n’est-ce pas que je l’aime beaucoup ?… »
Ça tombait à pic alors ! Nom de Dieu ! Qu’est-ce que ça peut bien foutre au monde, qu’on aime sa mère ou pas ? Elle sanglotait dans son vide la Lola.
« Ferdinand, vous êtes un affreux raté, reprit-elle furieuse, et rien qu’un abominable méchant !… Vous vous vengez aussi lâchement que possible de votre sale situation en venant me dire des choses affreuses… Je suis même certaine que vous faites beaucoup de mal à ma mère en parlant ainsi !… »
[…]
Je la regardais attentivement, Lola, pendant qu’elle me traitait de tous les noms et j’éprouvais quelque fierté à constater par contraste que mon indifférence allait croissant, que dis-je, ma joie, à mesure qu’elle m’injuriait davantage. On est gentil à l’intérieur.
« Pour se débarrasser de moi, calculais-je, il faudra bien à présent qu’elle me donne au moins vingt dollars… Peut-être même davantage… »
Je pris l’offensive : « Lola, prêtez-moi je vous prie l’argent que vous m’avez promis ou bien je coucherai ici et vous m’entendrez vous répéter tout ce que je sais sur le cancer, ses complications, ses hérédités, car il est héréditaire, Lola, le cancer. Ne l’oublions pas ! »
À mesure que je détachais, fignolais des détails sur le cas de sa mère, je la voyais devant moi blêmir Lola, faiblir, mollir. « Ah ! la garce ! que je me disais moi, tiens-la bien, Ferdinand ! Pour une fois que t’as le bon bout !… Ne la lâche pas la corde… T’en trouveras pas une si solide avant longtemps !… »
« Prenez ! tenez ! fit-elle, tout à fait excédée, voilà vos cent dollars et foutez-moi le camp et ne revenez jamais, vous m’entendez : jamais !… Out ! Out ! Out ! Sale cochon !…
– Embrassez-moi quand même Lola. Voyons !… On n’est pas fâchés ! » proposai-je pour savoir jusqu’où je pourrais la dégoûter. Elle a sorti alors un revolver d’un tiroir et pas pour rire. L’escalier m’a suffi, j’ai même pas appelé l’ascenseur.
C’est pas beau ça ? Le moins qu’on puisse dire, c’est que le Bardamu, médecin lui-même de son état célinien, n’a pas mis longtemps à délibérer sur la question du mensonge médical et de ses éventuelles vertus compassionnelles. C’est une position déontologique après tout. Que la pauvre Lola ait beaucoup de peine, en effet, n’est pas vraiment la question. « Qu’est-ce que ça peut bien foutre au monde, qu’on aime sa mère ou pas ? » Voilà comment il pense, lui : la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! Ça n’a pas de prix. Mais pour Bardamu en errance newyorkaise, même si la vérité est proprement inestimable, en bon trifouilleur célinien des faiblesses et des croyances humaines, il sait comment en tirer un bon prix : cent dollars, cinq fois plus que ce qu’il escomptait. C’est une manière impitoyable de voir les choses et d’entendre ses semblables. Quand on écoute d’abord poliment – parole de médecin –, on peut toujours en tirer du pognon. Cette entrevue avec Lola est bien un règlement de comptes, au sens propre comme au figuré. Au sens propre, les comptes sont vite faits : il n’a plus un sou en poche, et l’indigence n’incite pas à chipoter sur la méthode, vérité ou mensonge, il faut survivre. On pourrait penser que la revanche de ce paumé sans-le-sou venu mendier une poignée de dollars est celle, presque légitime, du chien enragé qui mord la main qui le nourrit. De l’ordre, en quelque sorte, de l’ingratitude ou de la mesquinerie désespérée, presque compréhensible… Au sens figuré, c’est plus intéressant. La vérité tue ! Pas la mère de Lola, mais Lola elle-même : « Devenue soudain toute tendre et familière elle ne pouvait plus s’empêcher de me demander quelque intime réconfort. Je la tenais. » Elle cherche du réconfort, elle aura la vérité ! À bout portant ! Car la vérité est plus dure à encaisser qu’une condescendante poignée de dollars. Ça pousse à la riposte, à la légitime défense, à sortir un révolver pour s’en protéger de cette vérité homicide.
L’idée selon laquelle la vérité est une arme létale est essentielle. Elle est le nerf de l’antisémitisme exterminateur de Céline. Bardamu l’essaye sur Lola, Céline sur les Juifs. La vérité du Juif, en tant qu’espèce, de « toute la youtrerie du globe », doit lui être adressée, sans autre forme de procès ni espoir de repêchage. Lui dire, en somme, ses quatre vérités au Juif. De la pure parole d’évangile. Et quand je dis « évangile », ce n’est pas une métaphore. Il ne s’agit pas, en effet, de la vérité en soi, objective, celle qui ressort de l’hypothèse soumise à la confirmation de l’expérience scientifique, mais de la vérité adressée, à bon entendeur, comme on dit. On peut dire la vérité du charbonnier, la vérité in petto, dure comme fer, comme toute vraie croyance, sans avoir besoin de s’appuyer sur une expertise. Quand Bardamu, médecin, qui sait de quoi il parle, dit que la mère de Lola est foutue, il ne délivre pas une simple vérité médicale. Car ce n’est pas ici l’information « indéniable » qui compte, mais sa performance immolante, l’estocade technique. La portée de la vérité est dans le coup porté. Bardamu-Ferdinand-Céline ne ment pas, il dit ce qu’il sait, comme un voyant ou un prophète annonce ce qu’il va arriver. Un célèbre linguiste l’a dit, et Céline le sait : dire c’est faire. Il sait aussi que pour qu’une telle équation du langage opère, une même foi est requise entre les interlocuteurs. La pauvre Lola ne serait pas si bouleversée si elle ne croyait pas ce sale cochon de Bardamu. Et cette même foi produit ses effets dans le cœur du lecteur, qui en demande toujours un peu plus que les simples protagonistes du récit, et veut donc aussi partager les visions extralucides, hallucinées du héros Bardamu. Dans bien des épisodes saisissants du Voyage ou de Mort, puisqu’il est sans cesse question d’un monde sans honneur, parfaitement dégueulasse, la vérité célinienne évangélise le lecteur : « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jean, 18). Céline, plus que d’autres, s’engage en littérature comme on s’engage en religion. C’est de la liturgie pour une purgation du monde, un purgatoire, une sorte d’exorcisme.
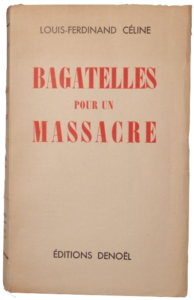 Considérer les pamphlets antisémites comme issus d’une mauvaise treille, dont ne proviendrait pas le cru de ses « grands » romans, comme le prétendent d’aucuns et biographes, et Céline lui-même sur le tard, c’est refuser l’unité célinienne qui va, sans solution de continuité, du berceau littéraire au cercueil politique. Qu’on dise en quoi les chapitres les plus abjects de Bagatelles, un succès de librairie à l’époque, ont moins de portée et de valeur littéraires que les plus époustouflants chapitres du Voyage ou de Mort à crédit ? Ces deux-là sont écrits plus tôt, pas de beaucoup, mais mobilisent le même génie, ça frotte la même lampe merveilleuse du langage, ça fait grincer la même plume, et pour le dire en suivant les revendications de l’auteur-même, le même « style », ce qui, à ses yeux, est bien plus important que l’histoire qu’on raconte. Il faut le prendre au mot, sans jeu de mots, l’entendre de la chambre à coucher ou de la salle à manger, presque de la souillarde, où tintent la vaisselle et les casseroles du dîner, pour comprendre l’incipit : « Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. »
Considérer les pamphlets antisémites comme issus d’une mauvaise treille, dont ne proviendrait pas le cru de ses « grands » romans, comme le prétendent d’aucuns et biographes, et Céline lui-même sur le tard, c’est refuser l’unité célinienne qui va, sans solution de continuité, du berceau littéraire au cercueil politique. Qu’on dise en quoi les chapitres les plus abjects de Bagatelles, un succès de librairie à l’époque, ont moins de portée et de valeur littéraires que les plus époustouflants chapitres du Voyage ou de Mort à crédit ? Ces deux-là sont écrits plus tôt, pas de beaucoup, mais mobilisent le même génie, ça frotte la même lampe merveilleuse du langage, ça fait grincer la même plume, et pour le dire en suivant les revendications de l’auteur-même, le même « style », ce qui, à ses yeux, est bien plus important que l’histoire qu’on raconte. Il faut le prendre au mot, sans jeu de mots, l’entendre de la chambre à coucher ou de la salle à manger, presque de la souillarde, où tintent la vaisselle et les casseroles du dîner, pour comprendre l’incipit : « Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. »
Reste à faire une sémiologie de la parole tardive, de l’action différée, de celui qui ne dit rien, et qui un jour décide de tout déballer. Ça vient comme le retour du refoulé. Admettre, en effet, que la psychanalyse dévoile la dimension qui excède la pensée consciente de nos actes, de l’auteur d’un acte, et ne pas considérer que la pensée et le style de Céline relève d’un travail qui échappe en bonne partie à l’auteur, c’est faire deux poids deux mesures. Il suffit de voir l’homme devant ses manuscrits ; des entretiens filmés dans sa bicoque ont saisi la parole du patient mieux que sur un divan.  On le voit s’y confesser sur l’établi domestique, ça ne s’invente pas, avec des pinces à linge, côté buanderie, entre lessive, ravaudage et repassage, que du beau drap, avec de la dentelle brodée d’un autre fil littéraire que celui des académiques naphtalinés…
On le voit s’y confesser sur l’établi domestique, ça ne s’invente pas, avec des pinces à linge, côté buanderie, entre lessive, ravaudage et repassage, que du beau drap, avec de la dentelle brodée d’un autre fil littéraire que celui des académiques naphtalinés…
[À suivre…]
Charles Illouz
Littérature

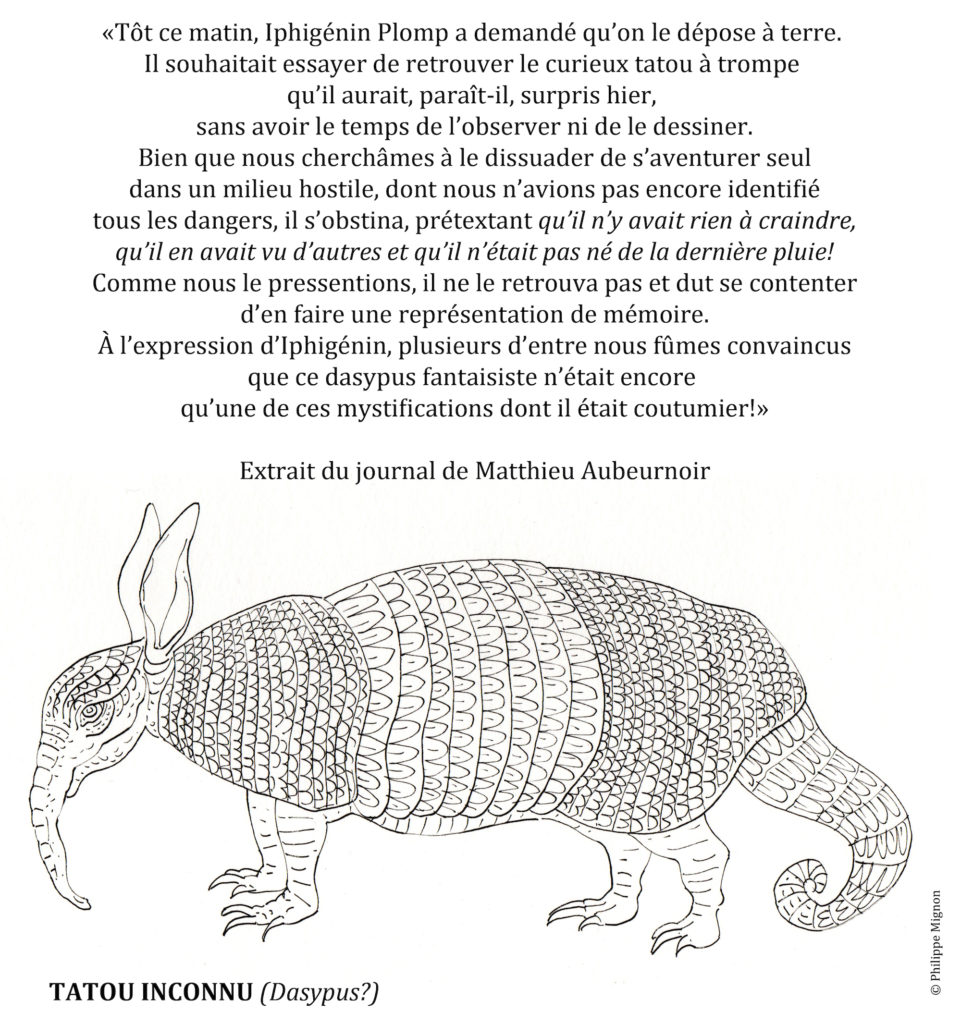






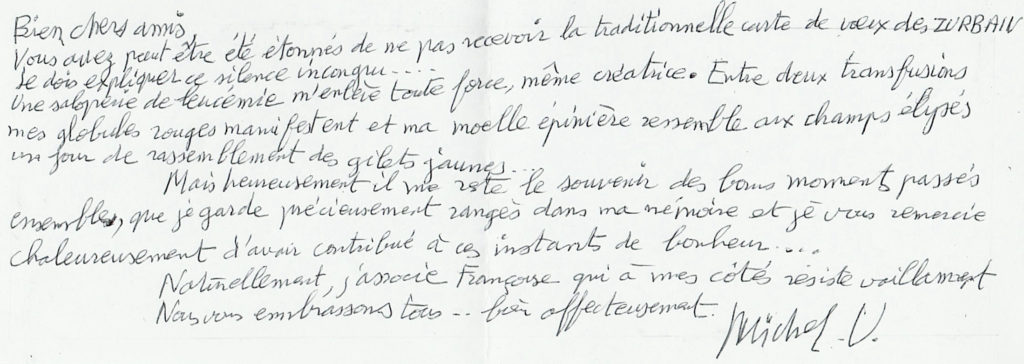
0 commentaires