
© Pascal Victor/ArtComPress
De sa traduction d’Eugène Onéguine, parue en 2005 chez Actes Sud, André Markowicz déclarait aux Assises de la traduction littéraire d’Arles en 2011, que c’était « ce qu’il a fait de mieux dans [sa] vie ». Il disait aussi : « Eugène Onéguine est le plus grand livre jamais écrit en langue russe. Il n’y a pas besoin de discuter, c’est comme ça. » Les 5 523 vers du roman de Pouchkine lui auront demandé plus de vingt ans de travail. Et pourtant, tous les Russes vous le diront, Pouchkine c’est facile : pas de mots compliqués, pas d’images alambiquées. Quand l’auteur écrit : « Le soir, déjà ; son traîneau glisse, / Si vite qu’il effraie les gens ; / Le givre luit sur sa pelisse / Et tremble en poussière d’argent », il n’y a rien d’autre à comprendre. Mais pour faire que cela glisse aussi en français, quel boulot. Dans son Roman russe, paru en 1887, l’écrivain diplomate Eugène-Melchior de Voguë notait : « Traduire cette langue de diamant est une gageure à rendre fou de désespoir. »
Premier problème, la forme : une suite de strophes de quatorze tétramètres iambiques, des octosyllabes rimés. Comme plusieurs de ses prédécesseurs, Markowicz a choisi de coller en français à la structure originale en russe. Moins solennel que l’alexandrin, l’octosyllabe est le vers des fabliaux du Moyen-Âge, du Testament de Villon – « Au temps de ma jeunesse folle » –, et du « Mignonne, allons voir si la rose » de Ronsard. La Fontaine en use volontiers dans ses Fables –« Si ce n’est toi, c’est donc ton frère » –, et Hugo y a recours dans les Contemplations – « Mon bras pressait ta taille frêle / Et souple comme le roseau » ; sans compter d’innombrables chansons populaires – « Il était un petit navire »…
Une chansonnette qui serait un roman : c’est l’autre gageure du texte. Personnages, lieux, intrigues, tout s’enchaîne imparablement, sans autres digressions que les adresses au lecteur. Parties descriptives – Pouchkine n’en abuse pas –, quiproquos, rebondissements : rien ne manque. S’y ajoutent un permanent mélange des genres – comédie, mélodrame, tragédie –, les clins d’œil plus ou moins cryptés à d’autres textes (Don Juan de Byron). Plus la dimension prémonitoire : le duel au cours duquel Onéguine tue son ami le poète Lenski est une description assez exacte, avec dix ans d’avance, de la propre mort de Pouchkine.
Le tout sous la forme de « strophes frivoles », comme le rappelle l’auteur à la fin du roman. La traduction d’Eugène Onéguine n’a pas rendu André Markowicz fou de désespoir. Mais elle l’a ramenée vers son enfance : un texte que, dit-il, il a entendu dès le berceau. Dans la longue liste des classiques russes qu’il a traduits pour Actes Sud, pas sûr que ce qu’il a « fait de mieux dans sa vie » figure en tête des meilleures ventes (on imagine que Dostoïevski a plus de lecteurs en français que Pouchkine). Mais le livre n’a pas cessé de vivre. Il y a deux ans, il en a proposé une version audio parue aux éditions Thélème. Avec le texte original enregistré en russe par sa mère, Daredjan Markowicz, et la version française dite par lui-même et par Françoise Morvan.
Le spectacle mis en scène par Jean Bellorini, directeur du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, ranime encore la flamme. À peu près pas de décor, deux gradins mobiles, un dispositif bi-frontal pour 140 spectateurs, cette adaptation scénique a été conçue pour être installée partout (gymnases, préaux, plein air). On n’est pas très loin d’un théâtre radiophonique : chaque spectateur est doté d’un casque ; les cinq comédiens (Clément Durand, Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, Mélodie-Amy Wallet) murmurent le texte – pas l’intégrale, mais environ les deux-tiers –, qui arrive légèrement amplifié aux oreilles des auditeurs. Il y a aussi des bruitages, un univers sonore qui a pour fil conducteur la musique de l’opéra de Tchaïkovski. Cela pourrait être monotone, ronronnant, c’est magnifique, rayonnant d’humour et de finesse.

© Pascal Victor/ArtComPress
À propos du roman, André Markowicz écrivait aussi dans Partages, journal de traduction publié aux éditions Inculte : « une fois qu’on est entré dans Onéguine, qu’on a, non pas “compris” (il n’y a rien à comprendre, pas de sens caché, rien – tout est à la surface), mais “senti”, alors, vraiment, votre vie change, et vous vivez dans ce sourire, ce sourire d’une tristesse infinie, mais dont émane une lumière étonnante : quelque chose d’intime (je veux dire que ça parle à chacun de nous différemment, selon sa vie, son enfance, ses propres souvenirs) et de totalement universel. Et, je le redis, léger. » Léger : c’est bien ainsi que l’on se sent au sortir du Théâtre Gérard Philipe.
René Solis
Théâtre
Le coin des traîtres
Onéguine, d’après Eugène Onéguine de Pouchkine, traduction d’André Markowicz, mise en scène de Jean Bellorini, Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, jusqu’au 20 avril ; La Criée, Théâtre national de Marseille, du 21 au 25 mai.




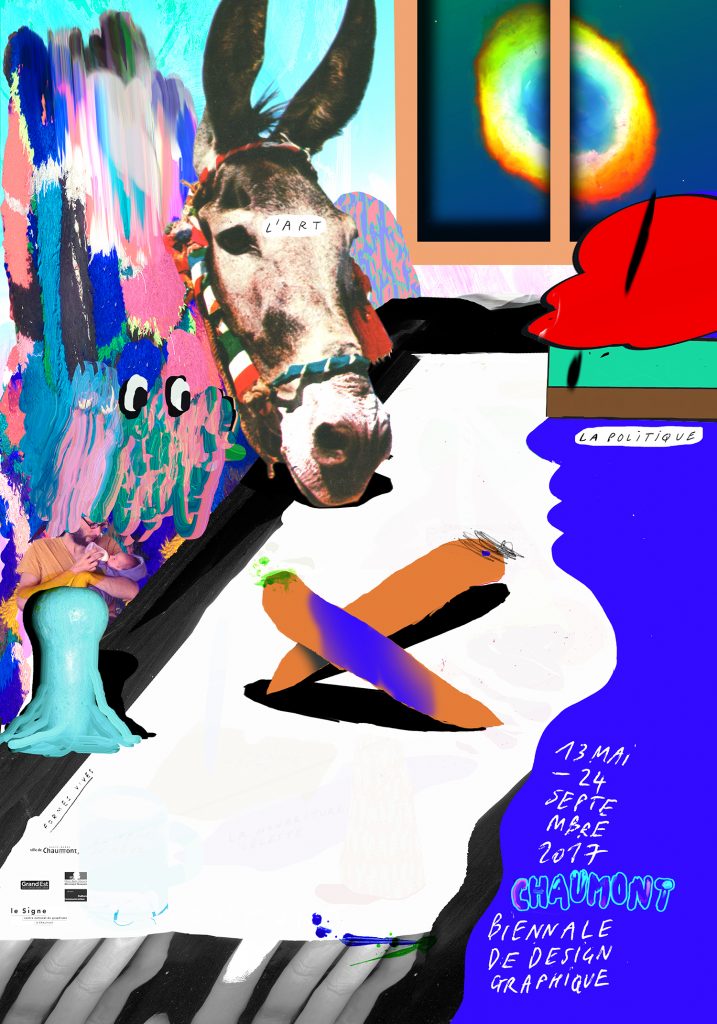



0 commentaires