Machines à voir : un rendez-vous mensuel où les artistes ont recours à la poétique et aux ressources techniques de l’image au format vidéo, version française des Máquinas de visión de la revue Campo de Relámpagos.
Si en 1959 Robert Bresson étonna le monde avec les images de son film Pickpocket, où le personnage principal s’entraîne à devenir un voleur émérite. Dans Prendas corpus (2008), le court-métrage du Cubain Jeosviel Abstengo Chaviano, nous nous étonnons de cela et de plus encore.
Et je ne le dis pas seulement parce que Jeosviel atteint dans son film une froideur et une économie de moyens dignes du cinéaste français (qualités qui se conjuguent notamment dans un film comme Le procès de Jeanne d’Arc -1962), mais parce qu’il parvient à mettre en œuvre, avec des moyens élémentaires (caméra fixe, bruits parasites, « mauvaise qualité », « scénario invisible ») une violence inhabituelle dans sa perception ; une violence clinique, documentaire, étrange, de témoignage ; une violence dont l’efficacité est inversement proportionnelle à la brièveté du film.
Durant ce temps – 9 minutes 21 secondes, approximativement- nous voyons un homme s’attacher de la viande autour de la cheville, une femme mettre de la viande entre ses seins et dans les élastiques de son soutien-gorge, un homme coller un gros paquet de viande contre son abdomen – il fait saillir ses côtes et rentre son ventre pour ne pas être repéré-, un autre homme cacher de la viande sous son pantalon et son long teeshirt, et finalement une femme, curieusement vêtue d’un tailleur, coincer deux ou trois morceaux dans ses parties génitales entre plusieurs serviettes périodiques.
Une opération, appelons-la ainsi, qui parle surtout d’une chose : les différents modes de survie à l’œuvre dans un pays comme Cuba, où la viande de bœuf, pour nous en tenir au récit de Jeosviel Abstengo Chaviano, est symboliquement interdite et où le vol, ou le larcin, ou la corruption, s’exerce à tous les niveaux. Des niveaux qu’il capte* avec une image pauvre -“vu les conditions et le sujet, il n’existe pas de meilleure qualité »-, et avec un bruit de fond où une musique lointaine se mêle au bruit du processus, aussi bien celui consistant à emballer, attacher et cacher la viande, que le ronronnement de l’appareil en train de tourner.
Ces faits se produisent-ils seulement dans les abattoirs ?
Même si le film ne spécifie pas les lieux de tournage (on remarque seulement des différences dans les vêtements et les façons de faire), on peut facilement imaginer que cela peut se dérouler dans n’importe quel lieu faisant commerce de viande : restaurants, hôtels, centres touristiques, entreprises.
Des territoires, comme dirait Genet dans son extraordinaire pamphlet L’enfant criminel, qui sont ceux où la beauté est possible, pas seulement parce que dans ce cas le « citoyen » accède à l’interdit en dépouillant un État qui transforme les individus en pantins malsains (en les privant de toute conscience juridique et de toute illusion), mais parce que ce délit, ce crime, est beau en lui-même.
Politique.
Et il n’y a rien de plus politique quand un être humain est obligé de déployer toute son imagination à la fois pour survivre (sous la censure, sous le despotisme, en prison) et pour se moquer de la classe punitive.
Rien de plus politique quand un être humain se sert de la viande pour devenir une machine à dévorer des policiers.
Carlos A. Aguilera**



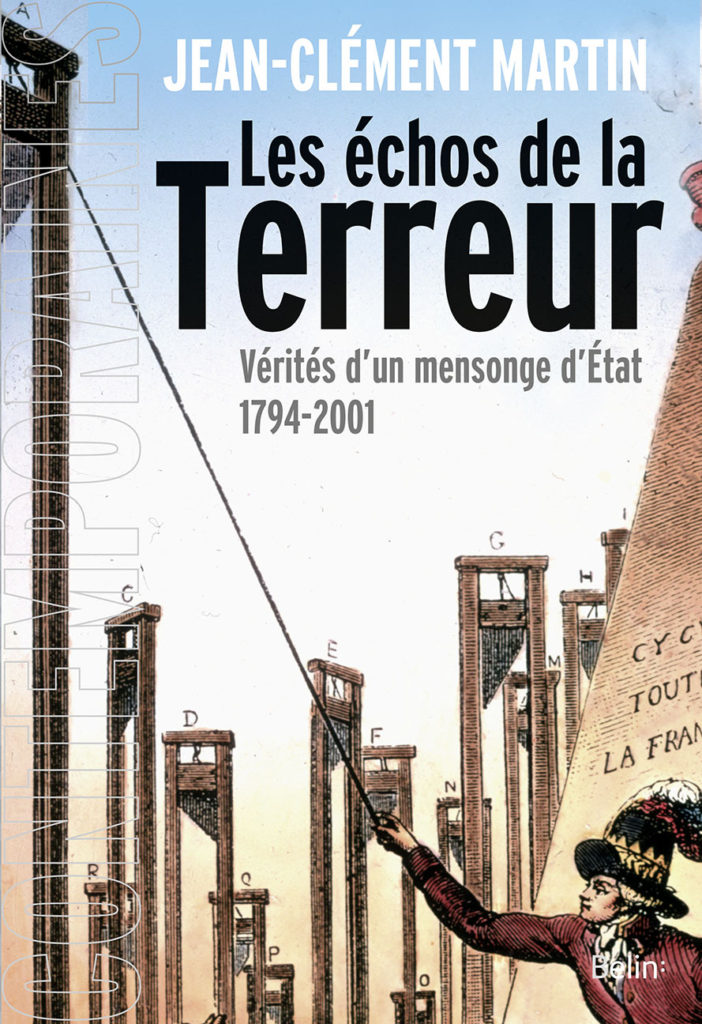





0 commentaires