Depuis 2017, l’écrivaine Marie Cosnay s’est engagée dans l’accueil des réfugiés qu’elle rencontre à la frontière entre la France et l’Espagne, à Bayonne où elle vit. Son dernier livre Des îles, Lesbos 2020 Canaries 2021, publié aux éditions de L’Ogre, documente ce qui se passe sur ces îles que la politique migratoire de l’Europe transforme en prisons et témoigne des voyages qu’accomplissent les enfants qui partent, ceux qui arrivent mais aussi ceux qui n’arrivent pas. Entretien.
Les enfants mis en danger par la politique migratoire de l’Europe sont au cœur de ton livre. Est-ce que la parole de ces enfants, que tu rapportes dans Des îles, te semble écoutée ?
Il faut distinguer les mineurEs non accompagnéEs, qui sont des adolescentEs, et les enfants plus jeunes qui arrivent avec leur parents ou qui les rejoignent. C’est la parole des adolescentEs et des jeunes adultes qu’on entend dans mon livre. En Europe, il y a autour des mineurEs isoléEs pas mal de bruit. Bien sûr, en France comme en Espagne, des propos stupides et violents sont dits à des fins politiques, qu’on ne répétera pas. Mais, du côté des défenseurs des droits fondamentaux, la lutte n’est pas vaine. Ce n’est pas une lutte aboutie mais c’est une lutte qui se fait entendre dans les milieux de résistance à la politique actuelle concernant les migrations. Il faut souligner l’immense nécessité et l’efficacité du travail des avocats mais aussi des collectifs qui se sont formés partout et échangent des pratiques juridiques de résistance au refus de protéger l’enfance isolée. Aujourd’hui les collectifs sont peut-être fatigués mais sont toujours au travail. Philippe Aigrain [1], auquel nous devons tant, me disait qu’on ne peut pas lâcher un droit fondamental comme celui à être protégé quand on est mineurE. On est un enfant, un mineur, jusqu’à 18 ans. Cependant, je pense qu’il ne faut pas sacraliser la date de naissance. À 19 ans, à 20 ans et même à 25 ans, on a une certaine forme de fragilité et donc ce droit à la protection qui n’est pas moins nécessaire. Les jeunes qui arrivent peuvent avoir seize ans et avoir travaillé au Maroc, travaillé dans des usines de poissons, traversé le désert… Ils ne sont pas si fragiles, ou plutôt, ils ne se réduisent surtout pas à leur fragilité mais ils doivent être protégés.
Tu écris au sujet de ton livre qu’il est « une façon de faire l’histoire de ce phénomène muet de notre XXIe siècle, la disparition de populations. » Les gens racontent, témoignent, qu’est-ce qui est muet ?
Ce que je pense silencieux, invisible et inaudible c’est la mort, notamment en mer et dans l’océan. Personne n’en parle. En Europe, c’est un sujet qui n’existe pas. À Hendaye, trois Algériens ont été tués par un train -, mais surtout par la politique des frontières. Ce n’est pas un accident. On sait bien que tout le monde marche sur les voies ferrées la nuit parce que c’est le moyen de passer et de ne pas se perdre, on sait aussi que c’est très dangereux. Mais on a dit que les trois hommes s’étaient presque suicidés en s’endormant sur les voies. S’endormir ? C’est ridicule, dit ainsi. C’est insuffisant. (Lire un billet du blog de Marie Cosnay au sujet de ces trois hommes : victimes de la frontière basque)
Tu as travaillé à partir d’un ensemble de matériaux divers. Comment as-tu composé le livre pour conserver cette diversité tout mettant au jour l’unité des différents discours ?
Je voulais partir de ma frontière, des rencontres que je fais ici à Bayonne. Mon idée était de documenter la route par l’Espagne. L’Algérie, le Maroc et les Canaries. Et puis nous est arrivée la pandémie. Le projet s’est alors remanié autour des paroles échangées de personne à personne : nos dialogues devant la maison des bords de l’Adour et nos dialogues à distance qui ne sont pas moins forts et chaleureux. Je suis allée sur les lieux. Je voulais qu’il y ait une comparaison entre deux îles situées aux bords de cette Europe empêchée, cette forteresse. Border le livre géographiquement de deux îles aux problématiques différentes et entre les deux, des paroles, tout ce qu’on peut entendre si on écoute. La composition en petits paragraphes correspondait assez à des périodes, à des blocs d’observation à Lesbos et aux Canaries, à des moments où je suis en quête de personnes disparues. Je me rends compte que ma vie depuis que j’ai pris conscience qu’il y avait un problème dans l’accueil des enfants isolés est une succession de moments en relation avec des événements liés aux autres, à ceux qui arrivent, aux disparus. Ce sont des îlots de ma vie qui se détachent. Heureusement j’écris, ce qui me permet d’être dans une forme de réflexivité, de relation à ce que je fais et de critique aussi. Sinon, ce sont des îles-gouffres, ce sont des gouffres.
L’île est un motif chargé de symboles, mais les îles dont tu parles sont réelles et précisément situées sur des cartes qui figurent dans le livre. Comment penser cette double strate de la réalité géo-politique et du symbole ?
Il y a bien sûr la métaphore, mais je crois beaucoup à la précision même si je suis quelqu’un qui aime aussi le flou, c’est le paradoxe. Je crois que ce qui va nous sauver, éthiquement, c’est d’être infiniment précis et d’être proche de chaque petit détail dans le parcours d’une personne qui voyage. Situer géographiquement, c’est redonner de la précision, du réel.
Ces îles sont devenues des prisons, avec un emboîtement de lieux d’enfermement, les camps et à l’intérieur les tentes de confinement depuis l’épidémie de COVID…
Oui, ce sont les poupées russes de l’enfermement, avec en plus les barrières sous-marines. À force de dresser des barrières, des murs et des centres fermés, les autorités ont réussi à couper les habitants des îles des réfugiés. Les Canariens sont remarquables depuis deux ans et demi. Mais comment les habitants des îles peuvent-ils accueillir, si leur maison est une prison ? Ils n’ont même plus de territoire, parce qu’un territoire qu’est-ce que c’est sinon ce que tu peux partager ? C’est rien. Les habitants des îles sont réduits à l’impuissance. Et ils ne le supportent pas. Quand on ne supporte pas quelque chose et que malgré tout on n’a pas les moyens de s’y opposer, pour pas devenir fous on va finir par supporter l’insupportable. À force de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir la puissance pour inverser les choses, les populations finissent par s’accorder à ce contre quoi elles ne peuvent pas lutter et ça peut donner le pire.
Le voyage comme aventure et comme recherche de soi a aussi une dimension mythique. Les hommes et femmes qui font le voyage sont considérés ou se considèrent comme des héros. Le recours au mythe peut-il aider à comprendre ce qui se passe aujourd’hui autour de la Méditerranée ?
Le mythe, l’épopée ce sont nos représentations. Je ne peux pas m’empêcher de retrouver dans les récits qu’on me fait de ces grands voyages des échos ou des ressemblances avec d’autres grands voyages qui ont été racontés. Je viens de cette culture, et ça m’intéresse de mettre le lointain à la hauteur du proche, l’antique à la hauteur du contemporain. Mais je ne crois pas que le mythe puisse être une grille, si on s’en sert comme ça, ça empêche de comprendre. Le mythe n’a jamais aidé personne à comprendre, au contraire, il écrase, il enrobe, il fait des paquets. Les gamins qui voyagent font référence aux films hollywoodiens d’aujourd’hui. Ils sont nombreux à dire ou à écrire : à ce moment de mon voyage, je me suis retrouvé exactement comme dans tel film que j’ai vu. Avec l’étrangeté à soi-même, ne pas être vraiment soi-même mais l’autre qui aurait pu être dans une fiction. Ils se disent héros ou même messie ou messager : c’est de l’ordre du survivant et du témoin.
Ton livre est tissé de nombreux récits, quel est le statut de ces récits et leur relation à la « vérité » ?
C’est très compliqué de dire quelque chose de soi. Qu’est-ce que c’est la vérité ? On part pour des raisons dont on n’a pas conscience, on peut raconter les raisons dont on a conscience parce qu’on se les raconte comme ça ou celles dont on pense que les autres vont les comprendre, ou les accepter. Les causes du départ, sauf si tu as fui la prison ou la bombe, sont nombreuses, floues et invisibles à tes propres yeux. Des récits de soi, il y en a peu dans le livre : celui un peu moqueur d’Hamidou dans lequel il me donne tout ce que je pourrais attendre d’un bon récit. Il y a le long récit de Denis, Camerounais d’Abidjan, qui veut témoigner et qui raconte son parcours dans les années 2005-2007 en disant qu’il a fait ce voyage pour écrire, pas pour avoir une vie meilleure mais dans une optique journalistique. Nous allons publier son roman épatant dans la collection « Ces récits qui viennent », chez Dacres.
La question de l’identité traverse le livre, tu parles des « je multiples et multipliés ». L’identité que l’on doit dissimuler ou qu’il faut modifier ou qu’il faut faire reconnaître. Est-ce qu’une relation nouvelle à l’identité se dessine à travers ces migrations ?
La plupart du temps, il faut échapper à l’identification comme aux radars et à tout ce qui peut reconnaître. On n’échappe plus à la prise d’empreintes. Aux Canaries, quand on arrive avec un enfant, on n’échappe pas aux tests ADN. Mais on fait tout pour y échapper et ça crée des espaces, comme au Sahara occidental, qui ne sont pas des espaces de disparition parce que les gens peuvent communiquer mais qui sont des espaces d’immense illégalité où communiquer avec le monde officiel, le monde légal est difficile et dangereux. Avant, il ne fallait surtout pas partir avec son passeport parce qu’on pouvait être identifié et renvoyé dans le pays. Aujourd’hui le danger semble être moins celui-là que celui de ne pas être identifié quand on est mort, que la famille ne le sache jamais. L’enjeu va être de partir de manière à être identifiable mais à pouvoir se désidentifier quand on le veut. C’est comme les poupées russes de l’enfermement, les poupées russes de l’identité.
Marcel Cohen, quand il décrit notre monde au basculement des deux siècles, dit de l’identité qu’elle est une « illusion d’optique », que « l’histoire personnelle n’est plus ce qui détermine une vie. Les événements dépassent (les gens), ils sont tout entiers dans l’instant qu’ils vivent. »
Il y a des îles. Moi-même, j’ai l’impression, peut-être par mimétisme mais surtout parce que je m’intéresse à des moments de la vie des autres, de ne plus avoir de linéarité.
En lisant ton livre, on ne peut s’empêcher de penser aux crimes de masse qui ont marqué l’histoire notamment les génocides du XXe siècle mais aussi la traite, le bateau négrier, le « trou noir de la cale » qu’évoquait Aimé Césaire. Tu utilises un vocabulaire qui évoque cela : camps, convois, déportations, unités. Comment comprendre ces mots dans le contexte des migrations ?
C’est le vocabulaire « boza » (victoire), employé par les personnes elles-mêmes. Tout le monde parle de convoi pour désigner les bateaux qui partent. Les camps, bien sûr depuis longtemps et dedans les unités, les blocs comme dans les camps militaires. Denis Mvogo dit que les corps, il faut les faire maigrir pour les rentrer plus nombreux dans le bateau, faire rentrer un plus grand nombre d’unités. Les corps sont rendus à leur biologie et à une sorte d’efficacité. Mais tout ceci, c’est pour vivre et non pas pour mourir. C’est ce qui nous empêche de parler de meurtre de masse, parce que les gens partent d’eux-mêmes et parce qu’ils veulent vivre. Quand avec mon ami, nous allons parler aux policiers sur les ponts, dans les bus qu’ils contrôlent à chaque instant pour faire descendre les personnes noires, et qu’avec calme on leur dit : vous savez que le fait que vous soyez là 24 heures sur 24 a des conséquences directes sur la vie des gens parce qu’ils vont se mettre en danger pour passer quand même la frontière. On ne leur dit pas ce qu’ils ont à faire, on leur rappelle les conséquences, pour s’en souvenir. Hier, ça m’a complètement glacée, un jeune policier m’a répondu : Madame, dans la vie faut être en règle. Ce discours-là, c’est un discours qui se protège. Il faut être en règle, je lui dis : oui, avec soi-même. Et des femmes me disent : mais laissez-les donc faire leur travail ! Comme si elles s’effrayaient que j’ose penser les conséquences de ce que ce qu’on est en train de vivre.
Propos recueillis par Juliette Keating




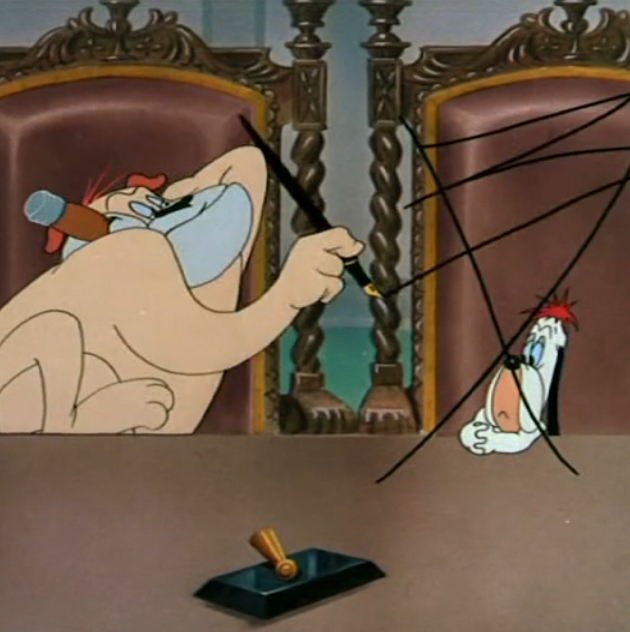
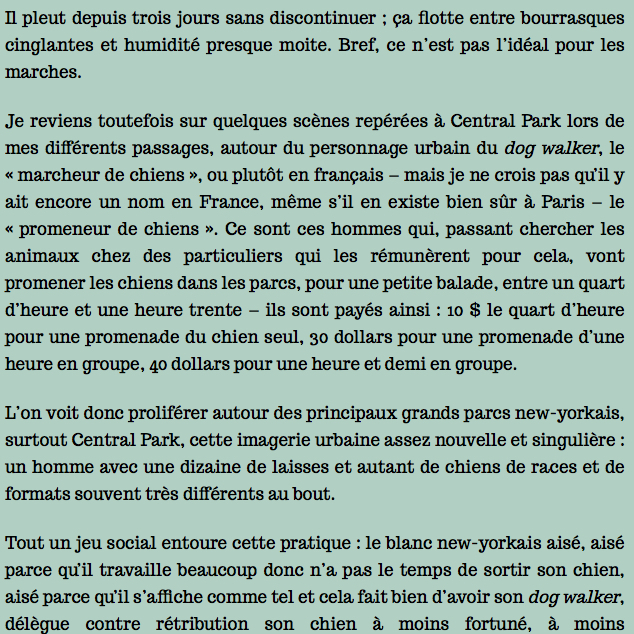



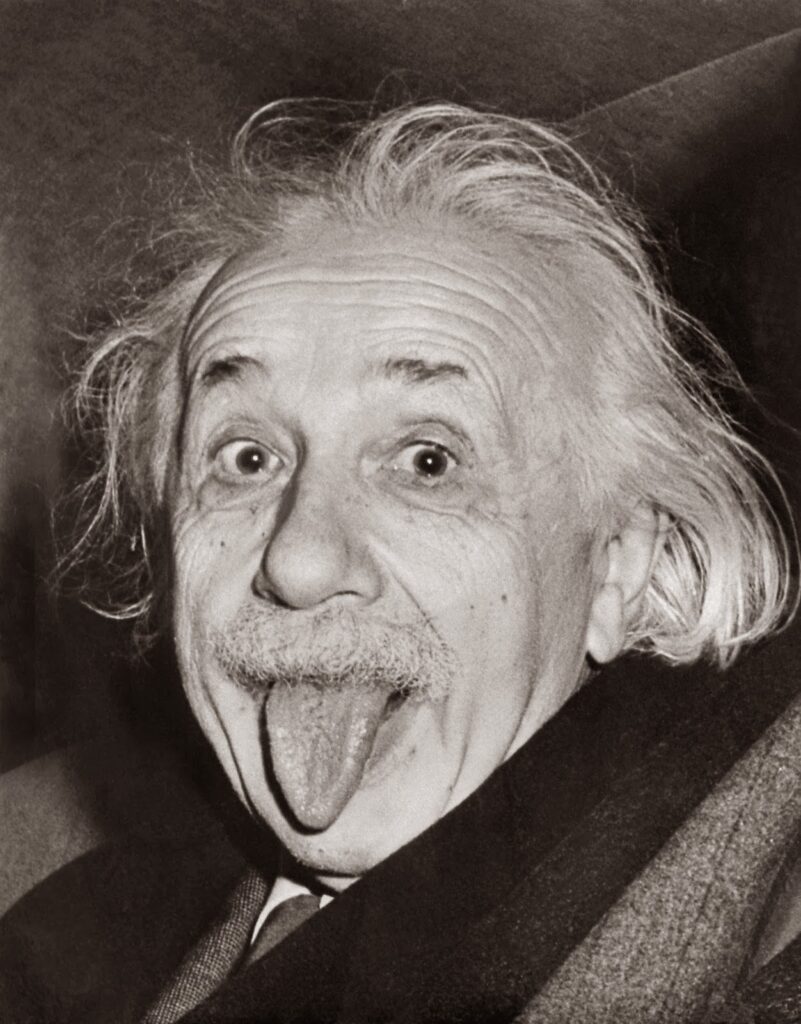
0 commentaires