 En trente-six ans d’existence, le festival Montpellier Danse a volontiers mis le cap au sud. Le directeur Jean-Paul Montanari, de par ses origines méditerranéennes –il est né en Algérie–, a toujours ouvert la manifestation aux chorégraphes du monde arabe, du continent africain de l’Afrique du Sud à l’Afrique du Nord, et d’Israël. Il a insisté, les accompagnant dans leur professionnalisation, et l’édition 2016, qui s’est achevée le 9 juillet, est le reflet d’un bouillonnement certain, du surgissement d’une danse traversée et concernée par les tragédies de l’époque (l’homophobie grandissante, la montée des fascismes, la crise économique, la revendication de cultures ignorées ou méprisées par l’Occident, la question des migrants, des réfugiés et de l’exil).
En trente-six ans d’existence, le festival Montpellier Danse a volontiers mis le cap au sud. Le directeur Jean-Paul Montanari, de par ses origines méditerranéennes –il est né en Algérie–, a toujours ouvert la manifestation aux chorégraphes du monde arabe, du continent africain de l’Afrique du Sud à l’Afrique du Nord, et d’Israël. Il a insisté, les accompagnant dans leur professionnalisation, et l’édition 2016, qui s’est achevée le 9 juillet, est le reflet d’un bouillonnement certain, du surgissement d’une danse traversée et concernée par les tragédies de l’époque (l’homophobie grandissante, la montée des fascismes, la crise économique, la revendication de cultures ignorées ou méprisées par l’Occident, la question des migrants, des réfugiés et de l’exil).
Tous les chorégraphes ont visé dans le mille, sans trop se soucier de formater leurs spectacles pour plaire ou être dans l’air du temps. Les formes sont en effet plutôt libres, insoumises, échappant à la morosité ambiante qui semble justifier tous les retraits, les mises en sommeil et les coupes budgétaires. Ce qui arrive du Sud, dans les aller-retour permanents avec l’Europe, est tonitruant.
Robyn Orlin, Sud-Africaine, aujourd’hui installée à Berlin, a été rattrapée par son pays d’origine, choquée par une politique post apartheid qui met à mal une constitution pourtant l’une des plus progressistes du continent africain. Devant l’homophobie qui gagne du terrain, notamment avec une pratique sadique et criminelle, “le viol correctif”, qui consiste à violer les lesbiennes et les gays, sans que le gouvernement et la police ne s’en émeuvent, elle s’est mise à l’écoute d’une nouvelle génération confrontée à ces violences. Un jeune artiste, danseur, acteur et guérisseur, Albert Ibokwe Khoza s’est présenté sur son chemin. Lui-même homosexuel noir avec un corps très féminin, voluptueux, de cette génération des vingt ans rebelle, cultivée et positive, il ne pouvait que tomber dans les bras de Robyn Orlin, la blanche osseuse et angulaire. Le solo qu’elle lui a écrit sur mesure And so you see…our honourable blue sky and ever enduring sun…can only be consumed slice by slice…, plutôt queer et structuré à partir des sept péchés capitaux, a l’intelligence de présenter le performer de dos et de nous le faire voir grâce à son image projetée en caméra directe. Elle nous le donne à aimer.
Du sud également, cette fois de l’Amérique, du Brésil, Lia Rodrigues infiltre les spectateurs disposés sur le plateau avec une troupe d’indigènes qui viennent nous fixer comme si nous étions l’attraction du zoo humain. La situation inversée dès le départ, le spectacle Para que o céu não caia (Pour que le ciel ne tombe pas) est plutôt une performance à laquelle tous participent puisque nous sommes réunis dans un même espace et de plain-pied. Se référant aux propos d’un chaman du peuple Yanomami vivant au cœur de la forêt d’Amazonie qui raconte comment réinventer son propre ciel après un génocide, la chorégraphe (qui termine le spectacle le poing levé en dénonçant le putsch au Brésil) met en scène des guerriers et guerrières. Recouverts tout d’abord de café, couleur terre, puis de farine, couleur masque, et enfin de curcuma couleur soleil, les danseurs invoquent les cieux et nous entraînent dans une danse tribale martelante. Avec juste ses poudres colorées et odorantes – tout le décor doit tenir dans deux sacs de voyages – Lia Rodrigues lance un appel politique. 
Dans Farci.e, la jeune Iranienne Sorour Darabi, femme à barbe, propose une performance sur le genre. Avançant jusqu’à une table de travail, seul élément de décor, elle se présente de profil et gauchement comme si elle voulait cacher son sexe. Elle donnera une conférence sur la langue française qui désigne tout, même les objets, au féminin ou au masculin, alors que dans sa langue maternelle le farsi, il n’y a pas de différenciation. Pas un mot ne sort de sa bouche, les bras et les jambes reproduisent non sans humour les tics des conférenciers jusqu’au moment où, n’en pouvant plus de tourner les pages de son intervention, elle fait de ses écrits du papier mâché, qu’elle mâche effectivement et qu’elle avale.
Quant aux hommes, ils ne sont pas en reste. L’Iranien Ali Moini, lui aussi en partie installé en France, prend le rôle d’une marionnette. Inventant un dispositif scénique efficace autant pour sa plastique que pour la manipulation en direct, il dialogue avec son double, son avatar de même dimension que lui. L’avatar est tout d’abord un squelette de fragments métalliques. Puis, il devient presque humain, du moins un écorché vif à la Francis Bacon, le danseur l’habillant de morceaux de viande rouge. Man anam ke rostam bovad pahi avan est également une réflexion sur un possible contre-pouvoir face à la supposée toute puissance des logiciels et de l’intelligence virtuelle. Ali Moini dans cette performance très physique pointe par exemple les erreurs de traduction.

Ali Moini ©DR
Salia Sanou, Burkinabè, a, dans le cadre du programme de l’AAD (African Artist for Development), travaillé depuis l’automne 2014 dans les camps de réfugiés maliens de Sag-Nioniogo au Burkina Faso, introduisant la danse dans un espace d’attente, de désœuvrement et de violence. Fortement ému par cette expérience, il a écrit un spectacle, Du désir d’Horizons, pour huit danseurs et deux réfugiés. Mais les réfugiés qu’il a réussi à faire sortir du camp pour les emmener jusqu’à la Termitière, centre de développement chorégraphique de Ouagadougou qu’il dirige avec Seydou Boro, n’ont pas obtenu leur visa pour participer au spectacle. Leur absence habite le plateau alors que les interprètes errent, s’immobilisent, se chopent brutalement. Les lits qui organisent la scénographie sont autant le lieu de retranchement sur ce qu’il reste d’intime que des lignes qui définissent les frontières. Renvoyant à un texte de Nancy Huston Limbes/Limbo, un hommage à Samuel Beckett, le spectacle élargit son propos sur tous les étranges étrangers et sur l’exil intérieur.

© Laurent Philippe
Tout autre univers encore avec Radhouane El Meddeb, chorégraphe tunisien qui en 2008 a obtenu la nationalité française, symbole pour lui de liberté. Dans ce nouveau solo À mon père, une dernière danse et un premier baiser, il invente une danse de dos pour mieux s’adresser à ce père parti alors qu’il était absent. N’ayant pu lui faire ses adieux, il les danse presque sur un seul point de la scène recouverte en partie d’un tableau blanc, alors que le cadavre blanc gît à côté du monochrome. Longue prière silencieuse qui s’étire par les bras, qui s’arrondit par le dos, cette danse est très touchante. Il nous manque juste un petit passage pour entrer dans cette cérémonie.

© Tarek H.Slama
Ce que nous offre Nacera Belaza avec un trio étourdissant qui reste le moment le plus fort du festival. Depuis des années et sans se décourager, même si ses spectacles dits trop austères, ne séduisaient guère les programmateurs, elle creuse un sillon clandestin. Elle résiste à tous les clichés renvoyés à la femme arabe. Et rétablit le sens que certains ont pour elle : “Dans cette période de terrorisme, il faut faire attention aux mots. Je peux dire que le mot djihad a un vrai sens pour moi, tel qu’il est défini dans le Coran : c’est la lutte contre soi-même, contre son propre souffle, en fait c’est une introspection permanente. C’est ce que je pratique, pas autre chose, le jihad est un outil de travail qui m’a construite”. Nacera Belaza, avec sa double culture, devait fatalement nous subjuguer un jour. C’est fait. Sa pièce Sur le fil est un choc, esthétique, physique, tellurique. Elle révèle le plus intime d’une femme confrontée aux regards pour le moins méprisants de ceux qui voudraient la juger, la jauger. Sauvage, dans ses habits apparemment asexués comme ceux des deux jeunes danseuses embarquées dans l’histoire (Aurélie Bertrand et Anne-Sophie Lancelin), elle atteint un niveau d’absence de soi qui étonne, surtout aujourd’hui où les egos surdimensionnés par rapport au manque de propos nous laissent froids, voire frigides.
Elle n’est que danse. On pense à Lucinda Childs, version noire et plus expressionniste, mais aussi minimaliste. Elle déboule sur le plateau comme si elle sortait déjà d’une transe festive. Elle relie le ciel à la terre, telle un éclair qui déchire la nuit. Et Aurélie Bertrand et Anne-Sophie Lancelin la relaient dans ce mouvement à perdre la tête. Une prouesse pour elles deux car, il faut saisir le rapport au sacré que Nacera Belaza impose par le martèlement des pieds, si souples. Disparition dans la nuit des temps, réapparition furtive où l’on ne sait plus qui est laquelle : elles vont au plus profond de l’être, sur un fil, d’un souffle.
Marie-Christine Vernay
Danse
[print_link]







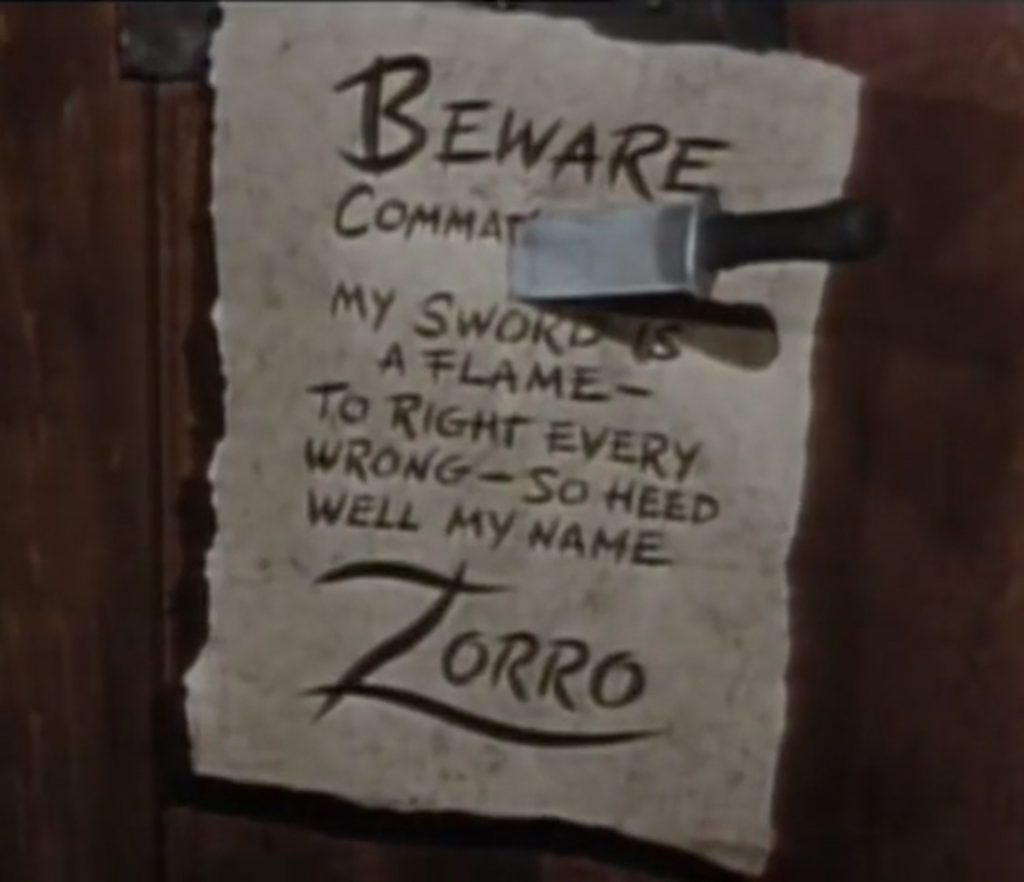


0 commentaires