Le coin des traîtres : pièges, surprises, vertiges, plaisirs et mystères de la traduction…
« D’habitude, je ne reçois personne, je reste invisible et muet, assigné à résidence exiguë, relégué sous terre. Là-haut, à l’air libre, au-dessus de cette barre, de ce couvercle étanche pour moi infranchissable, je suis certes partout présent, mais sur un mode que je ne comprends pas très bien moi-même, sous une forme bizarre, ectoblastique et contrainte. J’évolue incognito, désincarné, fantôme obéissant et fidèle comme l’ombre demeure rivée au corps, coulé depuis toujours dans le moule de l’autre, de ce voisin bruyant qui s’exhibe en pleine lumière, de ce grand escogriffe à qui tu venais rendre visite, mais qui a soudain disparu sans laisser d’adresse. »
Brice Matthieussent, Vengeance du traducteur
Dans un texte consacré à la la traduction vue comme « un autre livre », selon les mots de Thomas Bernhard, Olivier Mannoni brossait il y a quelques semaines un tableau du « traducteur en spectre et en auteur », en « écrivain de l’ombre ». Mais dans quel recoin obscur, cave ou placard ce fantôme est-il tapi ?
Il existe un espace réservé au traducteur, un territoire où il règne en maître, où il signe en son nom ou presque : « (N.d.T.) ». La note du traducteur, ou de la traductrice, ou de traduction si l’on rechigne à user du féminin sans pour autant se résoudre à la domination masculine. Ce paraphe générique, Brice Matthieussent l’a décliné jusqu’à l’absurde dans sa Vengeance du traducteur [1], de la« Nuit du Taiseux » ou « Nuit du Terrifié » au « Nord du Transparent », en passant par la « Nuisance du Taraudeur », la « Nosographie du Tripatouilleur », la « Nasse du Tricheur », la « Nique de Tarzan », sans oublier, bien sûr, la « Nuit du Tasseur ». Faisant de cette note de bas de page – souvent prise pour un aveu d’échec – l’espace rêvé pour un roman qui semble s’écrire sous nos yeux. Nous y reviendrons.
Aveu d’échec, la note du traducteur ? N’allons pas trop vite en besogne. Pour commencer, la (N.d.T.) s’adresse au lecteur. Et tous les lecteurs ne se ressemblent pas. De même, toutes les (N.d.T.) ne se ressemblent pas. Certaines, souvent dites savantes ou érudites, viennent apporter des éclaircissements sur le texte original. D’autres, il est vrai, sonnent comme une défaite du traducteur. Le fameux « jeu de mots intraduisible » est même devenu un cliché, comme le souligne la traductrice et traductologue Jacqueline Henry [2].
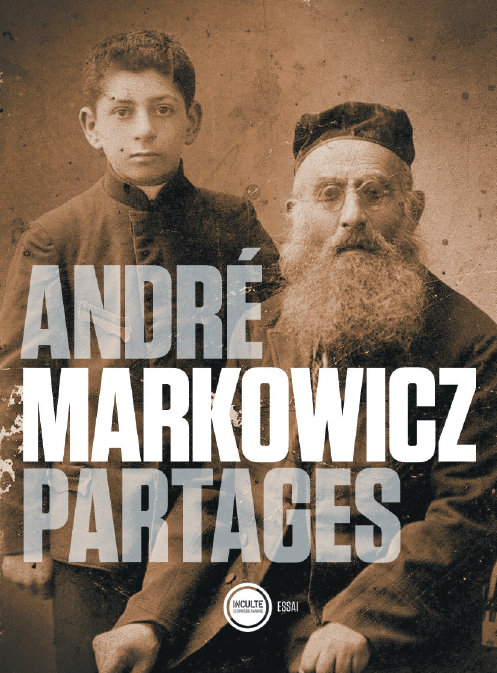 Pourtant, cet espace, aussi restreint soit-il, peut s’avérer une aubaine, une occasion pour le traducteur de signer si ce n’est en son nom, du moins en sa qualité de traducteur. Au point que, parfois, la note enfle et déborde du bas de page auquel elle est généralement confinée. André Markowicz est en cela un traducteur hors norme. Ses notes de traduction, il les rédige et les donne à lire au fur et à mesure qu’il traduit, comme un journal de bord régulièrement partagé, car il les publie sur Facebook. Les éditions inculte ont eu l’excellente idée de publier ces chroniques sous le titre Partages [3], dont chaque volume (deux ont été publiés à ce jour) rassemble une année de chroniques sur Facebook, consacrées aux sujets qui lui sont chers : considérations sur la traduction, mais aussi sur l’actualité, « sur la langue, ou les langues, et l’usage qu’on en fait », sur « la dérive identitaire à laquelle nous assistons en Bretagne », et souvenirs de famille.
Pourtant, cet espace, aussi restreint soit-il, peut s’avérer une aubaine, une occasion pour le traducteur de signer si ce n’est en son nom, du moins en sa qualité de traducteur. Au point que, parfois, la note enfle et déborde du bas de page auquel elle est généralement confinée. André Markowicz est en cela un traducteur hors norme. Ses notes de traduction, il les rédige et les donne à lire au fur et à mesure qu’il traduit, comme un journal de bord régulièrement partagé, car il les publie sur Facebook. Les éditions inculte ont eu l’excellente idée de publier ces chroniques sous le titre Partages [3], dont chaque volume (deux ont été publiés à ce jour) rassemble une année de chroniques sur Facebook, consacrées aux sujets qui lui sont chers : considérations sur la traduction, mais aussi sur l’actualité, « sur la langue, ou les langues, et l’usage qu’on en fait », sur « la dérive identitaire à laquelle nous assistons en Bretagne », et souvenirs de famille.
27 juin 2013 : « Je suis très en retard, mais je continue, en même temps que les répétitions de La Nuit des rois (le texte sera envoyé samedi à l’éditeur, Les Solitaires Intempestifs), de relire les épreuves de L’Adolescent de Dostoïevski, pour la réédition en Thésaurus. Et j’attends celles des Frères Karamazov. Le tout devrait paraître, donc, en janvier 2014 (la date est à confirmer). C’est maintenant, dix ans après avoir fini, que je me demande comment j’ai pu traduire tout ça.«
Au récit du travail du traducteur au quotidien viennent s’ajouter des analyses des œuvres traduites et des réflexions sur la traduction :
4 novembre 2013 : « Et tout se cristallise soudain quand Dostoïevski trouve la forme : ce ne sera pas une narration, ce sera un monologue – un monologue immense, sur mille pages, le monologue, pour lui-même (pas pour le lecteur) fait par l’Adolescent, qui est, vraiment adolescent, c’est-à-dire qu’il ne voit que lui-même, pour ne pas dire qu’il ne voit rien du tout. Et façonnant la voix de ce jeune homme, Dostoïevski, soudain, retrouve la voix de ses autres monologues – retrouve leur mauvaise foi, retrouve ce qui fait sa modernité radicale : c’est à partir de lui que la littérature n’est plus de l’ordre de la vérité – elle devient quête aveugle, passionnée, obstinée, d’une image qui se brise à l’instant même où elle se donne à voir. »
Ou bien encore, le 19 juillet 2014, à propos d’une ode d’Horace dont il vient de citer sa traduction : « J’ai essayé de respecter, autant que je pouvais, la syntaxe du texte (le texte latin est naturellement beaucoup plus compliqué – parce que le latin le permet, à cause des déclinaisons). Ce qui est très étonnant, c’est le mètre de ces distiques, et donc, l’inversion progressive (si vous lisez un peu à haute voix) : ça commence par une suite de dactyles (– (u) u), puis, au bout du troisième, ça devient ïambique (u –), c’est-à-dire que le vers se ralentit, comme s’il était une suite de spondées, et le deuxième vers est uniquement ïambique. Du coup, mon impression est celle d’une danse lente – une espèce de danse d’ombres, qui contredit l’agitation supposée du printemps. C’est vraiment un monde qui s’éveille des limbes – de l’hiver, peut-être bien. Qui s’éveille, et revient vers la mort. Traduire cette sensation dans un texte en prose ou en vers libre ? Comment faire ? – Mais comment faire, aussi, pour faire partager cette sensation que j’ai du mètre ? La seule solution que j’aie trouvée, c’est ces chroniques : que mes lecteurs puissent comparer d’autres odes d’Horace. S’habituer, reprendre, à leur guise. »
Et comme André Markowicz lâche rarement l’affaire, il revient dans ses chroniques Facebook sur des chantiers de longue haleine, déjà commentés dans d’anciennes chroniques. On lit par exemple sur son « mur » le 19 mars 2017 : « Avertissement : J’avais, dès que je m’étais inscrit sur FB en été 2013, entrepris une exploration-révision en direct de ma traduction de “Hamlet”, qui est l’une de mes traductions auxquelles je tiens le plus. […] Et puis, je me suis interrompu… J’avais la sensation, réelle, que je n’avais pas trouvé le ton, et que j’allais trop lentement, et que je demandais vraiment trop de mon “bénévole lecteur”… Aujourd’hui, après deux ans de découragement, je me dis que, quand même, si près de la fin, il faudrait vraiment tenter l’aventure d’aller jusqu’au bout. Mais, donc, je vais parler d’une scène que j’ai commencé à étudier… le 20 mars 2015, la scène de confrontation entre Gertrude et son fils à la fin l’acte III. La dernière fois, je venais de tuer Polonius… Pour plus de clarté, je mets en commentaire la référence à cette chronique — même si celle-ci est autonome. » Dont acte : au bas de la publication, le premier commentaire a été posté par André Markowicz, qui cite son post du 20 mars 2015. Il s’approprie ainsi l’un des outils de Facebook pour réinventer la (N.d.T.) : ici note du traducteur au bas de ses notes sur la traduction de Hamlet.
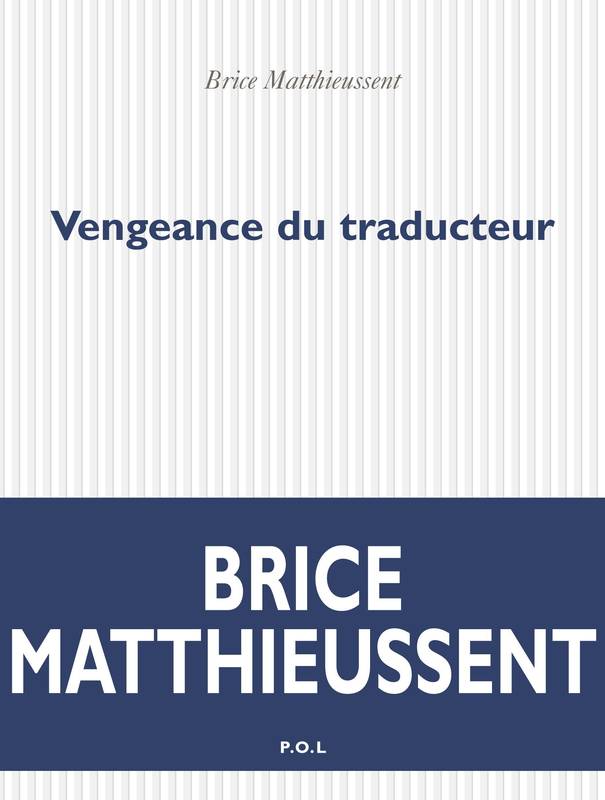 La (N.d.T.) peut donc prendre des formes diverses et ne saurait être réduite à un maigre paratexte précédé d’un astérisque, relégué au bas de la page par une ligne séparatrice. Brice Matthieussent en a même fait un roman. Dans Vengeance du traducteur, le narrateur est un traducteur qui entreprend de faire disparaître le texte qu’il est en train de traduire, dont il rend compte et qu’il commente dans ses notes de bas de page toujours plus imposantes, qui finissent par envahir la page entière. « Est-ce que j’en fais trop ? Suis-je trop bavard ? » Disons qu’il n’a guère le choix, puisque le lecteur n’a accès au texte en question que dans les notes de bas de page, par bribes, allusions ou commentaires. Au point qu’il faut parfois des notes au bas des notes : « ** Il y a tellement de passages, voire de pages entières, caviardées par mes soins dans ma traduction qu’il me faut expliquer un peu l’action du roman. » (Notez le double astérisque pour signaler la note de bas de page au bas de la note de bas de page.) Ah, comme le traducteur lui en veut à cet autre qui « plastronne dans les étages supérieurs », comme il est « ravi de lui clouer le bec ». Alors il en rajoute (chapitre 3), mais surtout il allège : « C’est le cœur léger que je supprime ces deux premiers paragraphes du chapitre 2 » (quitte à remettre en note ce qu’il a fait disparaître). « Et si maintenant je sucrais les adverbes? » se demande-t-il après avoir éliminé les adjectifs de « la prose pataude de [son] auteur ».
La (N.d.T.) peut donc prendre des formes diverses et ne saurait être réduite à un maigre paratexte précédé d’un astérisque, relégué au bas de la page par une ligne séparatrice. Brice Matthieussent en a même fait un roman. Dans Vengeance du traducteur, le narrateur est un traducteur qui entreprend de faire disparaître le texte qu’il est en train de traduire, dont il rend compte et qu’il commente dans ses notes de bas de page toujours plus imposantes, qui finissent par envahir la page entière. « Est-ce que j’en fais trop ? Suis-je trop bavard ? » Disons qu’il n’a guère le choix, puisque le lecteur n’a accès au texte en question que dans les notes de bas de page, par bribes, allusions ou commentaires. Au point qu’il faut parfois des notes au bas des notes : « ** Il y a tellement de passages, voire de pages entières, caviardées par mes soins dans ma traduction qu’il me faut expliquer un peu l’action du roman. » (Notez le double astérisque pour signaler la note de bas de page au bas de la note de bas de page.) Ah, comme le traducteur lui en veut à cet autre qui « plastronne dans les étages supérieurs », comme il est « ravi de lui clouer le bec ». Alors il en rajoute (chapitre 3), mais surtout il allège : « C’est le cœur léger que je supprime ces deux premiers paragraphes du chapitre 2 » (quitte à remettre en note ce qu’il a fait disparaître). « Et si maintenant je sucrais les adverbes? » se demande-t-il après avoir éliminé les adjectifs de « la prose pataude de [son] auteur ».
Dernière étape, franchie dans la deuxième partie du livre : inverser les rôles, franchir la ligne, passer au-dessus de la barre, occuper l’espace désormais vide en haut de la page, laisser à d’autres le soin de traduire son roman, de rédiger peut-être des (N.d.T.). « J’abandonne derrière moi l’astérisque à son triste sort, pour bondir sans regret vers son double supérieur. […] La ligne, barre, assise, support, étagère, sommier, socle, cloison, d’abord plafond et très récemment plancher, tout ça est désormais derrière moi, loin sous mes pieds […]. C’est un vol, un envol, un putsch, un coup d’État, un changement d’état, une métamorphose. L’espace noir de la nuit interstellaire, la page blanche striée de lettres noires sont enfin à moi, rien qu’à moi. »
Christilla Vasserot
Le coin des traîtres
[1] Brice Matthieussent, Vengeance du traducteur, P.O.L., 2009
[2] Jacqueline Henry, « De l’érudition à l’échec : la note du traducteur », Meta, vol.45, n°2, juin 2000.
[3] André Markowicz, Partages, vol.1, juin 2013 – juillet 2014 (inculte, 2015, 444 p.) et vol.2, juillet 2014 – juillet 2015 (inculte, 2016, 614 p.)







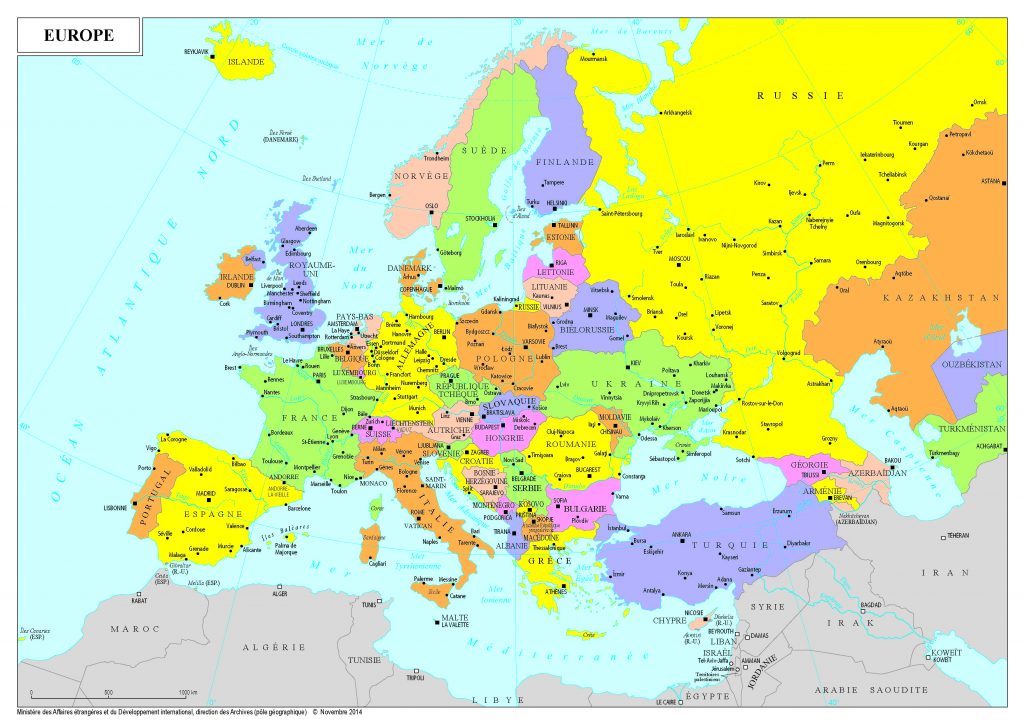


0 commentaires