Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
En mars dernier, devant l’amphithéâtre de la Sorbonne, le CRAN (Conseil représentatif des associations noires) et l’UNEF s’opposaient par la force à la représentation des Suppliantes d’Eschyle au motif que certains acteurs blancs portaient un masque noir : le délit de « blackface » leur semblait établi.
Dans un article du Monde daté du jeudi 4 avril, l’universitaire Anne-Sophie Noel dénonce ce coup de force qu’elle considère avec raison comme un contresens sur les intentions du metteur en scène Philippe Brunet. Les Suppliantes raconte en effet comment les Danaïdes, fuyant l’Égypte où un mariage forcé les attend, sont accueillies à Argos afin de vivre libres. Il s’agit donc d’une pièce sur la tolérance et l’accueil de l’étranger. Le masque noir vient seulement ici rendre visible la différence de l’autre. Ajoutons encore que le port du masque est une constante de la tragédie grecque où les rôles féminins étaient joués par des hommes travestis.
S’élever contre une mise en scène « racialiste » est donc absurde. Anne-Sophie Noel pose alors une question pertinente sur laquelle je voudrais rebondir : « Doit-on juger les œuvres du passé, qu’elles soient progressistes ou non d’ailleurs, à l’aune des errances nauséabondes des esclavagistes américains ? »
La censure exercée par le CRAN et l’UNEF me semble en effet caractéristique d’une tendance lourde de notre époque : le désir de réécrire le passé afin de le rendre conforme à notre sensibilité ou à nos mentalités. Deux exemples très différents illustrent cette tendance. Il y a quelque temps la RATP avait autorisé sur les quais du métro un affichage qui promouvait la réédition d’un film de Jacques Tati mais à la condition d’effacer la pipe que Tati arbore sur l’affiche avec une certaine fierté. Le motif était que cette pipe était un éloge direct du tabac, lequel, comme nous le savons, n’a plus le vent en poupe dans nos sociétés. Il s’agissait en somme de rendre Tati conforme aux critères hygiénistes de notre époque. Le tollé qui s’en suivit contraignit la RATP à réintégrer la pipe délictueuse. Le second exemple qui me vient à l’esprit est un peu plus ancien et moins drôle. Des universitaires et écrivains anglais avaient demandé la mise à l’index de l’œuvre de Joseph Conrad en raison de sa vision coloniale du monde. Par chance ils ne furent pas entendus.
Cette tendance à supprimer (une pipe), à interdire (une œuvre, une représentation théâtrale) rappelle dans un premier temps les pratiques des États totalitaires que George Orwell a si bien décrites dans 1984 où une agence officielle est chargée de réécrire chaque jour le passé en fonction des intérêts présents de l’État. Nous savons que Staline, après les procès de Moscou, avait fait effacer des photos officielles l’image des généraux devenus indésirables. De même les nazis avaient fait retirer des musées les œuvres d’art qu’ils jugeaient « dégénérées » (« Entartete Kunst ») parce qu’elles donnaient une image peu flatteuse de l’Allemagne mais aussi parce qu’un grand nombre d’entre elles avaient été peintes par des artistes juifs. On pourrait ajouter à cette liste le souhait exprimé par Nicolas Sarkozy du temps où il était président de voir enseigner l’histoire de la colonisation « de façon positive ». Enfin lors de la Révolution culturelle en Chine, Mao avait voulu faire du passé table rase.
On voit sur ces exemples qu’un État démocratique, au sens que nous donnons aujourd’hui à ce concept, c’est-à-dire un État au pouvoir limité et respectueux d’un certain nombre de droits fondamentaux, comme la liberté d’expression, doit s’interdire la tentation de réécrire l’histoire.
Ce qui me semble nouveau cependant dans l’affaire des Suppliantes d’Eschyle comme dans les autres cas que j’ai cités est que nous ne sommes pas dans le cadre d’une censure imposée par l’État mais voulue ou plus justement réclamée par la société ou du moins par certaines de ses composantes. Il s’agit là d’un paradoxe au regard de ce que nous appelons traditionnellement le pouvoir de l’État. Celui-ci a en effet pour rôle principal de veiller à la protection des personnes et des biens par l’interdiction d’un certain nombre d’actes jugés nuisibles ou dangereux. Le pouvoir de l’État est donc d’abord un pouvoir de contrôle de la société. C’est d’abord un pouvoir coercitif. Qu’ensuite ce pouvoir puisse et doive veiller à l’application de la justice et au respect des libertés fondamentales est somme toute une évidence relativement récente. C’est d’ailleurs cette évidence qui semble caractériser notre modernité. Or nous assistons depuis quelque temps à un déplacement du pouvoir de coercition : l’État paraît quelquefois (pas toujours bien sûr) plus libre que la société. Ou encore nos lois sont parfois plus libérales que les personnes auxquelles elles s’appliquent. C’est désormais la société qui exerce un contrôle sur ses différents membres. C’est ce que prétend faire le CRAN dans l’affaire citée plus haut, c’est aussi ce que font parfois les médecins lorsque, sortant de leur rôle, ils moralisent leurs patients afin de les orienter vers une vie meilleure, c’est-à-dire plus saine, alors que ces derniers ne leur en demandent pas tant. C’est encore ce que font certaines associations religieuses lorsqu’elles se mêlent de critiquer telle ou telle loi ou lorsqu’elles exercent une pression sur les membres de leur communauté afin qu’ils observent à la lettre les prescriptions des textes saints. Comme le remarquait Foucault dans ses cours au Collège de France, le pouvoir tend à ne plus s’exercer de façon verticale, de haut en bas, de l’État vers la société, mais de façon horizontale : de chacun envers chacun. Nous assisterions ainsi à la mise en place d’une nouvelle forme de totalitarisme, un totalitarisme « mou » car étranger au pouvoir de l’État et à la force des lois.
Cette hypothèse me semble confirmée par la situation algérienne. La question que beaucoup de commentateurs se posent aujourd’hui face à la crise politique que traverse le pays est celle du rôle que vont ou non jouer les islamistes. Ne risque-t-on pas de voir les différents mouvements religieux profiter des manifestations de rue afin de s’emparer d’un pouvoir dont ils ont été autrefois exclus ? Cette question, sans être absurde, oublie néanmoins un point important. Plusieurs analystes affirment qu’au terme de la décennie noire qui a ensanglanté l’Algérie, l’État aurait en quelque sorte passé un deal avec les islamistes : ceux-ci se verraient exclus de tout rôle politique mais ils auraient en revanche les mains libres pour s’imposer au sein de la société. Et de fait aujourd’hui la société algérienne est pour une bonne partie une société religieuse alors que l’État ne l’est pas : la constitution algérienne, si elle fait de l’Islam la religion officielle du pays, ne s’appuie pas pour autant sur la Charia. En ce sens on peut craindre que les islamistes n’aient d’ores et déjà gagné la partie quelle que soit l’issue qu’aura la contestation actuelle.
Pour conclure, je voudrais rappeler quelques maux qui guettent aujourd’hui nos démocraties et qui risquent à plus ou moins brève échéance de les transformer en « tyrannie de la majorité » (Tocqueville) : le moralisme, la bien-pensance, l’hypocrisie religieuse, l’hygiénisme. S’il faut sans doute, et par principe, se méfier du pouvoir de l’État, il est peut-être temps maintenant de passer à l’offensive contre les nouveaux despotes qui se cachent (à peine) parmi nous.
Gilles Pétel
La branloire pérenne



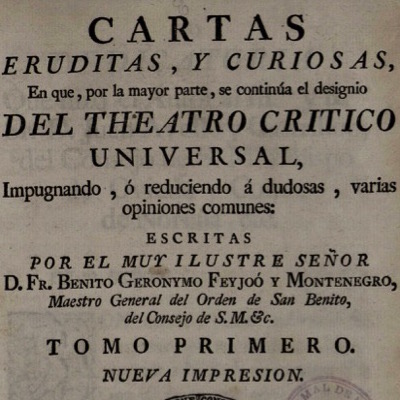




0 commentaires