Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.
Qui a dit “Le concept de réchauffement climatique a été créé par les Chinois dans le but de mettre à mal l’économie américaine” ? Donald Trump. Qui a attribué les remarques faites par une journaliste au fait qu’elle devait probablement avoir ses règles (“on pouvait voir du sang sortir de ses yeux, du sang sortir de son… où que ce soit”) ? Donald Trump. Qui a demandé “l’arrêt total et complet de l’entrée des musulmans aux États-Unis” ? Donald Trump.
Mais il sort d’où, ce type ? On croit avoir un peu tout vu, la gauche qui gouverne à droite, la droite qui vire à l’extrême, le tout porté par des politiques qui font assauts de bêtise et d’ignorance. Eh bien non, il y a Donald Trump, hors catégorie, il faut bien le reconnaître, phénomène incompréhensible, dépassant l’entendement.
Que poste Donald Trump, sur son compte Twitter après l’attaque du commissariat de Barbès en janvier 2016 à Paris ? : “Un homme tué dans un commissariat de Paris. On vient d’annoncer que la menace terroriste est à son plus haut niveau. L’Allemagne est un bordel complet.” Donc, malgré l’actualité dramatique de ces derniers mois, malgré les dizaines de déclarations guerrières des responsables tant européens qu’américains, Donald Trump n’a toujours pas compris que Paris n’était pas la capitale de l’Allemagne. C’est agaçant. C’est qu’on est sans doute un peu chatouilleux, nous autres, du vieux continent, avec ces histoires de géographie, à vouloir que tout le monde retienne des tas de villes, de pays, de fleuves et de mers… Mais enfin…
Cela dit, la voilà, la clef.
“Dieu a créé la guerre afin que les Américains apprennent la géographie”, a écrit Mark Twain. C’est raté pour Donald, de toute évidence, mais comment est-ce possible ?

Mark Twain – justement – nous offre la réponse, dans son roman Un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur (A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court), récemment traduit en français par Freddy Michalski et publié en 2013 aux éditions L’Œil d’Or. C’est le récit d’un brave Yankee du XIXe siècle (“Je suis donc Yankee entre les Yankees – et très terre à terre ; oui, j’ai un esprit pratique et quasiment dénué de sentiment, je suppose – ou de poésie, en d’autres termes”) qui se trouve brutalement projeté au VIe siècle, à la Cour du roi Arthur. Le choc est rude, car tout, dans sa façon d’être et même dans son accoutrement, détonne en ces lieux anciens, un peu comme la choucroute bien laquée et étrangement teinte du candidat Trump perturbe, sidère ou amuse de par chez nous (voir le site http://trumpdonald.org, où l’on peut jouer à décoiffer Donald à coups de trompette). Il est différent, donc. Et décide d’exploiter cette différence, de devenir “Le Boss” : “en l’espace de trois ans, je serai le patron de tout le pays.” “Être investi d’une énorme autorité – poursuit Le Boss – c’est très bien, mais constater que tout le monde alentour y consent, c’est encore mieux.” Le Yankee va ainsi appliquer à la Grande-Bretagne médiévale une grille de lecture directement tirée des débuts de l’ère industrielle américaine. Il fait de la chevalerie un secteur d’activité comme un autre, et de la table ronde “une association désormais à but lucratif” où Lancelot, notamment, spécule et s’enrichit sans vergogne aucune. Et ça marche. Comme marchent les discours complètement décalés d’un Trump dont la porte-parole arborait récemment sur CNN un collier fait de balles de pistolets en soutien à la National Rifle Association : “La prochaine fois – a-t-elle déclaré – je porterai un fœtus pour porter l’attention sur les 50 millions de personnes avortées qui ne seront jamais sur Twitter.”
Et ça marche.
Sauf que.
Tout cela, chez Mark Twain, finit bien mal. Et Donald Trump ferait bien de relire ses classiques. On en tire toujours quelque chose. Au candidat républicain qui affirme en meeting : “Je pourrais me poser au milieu de la Cinquième avenue et tirer sur quelqu’un, je ne perdrais pas d’électeurs”, l’auteur américain du XIXe siècle répond : “On ne peut pas présumer du comportement des êtres humains.” La preuve : alors que Le Boss avait assis son pouvoir et intégré à la Cour du roi Arthur quantité de progrès techniques et d’évolutions des mentalités qui auraient dû lui permettre de briguer la magistrature suprême, alors même qu’il s’apprêtait à “envoyer une expédition pour découvrir l’Amérique”, patatras. Car, au bout du compte, le VIe siècle est le VIe siècle, et le XIXe, c’est autre chose : codes, langages et réalités différentes, incompatibles, soyez-en sûrs. C’est un échec pour le Yankee, lui qui pourtant s’était adapté à merveille à sa nouvelle époque.
Donald Trump n’a même pas pris cette peine. Cet homme-là a clairement trébuché dans une faille spatio-temporelle, et loin de nous l’idée de le lui reprocher. On ne choisit pas forcément l’époque ou le lieu que le sort facétieux nous destine. Mais on fait des efforts. On s’adapte. On essaie de comprendre. Et, même, comme ça, cela reste difficile. Donald Trump ne fait pas d’efforts. Il vient d’un endroit ou d’une époque où l’on peut déclarer sans problème que les Mexicains sont des violeurs ou que Bruxelles est devenu “un trou à rats” et où l’on peut s’offrir le luxe d’ajouter : “Je crois que c’est une bonne chose de s’excuser, mais pour cela il faut avoir tort (au préalable). Je vais m’excuser, absolument, un jour, j’espère dans un futur lointain, si jamais j’ai tort.”
Un conseil, Donald. D’ici à ce que ce futur lointain te rattrape, achète-toi un exemplaire d’Un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, écrit par l’un de tes compatriotes : tu y verras qu’on peut venir d’ailleurs et se comporter avec jugeote et même parfois un peu d’humanité. Et, même ainsi, comment dire : Le Boss, incorrigible optimiste (“il n’existe pas de défaites, il n’y a que des victoires”) aveuglé sans doute par une envie de pouvoir débordante, échoue. Dramatiquement. Et cause la mort de milliers de personnes avant de disparaître à son tour.
Trump, tu donnes ton nom à des gratte-ciels et tu déclares, sans que ta mèche bien laquée ne frémisse d’un poil : “Je serai le plus grand président de l’emploi que Dieu ait jamais créé.” Seulement, vois-tu, “la bonne fortune peut s’avérer traîtresse” : Le Boss lui-même l’affirme, à la fin, et ce sont presque ses derniers mots. Après, c’est terminé. Fin de l’histoire.
En attendant, comme l’annonçait en septembre dernier The Economist : “Washington, we have a problem.”
Nathalie Peyrebonne
Ordonnances littéraires
Mark Twain, Un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, traduit par Freddy Michalski, éditions L’Œil d’Or, 2013
[print_link]



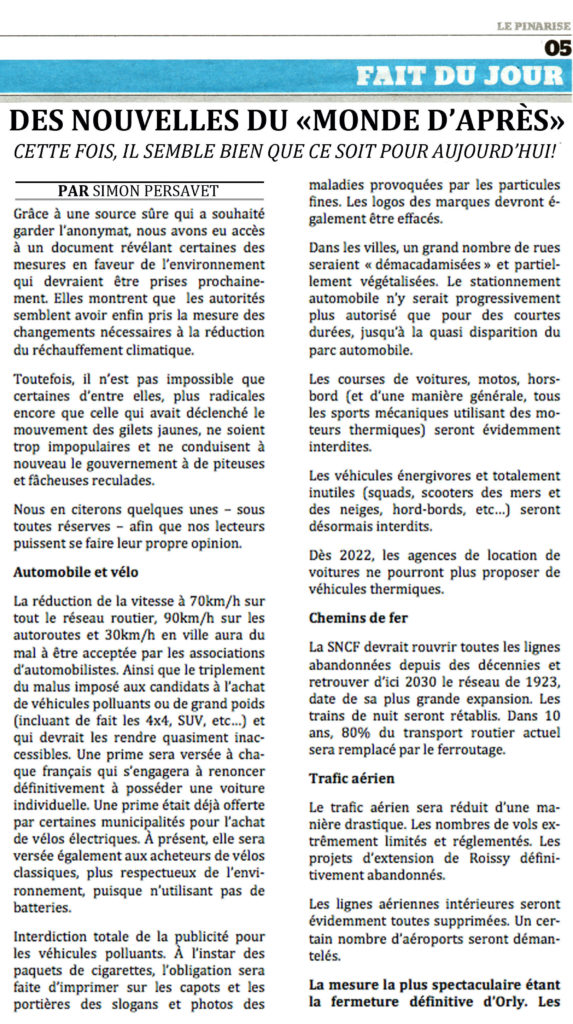




0 commentaires