La Cité de l’architecture et du patrimoine parisienne a pris l’habitude d’inaugurer deux expositions d’un coup. Pour accumuler, gagner du temps, pour que l’on passe trop vite de l’une à l’autre, que l’on ne se pose pas. Illustration ce printemps, avec deux destinations très éloignées en apparence. Elle entraîne d’un côté vers cinquante ans d’architecture portugaise, vers les concepteurs universalistes lusitaniens, qui auraient eu la particularité d’opérer “une fusion cohérente et critique entre le global et le local”, comme l’explique l’architecte Nuno Grande, commissaire de cette présentation. Posant la question : existe t-il une architecture spécifiquement portugaise, “une troisième voie” bien à eux ? De l’internationalisme nationaliste de 1960 à 1974 sous Salazar à la décolonisation tardive, de la révolution des Œillets à l’Europe, jusqu’à la globalisation présente. Ce voyage de questions, illustré par des œuvres des maîtres et prix Pritzker Alvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, et d’autres concepteurs moins connus, est passionnant, j’y reviendrai.
Mais d’autres pérégrinations plus migrantes sont proposées, avec la seconde exposition, “Habiter le campement”. Sujet urgent, poétique parfois, festif quelquefois, poignant souvent, que l’on a moins l’habitude de voir traité par cette institution. “Le campement, introduit Fiona Meadows, commissaire de cette recherche menée avec un comité scientifique (1), c’est le rassemblement temporaire des abris, mais c’est bien plus… C’est la possibilité de faire clan, communauté, société, un ‘raccourci de l’univers’ écrivent Marcel Mauss et Emile Durkheim en 1903. L’abri nous parle d’architecture, le campement d’urbanisme.” Bien sûr, on pense immédiatement à la Jungle de Calais. Mais précisons que cette exploration, et c’est là la richesse de cette démarche, ne se focalise pas sur les cabanes précaires des déshérités sur fond de boue, répression et désolation. Pour effectuer cet état des lieux du “monde global des camps”, une savante collecte de 14 000 photographies de photojournalistes a été menée. Ont été identifiées six manières d’habiter : les nomades, les voyageurs, les infortunés, les exilés, les conquérants et les contestataires.

Pèlerinage de la Kumbh Mela, 2013, Allahabad
La scénographie, installation du collectif 1024 Architecture, s’organise comme une rue de 50 mètres de long, bornée par des échafaudages, lumineuse, cinétique, sonorisée des bruits des habitants des lieux éphémères. Sur cette autoroute (que l’on peut emprunter sans rien voir), se greffe, des deux côtés, un labyrinthe d’images qui prennent la tangente, des arrêts d’urgences, des aires de repos et des petits camps de toutes sortes. Ainsi, pour les nomades, on passe des huttes de la tribu des Arborés en Éthiopie aux yourtes d’Oulan Bator, en Mongolie. Sur les traces des voyageurs, se succèdent le camping joyeux du festival de Glastonbury en Angleterre, les villages de tentes et de cahutes de la Kumbh Mela, à Allahabad, en Inde. Ou les hallucinants parcs de mobile homes américains, si graphiques vus de ciel.

Centre de rétention administrative de Venna, Grèce. Photo: Sara Prestianni
En entrant dans la vie des infortunés, on bascule dans une toute autre réalité, plus démunie : on retrouve là différents bidonvilles de Roms, les sous-sols glauques de Pékin, mais aussi le village de l’espoir à Ivry-sur-Seine ; et les centres de détention des sans-papiers et migrants de Lesbos, Tenerife, Lampedusa. Les exilés sont suivis dans les gigantesques regroupements de Mungunga au Congo ou de Khazr en Irak. Du côté des conquérants – militaires, territoriaux, capitalistes et scientifiques – règnent technologies et logistiques. Se cognent les bases militaires en Afghanistan, et les camps de travailleurs exploités par les mégalopoles orientales, à Al-Khor au Qatar par exemple. Et voici les contestataires, d’un squat à Brighton à Londres aux tentes de la place Tahir du Caire occupée en 2011. Ou encore les parapluies à Hong Kong en 2014. Manque la place de la République à Paris, agora trop récente, qui chaque jour reconstitue son bivouac citoyen.
On pourrait être surpris de voir cohabiter yachts de luxe choisis et abris de fortune subis. Pas de misérabilisme ici, cela permet seulement de réaliser que la frontière entre la vie aisée et la rue violente est si fragile, surtout pour les victimes de guerres, de catastrophes ou de la crise économique. Cette exposition n’est pas seulement un listing complet, esthétique ou tragique, des campements, elle nous incite à observer. À regarder autrement les bidonvilles internationaux, qui sont toujours “habités” par des hommes, des femmes et des enfants, non invisibles, organisés même dans l’urgence, avec des équipements, des écoles, des places, des lieux de culte et de rencontres. Pour en tirer des leçons, imaginer comment on pourrait sécuriser certains campements, sans les détruire, non pas pour pérenniser la misère mais pour construire des petites cités décentes. Puisque délogés, ces habitants échoués ou exclus, n’ont pas le choix, ils se regrouperont un peu plus loin. Pour qu’ils redeviennent acteurs avec leurs bagages multiculturels. Ces campements de toutes sortes peuvent être aussi instructifs pour réinventer l’habitat social, pour le partage, pour le réemploi des matériaux.

Jungle de Calais. Photo: Cyrille Hanappe
Cette exposition ne donne pas de leçons mais est ouverte sur de possibles actions, comme celles du PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines), groupe engagé dans la Jungle de Calais, qui a édité, avec les graphistes d’agrafmobile, un contre-bulletin municipal, “Réinventer Calais avec les migrants”. Les acteurs de ce groupe pluridisciplinaire, présidé par le paysagiste Gilles Clément, lancent des appels à projets aux architectes et citoyens pour accompagner “une cité éphémère du XXIe siècle”. Se référant aux Villes invisibles d’Italo Calvino : “L’enfer des vivants n’est pas chose à venir ; s’il y en a un, c’est celui qui est déjà là, l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d’être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart : accepter l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage, continuels: chercher et savoir reconnaitre qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place.”
Anne-Marie Fèvre
[huge_it_gallery id= »7″]
(1). Arnaud Le Marchand (sciences économiques), Saskia Cousin (anthropologue), Marc Bernardot (sociologue), Clara Lecadet (anthropologue et ethnologue) , Michel Agier (anthropologue), Michel Lussault (géographe).
Les Universalistes, 50 ans d’architecture portugaise. Cité de l’architecture et du patrimoine, 75016, Paris, jusqu’au 29 août.
[print_link]

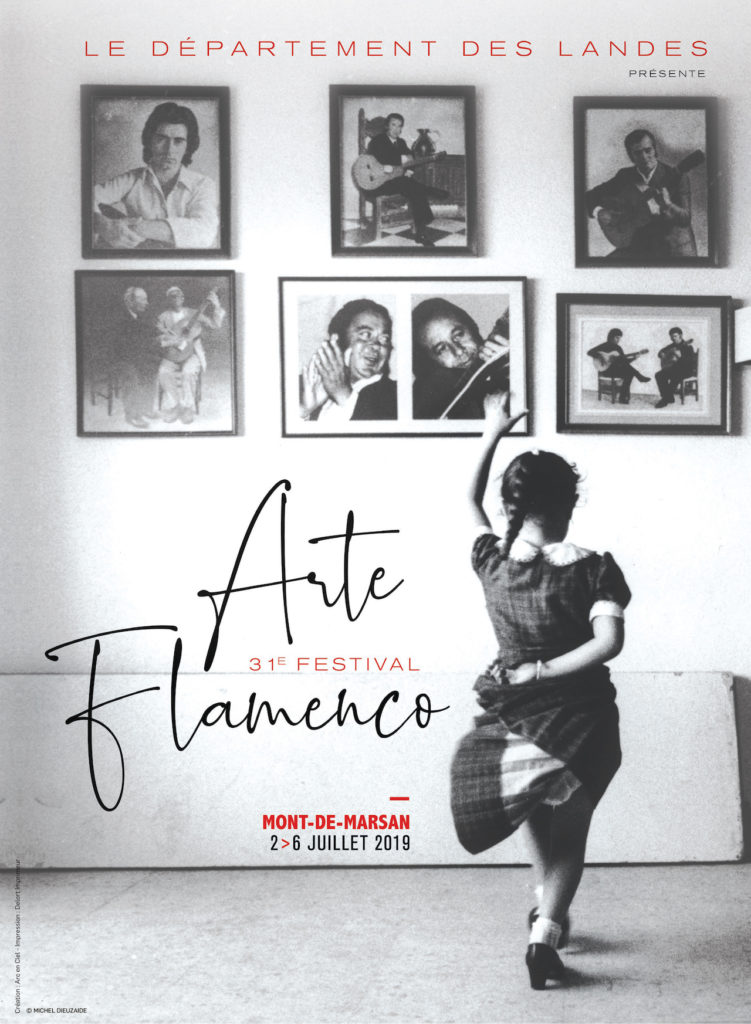




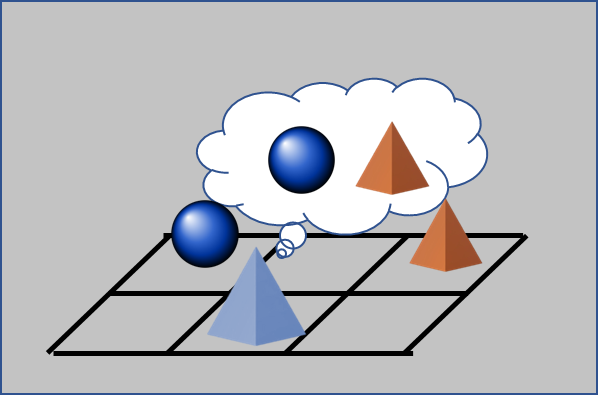


0 commentaires