Le genre idéal est noir. Comme un polar, un thriller, une enquête judiciaire ou un roman naturaliste. Et c’est de l’humain, de la tragédie grecque, du meurtre, en série, passionnel, accidentel, d’État, ordinaire parfois.
Quitter prématurément l’enfance suite à une souffrance trop intolérable, un deuil, une faille intime, peut expliquer ensuite la nécessité d’écrire, de modeler le réel, comme pour arrêter le temps, maîtriser la vie, et nourrir ce besoin viscéral de mémoire, de zones tendres protégées. Rosa Montero l’affirme : l’être humain fabrique le réel pour guérir d’un monde qui le blesse.
Souffrir pour autant n’est pas la condition nécessaire pour cocher la case « romancier » et ne donne pas non plus un titre au roman qui s’écrit. Certains auteurs ont une phrase en tête et déroulent l’histoire. D’autres le cherchent des semaines durant, font cogiter des équipes ou s’en remettent au hasard comme on va chercher un nom dans l’annuaire pour en faire un héros. Pour Rosa Montero, le titre émerge du roman comme une île au milieu de la mer. Il n’y avait rien la veille et le voilà au matin comme une évidence avec ses falaises, ses arbres et son horizon au milieu du grand bleu. Il est le roman. Il dit le livre. Ses obsessions, ses lumières, ses interrogations. Le Poids du cœur n’y échappe pas.
 Prise au piège « dans la prison minuscule de la vie », une androïde de combat, libérée des deux années qu’elle devait à son fabricant, survit dans un futur au goût du présent. C’est un roman et cela ressemble à la vie. Une guerre obscure, minorée à de simples incidents, sévit dans les confins. On parle de la disparition des singes. Des compagnies privées vendent l’air et des zones entières sont fermées tandis que les féroces veillent au calme au-delà des murs transparents de méthacrylène.
Prise au piège « dans la prison minuscule de la vie », une androïde de combat, libérée des deux années qu’elle devait à son fabricant, survit dans un futur au goût du présent. C’est un roman et cela ressemble à la vie. Une guerre obscure, minorée à de simples incidents, sévit dans les confins. On parle de la disparition des singes. Des compagnies privées vendent l’air et des zones entières sont fermées tandis que les féroces veillent au calme au-delà des murs transparents de méthacrylène.
C’est demain et c’est hier. Bruna, crâne rasé, tatouages et yeux de tigre, au passé fabriqué par un mémoriste, accepte des boulots de misère payés par des pauvres. Détective privé. Moins d’État, plus de libertés, zéro recours. Tous responsables. Contrairement aux humains qui l’ont fabriquée et qui vieillissent indéfiniment en étirant les années à coups de chimie et d’opérations, Bruna se fout des vertus de l’apprentissage, de la vénération de l’acquis par l’expérience, de la valorisation de la patience sur l’action. Programmée pour vivre dix ans, elle sait qu’elle va mourir ravagée par une dégénérescence fulgurante. Elle sait qu’il est des savoirs inutiles et qu’avoir les bonnes puces pour passer les frontières est plus important que connaître la généalogie des derniers rois du monde. Une femme lui a demandé de retrouver son mari. Elle revient avec une gamine de dix ans irradiée jusqu’à l’os, ingérable, dangereuse entre rire et crachat, pour qui les adultes sont une plaie eux qui lui ont infligé une vie sans merveilleux à la merci d’un sniper.
Rosa Montero le dit, Bruna est l’un de ses personnages de prédilection et sa valeur est dans le poids de son cœur, ce chasseur solitaire qui cogne dans la chair et donne le mouvement. Il s’arrache, se donne, a des hauts et des bas et parfois cesse tout bonnement de cogner. Rosa Montero dit aussi qu’il n’y a pas de livres mineurs. Pas de classement noir, blanc, rose. Il y a la liberté d’écrire et ce que l’on en fait. Il y a le genre idéal qui est politique, psychologique, amour, aventures, polar et SF mêlés. Les genres littéraires se sont dissous avec le vingtième siècle. L’écrivain n’a plus de limites. Et pour Bruna, dans un univers saturé de fumées et de fureur, le compte à rebours est lancé.
Lionel Besnier
Le genre idéal
Le Poids du cœur de Rosa Montero, traduit de l’espagnol par Myriam Chirousse, Métailié.
[print_link]



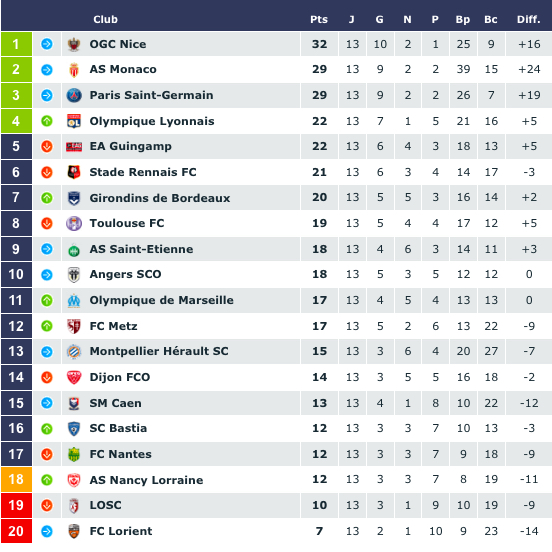





0 commentaires