Arraché dès l’enfance à sa natale Taïga, adopté par un couple d’ostréiculteurs rustauds sur les bords, amoureux d’une écuyère, puis d’Ali ibn-el-Fahed, le plus grand des Dompteurs, qui le mène à la Gloire internationale, Tigrovich, tigre, prince et artiste, a connu la gloire internationale et la déchéance de l’artiste mélancolique. Un jour, son dompteur disparaît, en laissant opportunément quelques indications permettant de le retrouver. Notre héros part à sa recherche, en compagnie du Clown Démétrios. Embarqués à bord du Circus, ils ont levé l’ancre et rencontré à bord une mystérieuse passagère clandestine, un chanteuse égyptienne qui se révèle, contre toute attente, être Ali le dompteur lui-même, indeed ! À bord du Circus, tout le monde se réjouit de ces retrouvailles. Si ce n’est que qu’à l’horizon des pirates les abordent. Malgré l’héroïque résistance de l’équipage du Circus, Tigrovich et son dompteur se retrouvent prisonniers des pirates, en compagnie de deux otages occidentaux : un jeune homme de Bari, bien fait de sa personne et un otage charentais. Ingénieux autant qu’artistes, ils parviennent à séduire les pirates par un époustouflant numéro de cirque maritime. Hélas, à l’horizon on aperçoit un nuage noir… qui pourrait bien grossir…
Or ce nuage n’était rien, simple et modeste avertissement, amuse-gueule de tornade. Bientôt le vent, puis les vents, se levèrent, suivis de peu par une houle déchaînée qui tantôt couchait sur le flanc la frégate pirate, tantôt la redressait poupe sur proue, proue sur poupe, le tout à l’avenant. La mer furieuse se faisait trombe, montagne, volcan, puis, dans sa rage renouvelée, abîme, crevasse, canyon d’écume, défilé rugissant. Fanfare elle bruissait d’un tintamarre infâme, orchestre désaccordé que ne dirigeait plus qu’une main affolante, sortie tout droit des profondeurs de l’Enfer pour faire jouer sur les flots une partition démoniaque. Les flots, quant à eux (c’était vraiment une tempête réglementaire), se brisaient et battaient l’air comme les mille bras d’un monstre décapité qui cherche en tous sens sa proie. Comme tantôt le tigre avait rugi, ainsi, mais bien plus fort, la mer rugissait, bête furieuse et déchainée qui, s’emparant de l’embarcation, l’agitait, ainsi qu’il est d’usage, comme un vulgaire fétu de paille. Quant au tigre il ne rugissait plus, tout occupé qu’il était, soutenu par Ali, à soulager par-dessus bord un cruel malaise gastrique (il était bien malade), rendant à la mer les poissons qu’il avait, à l’insu de tous, trouvés et dévorés crus dans la cale des pirates. Les vagues, telles un troupeau de hyènes hystériques, mordaient le bâtiments, venant toutes sur lui de tous les points cardinaux, du Ponant des lames de fond sournoises autant que violentes, du Levant des vagues tourbillonnantes dont les volutes les faisaient tournoyer en hélice, puis les vagues boréales, angulaires et glaciales comme les icebergs qui les avaient vues naître, les vagues australes, enfin, brûlantes comme une enclume qui menaçait, à chaque coup, d’enflammer la frégate.
À bord, éperdus, on se lamentait. En berbère, russe, italien, charentais, égyptien, arménien et en rugissant, on appelait sa mère qui ne venait jamais, tandis que s’abattaient les paquets de mer sur le pont. Malo pourtant, profil de médaille berbère, peau d’olive et de satin, tenait encore ferme la barre, abattant et lofant, dévalant, esquivant et feintant, dribblant quand il le fallait, forçant le passage au besoin. Sous sa conduite, vagues et nuages reculaient, se mettaient en rang ou presque, lui faisant une haie d’honneur, comme il traçait un chemin dans la mer. Puis tout redevenait désordre et confusion, hyènes, tornades, fétu de paille, Appalaches et montagnes russes. Or une masse d’eau de la mer, perfide plus encore que les autres, le fit ployer pour la première fois, l’ayant pris par derrière. À genoux il tenait encore la barre, quand le vent s’en mêla sans discussion ni appel, et brisa en ses mains la barre qui lui échappa au loin, sous les yeux de Tigrovich qui, d’un point de vue purement gastrique, se sentait mieux malgré tout. Car d’un point de vue maritime, la situation empirait. La frégate, privée de son aurige berbère, devenait un jouet dans les mains de la mer cruelle, qui la faisait tourner en son axe, rebondir sur place, puis en avant, puis en arrière, puis n’importe comment au gré de ses caprices indéchiffrables, comme le sont parfois les caprices de la mer.
Enfin, comme l’enfant pleurnichard jette d’un coup, et le brise, le jouet qui l’a diverti quelques minutes, ainsi la mer, inconséquente, d’un coup, et la brisant, jeta la frégate sur l’un de ces brisants que craignent les marins au large d’Alexandrie. Ce fut un jaillissement de voiles, de drisses, de pirates, de tigre, d’otage charentais, de rivets, clous et cordages, dompteur et chaloupes fracassées. Tous dans les tous sens et aucun dans le même planèrent dans les airs avant de retomber, platement, dans la mer, les uns engloutis pour toujours, les autres accrochés, comme ils pouvaient, à quelques planches et avirons. Tigrovich qui tenait ferme un morceau conséquent du grand mât, flottait sur la mer furieuse. Mais il ne voyait plus Malo, ni Saad, ni Yugurthen. Les autres il les voyait, au loin, à travers ses larmes de sel. Il distinguait Ali, juché sur un bout de chaloupe qui l’appelait sans qu’il l’entende. Et l’ex-otage charentais et le jeune homme de Bari, bien fait de sa personne, il les apercevait qui se partageaient une planche, pathétique résidu de ce qui avait été une coque de frégate. Et les pirates berbères, hormis ceux qu’il ne voyait plus, il les devinait accrochés à ce qu’ils pouvaient.
Or la mer ayant pris son tribut, se calmait, decrescendo, placide comme le fauve qui digère, tandis que de petites brises les poussaient les uns loin des autres. Humide auxiliaire de la Parque cruelle, la mer est douce à ceux qu’elle épargne, autant qu’elle est implacable pour ceux dont l’heure a sonné. Et ceux qu’elle avait épargnés elle les dirigeait chacun vers son destin, un vif courant poussant les pirates vers Carthage, une brise vivace repoussant vers l’Occident l’ex-otage charentais et le jeune homme de Bari, bien fait de sa personne. Pour Tigrovich, confiant, il attendait la lame de fond qui doucement le mènerait vers Ali. Quant à Ali, sur sa chaloupe jugé, il semblait scruter les airs à l’affût du zéphyr qui le mènerait à son tigre. Déjà, de loin, ils se faisaient signe, heureux. Mais que sait-on, quand on est un tigre, un prince et un artiste, des ruses du destin ? Rien. Il n’était pas écrit que le tigre ce jour voguerait vers Ali. Nul arrêt, nulle part, qu’en cette mer Ali retrouverait son tigre. Tandis qu’ils se congratulaient à distance, insidieusement, fermement, implacablement deux petites brises contraires les éloignaient l’un de l’autre, poussant l’un vers l’Égypte où l’attendait sa sœur, la cantatrice égyptienne, et l’autre vers l’orient où rien ne l’attendait, du moins le pensait-il, sinon une terre étrangère et hostile.
Sophie Rabau
Les aventures de Tigrovich


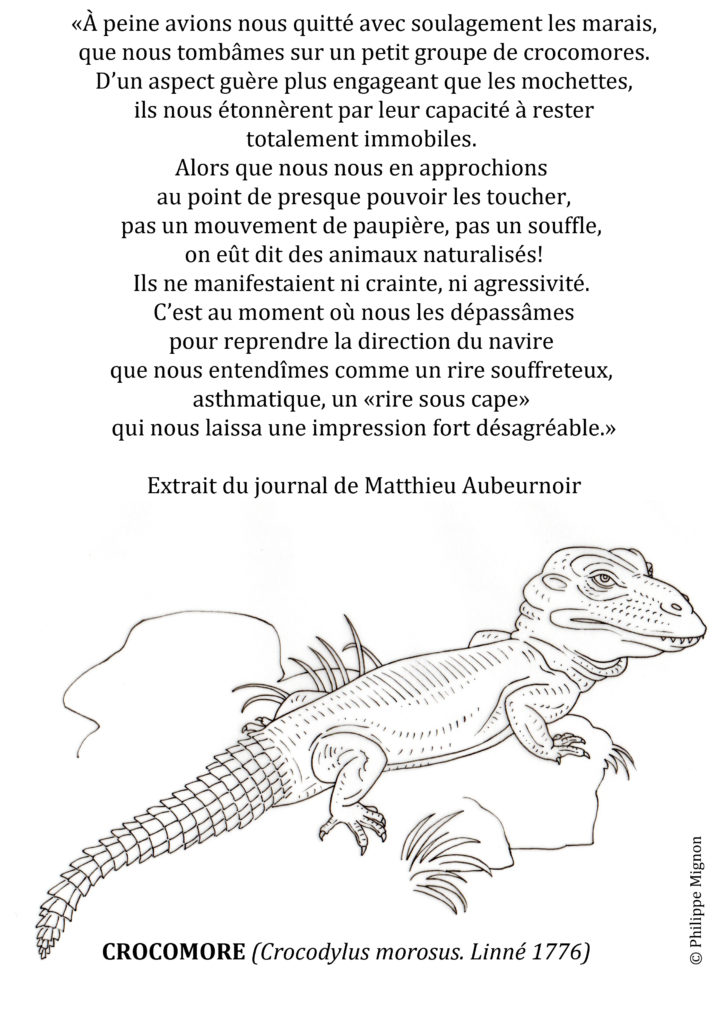







0 commentaires