Un mystérieux virus venu d’Asie, une planète malade de ses habitants et une étrange race d’extraterrestres médecins prêts à toutes les thérapies de choc pour la guérir. Un roman d’anticipation écrit en 2012, jamais publié, qui pose sur notre modèle de civilisation des questions plus que jamais d’actualité.
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre.
Jean de la Fontaine, Les Animaux malades de la peste
Et le bacille humain, minuscule vibrion mortel
qui se tortille sur la croûte supérieure de la terre,
sera bientôt stérilisé dans l’anéantissement.
Arthur Conan Doyle, La Ceinture empoisonnée
I
Il les terrorisait. Même menotté à une chaise, la tête dans un sac, il les terrorisait. La peur qu’il percevait était celle des bêtes sous l’orage, des premiers hommes face à la foudre, de ces peurs qui sont à l’origine des religions. Les fusils d’assaut tremblaient d’un pieux effroi dans les mains des miliciens en position de tir. À genoux, ceux-ci paraissaient en vénération. Ils portaient des masques à gaz et la combinaison de protection contre les nuées d’insectes, avec l’insigne du dieu Pan sur la poitrine.
Malgré le sac, rien ne lui échappait : il aurait pu décrire le tribunal dans l’ancien palais de justice, les murs crevés par les racines de la jungle qui recouvrait la ville, l’humidité et les mouches qui n’osaient pas profaner sa peau maculée de tant de sangs. Parmi les dix juges qui lui faisaient face, une seule femme, qu’il reconnut à son odeur. Elle aussi croyait le connaître, le moment viendrait de la détromper : désormais, il n’était plus que le cheval de Troie, la mort sous son masque rouge, le dernier remède. Au loin, un rat géant couina. Les juges chuchotaient mais lui ne perdait rien de leurs délibérations. Ainsi, ils s’étaient résolus à le laisser parler avant l’exécution, comme il l’avait demandé. Une dernière occasion lui serait donnée de délivrer aux hommes le message de Xahu-la. Devait-il s’en réjouir ? Il se sentait si las… La fin était proche, il pensait déjà à l’après. Tant d’années que son existence se réduisait à l’accomplissement d’une fonction : saurait-il recommencer à vivre comme un homme ?
À travers la puanteur du sac, il aspira dans un soupir l’air infecté par la peste orpheline. « De cœurs qui n’en sauraient guérir, elle est partout accompagnée », se souvint-il avec tristesse, mais sans remords : il se contentait de remplir sa fonction. Dans le ciel du plafond écroulé passaient des nuages, comme avant. Il songea qu’après tant de mort cet instant de paix lui plaisait, malgré les menottes, le sang, la peur et les fusils braqués. Pour en profiter le plus longtemps possible, il décida de faire remonter son récit au matin du premier rêve…
II
“Le 17 avril 1918, Jebediah Scott revint seul de l’offensive qui décima son bataillon. L’aube était claire, la tactique mauvaise, l’ennemi les attendait. Ils furent balayés par la mitraille avant de franchir les derniers barbelés. Aucun n’atteignit la tranchée. Jeb trébucha sur le corps du soldat qui le précédait, un gamin du Kansas au visage couvert de taches de rousseur, qu’une rafale tua sur le coup. Toute la journée, Jeb resta couché dans la boue mêlée de sang, abrité par le cadavre du gamin, à compter les taches de rousseur. La terre imprégnée du phosgène répandu par les Allemands la semaine précédente sentait le foin moisi. Depuis le remblai, les soldats tiraient sur les blessés qui geignaient, sans oser sortir les achever : les deux tranchées étaient trop proches. Parfois, une balle atteignait par erreur le cadavre du gamin, qui sursautait comme s’il avait été piqué par un taon des vaches que sa famille élevait, dans le Kansas. Quelques jours plus tôt, le gamin avait expliqué à Jeb que ses parents, dans son enfance, avaient essayé de faire disparaître ses taches en lui appliquant chaque jour de la pomme de terre écrasée avec du jus de citron et du miel, dans un torchon. Sa peau était très sensible au soleil, même en ce début de printemps. Quand l’orage finit par éclater, trois heures plus tard que ce que l’état-major avait prévu, Jeb se réjouit simplement pour le gamin, et dit à voix basse une prière où il était question du soleil du Kansas. À la nuit tombée, il rampa jusqu’au camp.
Jeb n’était pas du genre à en rajouter. C’était un gars taiseux, les épaules larges, que ses parents avaient tôt retiré de l’école pour qu’il aide aux champs. Il compensait son manque d’éducation par un instinct silencieux. Sa force tranquille le rendait sympathique. Ses camarades, la plupart fils de cultivateurs du Midwest, virent en lui l’incarnation des valeurs d’humilité et de ténacité dont on leur avait dit qu’elles leur feraient gagner la guerre. Jeb n’aima pas être traité en héros mais devina que son retour réconfortait ses camarades. Comme on ne lui demandait en définitive rien de plus que de continuer à être lui-même, il alluma sa pipe de maïs et alla s’assoir dans la casemate pendant qu’on discourrait sur son exploit. Les officiers le félicitèrent, ses camarades le pressèrent de questions, il répondit par monosyllabes en tirant sur la pipe offerte par son père avant son départ. Là-bas, dans le Missouri, sa famille cultivait le maïs. Souvent, pour se moquer, sa mère disait à Jeb qu’il en avait tant mangé qu’il ressemblait à un épi : grand, souple et blond. Ce souvenir rappela à Jeb le garçon aux taches de rousseur à qui il devait la vie. Leurs familles devaient se ressembler. Jeb remarqua alors que le tabac qu’il fumait n’avait aucun goût, ce tabac noir si fort qu’on leur fournissait. Songeur, il fixa ses doigts serrés sur la pipe, des doigts brûlés par l’arsenic que les cultivateurs de sa région utilisaient comme pesticide depuis quelques années. Il repensa au soleil du Missouri, le même soleil qui brûlait la peau du garçon aux taches de rousseur dans le Kansas, mais ne parvint pas à se souvenir de la sensation de chaleur de ses rayons sur sa peau. Dehors, la pluie s’était remise à tomber. Le regard de Jeb aussi s’était embué. Il comprit que revenir n’avait servi à rien. Par coïncidence, c’est à ce moment précis qu’il disparut.
On le chercha en vain, il s’était volatilisé. Les jours passèrent, il fut déclaré manquant par la hiérarchie, tombé au champ d’honneur, afin d’éviter toute enquête sur sa disparition. Ceux qui étaient présents savaient qu’il n’avait pas pu quitter la casemate sans être vu : une déflagration étouffée, comme un obus lointain, et puis rien. Un accord tacite s’établit, tant de mort alentour anéantissait la curiosité, on ne parla plus jamais de Jebediah Scott.
Pour lui, cependant, ce ne fut que passer le revers de sa manche sur ses yeux pour sécher ses larmes, et la casemate, ses camarades, la tranchée, la guerre même, avaient disparu. À la place, le versant en pente douce d’une colline de roche vitrifiée, couleur rubis. Jeb se trouvait assis, dans la même position que dans la casemate, sa pipe à la main, sur une des bulles cristallines de sa surface lisse, comme de lave durcie. Translucide, la pierre luisait. La colline rendait violet le ciel où palissaient deux lunes. Jeb n’était pas seul. Un monsieur en frac, à quelques mètres, jetait autour de lui des regards affolés. Une femme élégante pleurait, à même le sol. Une dizaine de personnes, plus loin, se déplaçaient prudemment. Certaines portaient des costumes que Jeb n’avait jamais vus. Il y avait même un homme nu, la peau étrangement tatouée. Soudain, une balle fit étinceler le cristal près de la main de Jeb.
Il se jeta à terre. Du haut de la colline, un soldat allemand l’avait pris pour cible. Jeb n’avait pas d’arme. Attirées par la détonation, les gens firent mine d’approcher, Jeb profita de la diversion pour s’enfuir. Il courait plié en deux, de bulle en bulle, sous les balles du soldat allemand. Jeb tentait de le contourner, l’autre manœuvrait pour rester au-dessus. Ils montèrent vers le sommet de la colline. Soudain, les coups de feu cessèrent, un hurlement retentit.
Jeb sortit prudemment la tête. Plus haut, le soldat allemand se débattait dans la gueule d’une créature qui rappela à Jeb les sauterelles qui ravageaient parfois les cultures dans sa région, mais d’une taille monstrueuse. Jeb tituba, la créature le détecta. Un claquement de mandibules et le corps du soldat allemand fut sectionné au niveau de l’abdomen. Jeb dévala la colline.
En bas, elle disparaissait sous une plaine d’herbes hautes qu’au premier abord il avait prise pour une mer. À perte de vue, elle ondulait sous le vent comme une houle. En dévalant la pente, Jeb s’aperçut qu’il s’en trouvait bien plus loin qu’il l’avait pensé. Les herbes, en réalité, mesuraient plusieurs dizaines de mètres. Il s’y perdit, comme un mulot dans un champ de maïs. Dans la forêt des tiges, il se sentit en sécurité : la créature aux pattes articulées devait s’y trouver moins à l’aise que sur l’éboulis de cristal. Le souffle court, Jeb s’assit sur une racine pour faire le point. Pour une fois, son instinct était pris en défaut, si bien qu’il finit par se résoudre à ne pas comprendre. Pendant de longues minutes, il tira sur sa pipe, l’esprit vide. Il faisait sombre, la température avait baissé de plusieurs degrés à l’ombre des herbes. La sueur de la course, en refroidissant, fit frissonner Jeb. Il toussota. Le sol était couvert de pollens phosphorescents, les tiges faisaient en se balançant le même bruit que les champs de maïs mûrs devant lesquels Jeb et ses frères fumaient leur pipe, le soir après dîner, sur la galerie de la maison.
Soudain, Jeb se sentit fébrile. Il posa la main sur son front, c’est alors qu’il ressentit la brûlure des pollens dans les bronches. La fièvre monta instantanément, ses muscles se contractèrent, une toux irrépressible le prit. Son rythme cardiaque s’emballa, le sang battait ses tempes, ses poumons se consumaient. Il s’écroula en vomissant du sang. En moins d’une minute, Jebediah Scott était mort, la pipe de maïs de son père toujours dans la main.
Trois jours après sa disparition, les premiers cas de grippe espagnole se déclaraient sur le front…
Je ne suis pas de ceux qui se rappellent leurs rêves. De celui-ci, je ne gardai toute la journée qu’un soupçon de déjà-vu, le sentiment d’une absence, cet agacement qu’on ressent d’avoir oublié de faire quelque chose sans savoir quoi. Ce n’est que le soir, devant la télévision, qu’il me revint avec une précision qui me perturba.
À cause de la vague de chaleur, j’étais resté à la maison à travailler sur la table du salon, plus proche de la climatisation que mon bureau. À la radio, le matin, on avait parlé du réchauffement climatique, comme chaque jour, du trou dans la couche d’ozone et de cas de grippe recensés en Asie. Après le petit-déjeuner, j’avais essayé d’avoir mon ex-femme au téléphone. Elisa est biologiste. Quand ma stérilité a été diagnostiquée, j’ai préféré l’adoption au don de sperme. L’idée que des spermatozoïdes autres que les miens circuleraient dans le corps de mon épouse me faisait l’effet d’une trahison. Plus tard, après notre divorce, j’ai regretté mon intransigeance. Elisa ne s’est jamais remise en couple, pas plus que moi, et n’a pas non plus d’enfant : pendant des années, j’en ai conçu autant de culpabilité que de réconfort. Aujourd’hui qu’il me juge, après tout ce qui s’est passé, je ne voudrais pas que ce tribunal se méprenne sur mes sentiments…
Les procédures d’adoption ont été longues, nous nous sommes rendus quatre fois au Vietnam, les deux dernières pour rencontrer l’enfant, un orphelin de trois ans prénommé Bao. Bao souffrait d’une déficience immunitaire sans doute causée par les produits chimiques de la guerre, qui avait contaminé les nappes phréatiques. Sa mère, pendant la grossesse, avait bu de l’eau contaminée. Deux mois avant que nous n’allions le chercher, Bao attrapa la grippe aviaire. Nous prîmes à notre charge les frais d’inhumation, sans faire le déplacement. Avec les cadeaux que nous lui avions offerts à nos précédentes visites, c’est tout ce que nous aurons fait pour lui. Elisa mit du temps à se remettre. Se spécialiser dans l’épidémiologie l’avait aidée à se reconstruire mais chaque vague de contagion dans cette région du monde la plongeait dans la dépression.
Elle ne répondit pas au téléphone.
En fin de matinée, j’étais sorti vérifier dans le jardin qu’aucun récipient ne contenait d’eau croupie, comme les autorités sanitaires l’avaient demandé. Une variété de moustiques ramenée d’Afrique dans les bagages des touristes, y pondait ses larves, deux personnes avaient déjà succombé à la dengue. Précaution inutile, la sécheresse régnait et, pour économiser les réserves d’eau, on interdisait de remplir les piscines et d’arroser les jardins. La terre du mien était à nu, et les plantes desséchées. Sorti torse nu, j’en fus quitte pour un bon coup de soleil.
J’avais consacré le reste de la journée à corriger des copies et préparer mes cours. Après la sieste, l’actualité m’inspira de consacrer la séance sur La Fontaine du lendemain aux Animaux malades de la peste. Une inspiration qu’on peut considérer de mauvais goût, a posteriori, mais c’était la morale de la fable qui m’intéressait, dans le cadre de mon propos sur la philosophie politique du fabuliste, auquel j’ai consacré ma thèse : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd’hui, je voudrais que cette leçon ne soit pas oubliée…
Le soir, je lus tard devant la télévision, comme toujours depuis que je vis seul. Elisa n’avait pas répondu de la journée, j’avais décidé de lui rendre visite au laboratoire le lendemain. La chaîne d’informations permanente consacrait son édition spéciale à une nouvelle tuerie survenue quelque part à l’étranger. Depuis quelques mois, plusieurs villes, dans des pays différents, en avaient connu de semblables. Les distances, la fréquence des massacres et le nombre des victimes semblaient exclure l’hypothèse d’un tueur en série isolé. L’enquête s’orientait vers des groupes organisés à l’échelle internationale : sectes, groupuscules fascistes ou cellules terroristes. Aucune piste n’était privilégiée, les autorités semblaient de plus en plus désorientées au fur et à mesure que le rythme des tueries s’accélérait.
La dernière en date ne différait en rien des précédentes : la nuit, dans un centre-ville, des passants avaient été agressés sur plusieurs centaines de mètres, à l’arme blanche. À la course, il aurait fallu à un homme normal trois à quatre minutes pour parcourir la distance, or tout semblait indiquer que le massacre n’avait duré que quelques secondes. Autre invraisemblance : aucun des quarante-six passants frappés par le tueur n’avait survécu. Un seul coup suffisait à chaque fois, d’une arme tranchante qu’on n’avait pas pu identifier catégoriquement. Pour comble, comme dans les cas précédents, les rares témoignages ne concordaient pas, personne ne semblait avoir assisté aux crimes et les descriptions des suspects aperçus sur les lieux peu avant ou peu après les faits ne permettaient d’établir aucun portrait-robot : certains témoins avaient vu des blonds, d’autres des bruns, certains des chauves et d’autres des moustachus. L’hypothèse probable que les coupables agissent en bande rendait encore plus incompréhensible cette absence d’informations. Enfin, on ne disposait d’aucune image, les enregistrements des villes équipées de caméras de surveillance étaient toujours inexplicablement flous et obscurs, on n’y devinait que le passage éclair d’une ombre qui précédait la mort. La paranoïa s’était installée dans les pays frappés, c’était pire encore dans ceux qui, épargnés jusqu’alors, se situaient sur un itinéraire qui commençait à se dessiner, comme c’était le cas du nôtre.
La caméra allait du journaliste, derrière lequel les corps avaient été recouverts de draps blancs, aux badauds que la police avait contenus derrière des barrières. C’est là, parmi les curieux, que j’eus l’impression de voir mon frère.
Le plan ne dura qu’une seconde, je m’agenouillai devant la télévision pour mieux distinguer au cas où la caméra reviendrait. J’attendis une minute, le cœur battant. Lorsqu’on vit de nouveau la foule, je ne l’y retrouvai pas. À l’évidence, j’avais mal vu. C’est alors, subitement, que je me souvins de mon rêve.
Tout me revint : les noms, les dates, les couleurs et les cris, comme s’il s’agissait d’un film que je venais de regarder à la télévision. Il me fallut quelques minutes pour comprendre pourquoi penser à mon frère m’avait rappelé mon rêve : c’était sa voix qui me l’avait raconté dans mon sommeil.
Je restai longtemps à réfléchir, ce soir-là, devant l’écran. J’avais coupé le son, les mêmes images repassaient en boucle, le visage de mon frère ne reparut pas. Pourquoi avais-je associé son souvenir à la grande guerre ? Fantastique en soi, mon rêve ne l’était que plus raconté par la voix de ce frère porté disparu depuis six ans. Je n’ai rien d’un freudien mais il semblait probable que ma vision de Jebediah ne fût que la projection de mes angoisses liées à la disparition de Charlie. Je finis par accepter l’hypothèse, bien que n’ayant jamais rêvé de lui auparavant. Peut-être la chaleur avait-elle agité ma nuit. Une recherche infructueuse que je fis sur Internet au nom de Jebediah Scott finit de me persuader de l’inutilité de chercher des explications plus farfelues. Le rêve avait dû marquer mon inconscient au point de me faire imaginer apercevoir Charlie dans la foule.
Je comprends aujourd’hui que mon esprit ne cherchait qu’à se rassurer. Cette nuit-là, je fis le deuxième rêve.
Les enfants du quartier des tanneurs de Caffa avaient pris l’habitude de jouer sur le ruisseau gelé. En été, ils n’auraient jamais songé à s’approcher de ses eaux polluées. Là où il se jetait dans la mer Noire, celle-ci n’avait jamais si bien porté son nom. Mais l’hiver était froid, la couche de glace épaisse et le siège auquel les Tatars de la Horde d’or soumettait la ville depuis des mois offrait parfois de ces rares divertissements aux enfants.
Ce jour-là, deux navires génois étaient entrés dans le port, les habitants affamés s’y étaient pressés dans l’espoir de s’approvisionner. Les enfants jouaient sans surveillance, la plupart d’entre eux étaient des orphelins qu’on faisait trimer aux tanneries. Leurs parents avaient succombé à la famine ou à la maladie. D’autres, comme Akha et Nogaï, étaient de ces enfants tatars que les Génois enlevaient au cours de leurs raids à l’embouchure du Don, pour les vendre aux Musulmans ou les employer dans les comptoirs aux tâches les plus ingrates. Akha et Nogaï préparaient des peaux depuis qu’ils avaient six ans, agenouillés toute la journée à les frotter dans l’eau pour les débarrasser des restes de chairs putréfiés qui portent toutes les infections. Les mains crevassées par l’eau, brûlées par la chaux, tailladées par les couteaux ronds, les enfants les plus fragiles succombaient vite aux maladies. Tous ceux qui avaient été enlevés avec eux étaient morts mais Akha et Nogaï ne s’en souciaient pas. C’est à peine s’ils se souvenaient de leur famille et d’être frère et sœur, à peine si le travail leur laissait le temps de comprendre qu’ils étaient des étrangers, que les leurs étaient aux portes de la ville et qu’ils les réduiraient certainement à un autre esclavage s’ils y pénétraient. Ils ne s’en souciaient pas car, ce jour-là, ils jouaient, grâce à la glace qui paralysait les ateliers et aux navires génois dans le port, ils jouaient avec d’autres enfants aussi dépenaillés qu’eux, qui n’avaient jamais porté le cuir qu’ils tannaient chaque jour, ils jouaient à se poursuivre sans prendre garde au froid ni aux craquements de la glace qui finit par céder.
Les enfants plongèrent dans l’eau souillée de chair en putréfaction, de chaux et de tan, dont seuls Akha et Nogaï ressortirent vivants. Nogaï, qui était fort, avait nagé pour sauver sa petite sœur. Elle mourrait deux jours plus tard, d’une pneumonie. Nogaï creuserait le trou lui-même, pendant la nuit parce qu’on ne l’avait pas laissé quitter l’atelier, le plus loin possible de la rivière, près de la mer, sous la muraille. Il fermerait les yeux, pleurerait sans savoir pourquoi, sans comprendre ce qui le liait à Akha, ce qui la différenciait des autres enfants qui tombaient chaque jour malades dans les ateliers, et lorsqu’il relèverait la tête, ce n’est pas la mer Noire qu’il verrait, ni les murailles de Caffa, mais deux hautes falaises ouvertes sur le ciel le plus étoilé qu’il ait admiré.
Il se trouvait au fond d’un défilé immense, dont les parois mesuraient plusieurs kilomètres. Elles scintillaient d’une roche noire comme la houille où se reflétaient des galaxies toute proches. C’était la nuit et pourtant les étoiles faisaient un jour sur cette planète couverte d’une épaisse poussière de charbon où Nogaï s’enfonçait jusqu’aux mollets, ténébreuse et minérale à l’exception de lierres sombres qui pendaient le long des parois depuis les hauteurs. Les tiges pourtant souples avaient la largeur de troncs et reposaient parfois sur le sol, chargées de feuilles cireuses aux reflets argentés. Sur les plus basses, des chenilles longues comme le bras, couvertes d’écailles duveteuses et sans yeux.
Dégouté, Nogaï recula vers le milieu du défilé, le plus loin possible des parois. Les chenilles n’émettaient pas le moindre son en se déplaçant ni en mastiquant les feuilles, on n’entendait aucun autre bruit sur la planète. Nogaï pensa que personne à Caffa n’imaginait qu’un tel silence pouvait exister quelque part. Il se mit à marcher.
Peu après, il repéra au sol une zone où la poussière avait été piétinée sur quelques mètres, deux traces de pas en partaient. Il résolut de les suivre. Près de deux kilomètres plus loin, l’une des pistes s’arrêta subitement, les pas de l’autre se firent plus profonds et moins espacés. Nogaï supposa que l’une des personnes qu’il suivait portait l’autre. Peut-être était-elle blessée ou épuisée. Nogaï songea à Akha. Il accéléra.
Il marcha de longues heures. Aucune aube ne s’était levée. Plusieurs fois, ceux qu’il suivait avaient fait des pauses, des zones de poussière piétinée en attestaient. Subitement, la piste dévia vers la falaise de gauche. Nogaï la suivit jusqu’aux premières frondaisons. Les traces de pas disparaissaient sous le lierre. Nogaï hésita. Il était fatigué et affamé. Il s’assit sur un bloc détaché de la paroi et observa le ciel. Depuis qu’il marchait, les étoiles n’avaient pas bougé. Tout n’était que silence et immobilité. Soudain, Nogaï pensa que les traces de pas dataient peut-être de plusieurs jours, de mois, d’années même. Aucun vent ne remuait la poussière et les seuls êtres vivants semblaient être ces chenilles qui ne quittaient pas le feuillage. La pensée qu’il était peut-être seul sur cette planète jaillit dans cet esprit qui n’était pas prêt à la comprendre. Il l’accepta comme il avait accepté l’esclavage, les coups et la mort d’Akha, persuadé sans le formuler que rien ne pourrait l’empêcher de continuer à survivre comme il l’avait toujours fait : inutilement.
Il fallait qu’il mange. Les chenilles n’étaient pas appétissantes mais il n’y avait rien d’autre, que les feuilles cireuses. Nogaï trouva un éclat de roche qu’il affuta contre le rocher, avant de chercher une chenille isolée. Il s’approcha avec une prudence inutile, la perception de la chenille était nulle, Nogaï lui enfonça l’éclat à la base du cou, entre deux écailles. La chenille se raidit, se recroquevilla et tomba morte dans la poussière, sans un bruit.
Nogaï voulut la retourner mais retira immédiatement sa main : le duvet des écailles était plein de parasites. Nogaï utilisa sa botte et ouvrit la carapace sous l’abdomen. La chenille n’avait pas de squelette, Nogaï découpa un morceau de chair en prenant garde à ne pas la mettre en contact avec la carapace. Surmontant son dégoût, il porta la chair encore chaude à sa bouche : c’est alors qui vit les piqûres sur sa main. Il lâcha la chair, au moment où les premiers bubons éclataient, secrétant un pus noir. En quelques secondes, son bras était couvert d’œdèmes. Le vertige le fit tomber à genoux. Il avait terriblement soif, son front brûlait, dans sa gorge et sous ses aisselles les ganglions enflaient démesurément. Sa vision se troubla, il réussit à peine à coordonner ses gestes pour toucher de la main les chancres de son visage. Il voulut hurler comme pour prendre une dernière revanche sur le silence, ce fut le nom d’Akha qui lui vint mais aucun son ne sortit de sa gorge tumescente. Il mourut asphyxié.
C’était en février 1346. La semaine suivante, les premiers cas de peste bubonique se déclareraient autour de Caffa assiégée. Les Tatars catapulteraient les cadavres infectés par-dessus les murailles et, quelques mois plus tard, la peste noire ravagerait l’Europe, propagée par les navires génois…
À la radio, le lendemain, la tuerie survenue dans un pays si proche faisait la une. On dénombrait les victimes, les criminologues échafaudaient des théories, il était conseillé de ne pas sortir après la tombée de la nuit. Les records de chaleurs battus pendant la nuit, l’autre grand titre, faisaient presque oublier l’inquiétante propagation de la grippe en Asie. Quelques cas isolés avaient été signalés sur d’autres continents, tous des vacanciers de retour. On recommandait de reporter si possible les voyages dans la région, de porter un masque dans le cas contraire, de se laver les mains soigneusement et souvent partout dans le monde.
Je réfléchis au rêve en me rendant à l’université. Cette fois, je me l’étais rappelé spontanément, avec la même netteté. J’aurais été incapable de décrire avec précision la voix de mon frère, d’autant que plusieurs années avaient passé, mais je savais que c’était encore elle que j’avais entendue. Les rêves ont de ces certitudes que la vie leur envie. Les similitudes entre les deux songes ne m’avaient pas échappées, le même traumatisme cherchait à s’y exprimer, une obsession en quête de forme. Elisa et moi avions suivi une thérapie de couple après l’échec de l’adoption, je pris la décision d’en parler à notre psychothérapeute, que j’avais consulté de nouveau au moment du divorce. Cette décision m’apaisa, je conduisis sans plus penser au rêve. Ce n’est que sur le parking de l’université que je pris soudain conscience que je n’avais aucune raison de connaître la date du déclenchement de la peste noire au Moyen Âge : je ne l’avais jamais sue, pas plus que j’avais jamais entendu prononcer le nom de la ville de Caffa !
Mon bureau étant en cours de désamiantage, je vérifiai sur l’ordinateur de la salle des enseignants, où la climatisation tournait à bloc : la date était plausible et Caffa était le nom génois de la ville ukrainienne de Théodosie. J’entrai en classe sans m’être souvenu où j’aurais pu en entendre parler avant de l’oublier.
Une fois n’est pas coutume, le cours intéressa les étudiants, qui firent inévitablement le lien avec l’actualité. Pas pour la morale politique de la fable : l’irresponsabilité des gouvernants face aux maux qui accablent les peuples dont ils ont la charge n’avait, depuis La Fontaine, plus rien pour surprendre. Mes étudiants auraient pu, sans difficulté, mettre une dizaine de noms d’hommes politiques ou de banquiers sur ce lion qui se décharge sur l’âne des crimes à l’origine de la peste. Le débat pris une autre direction, rien moins que littéraire : pouvait-on légitimement considérer les maladies comme un châtiment divin ? Je voulus le réorienter mais l’inquiétude causée par la grippe en Asie, que j’avais mal mesurée, fit qu’il m’échappa. De quel « péchés » les animaux de La Fontaine étaient-ils coupables pour avoir provoqué « la fureur » du ciel ? Les « crimes de la terre », quels étaient-ils ? Chacun avait son idée, selon sa religion ou son idéologie. J’évoquai Sophocle pour réorienter le débat : c’est parce ce que le meurtre de Laïos reste impuni que la peste s’abat sur Thèbes. « Si le parricide et l’inceste d’Œdipe provoquent le fléau, quel crime la grippe asiatique punit-elle ? », répliqua une étudiante. Pour moi, ex-mari d’une biologiste, non-croyant de surcroît, je n’avais jamais rien vu d’autre dans les épidémies que promiscuité, manque d’hygiène et pauvreté. Je sais aujourd’hui combien mes étudiants et moi étions loin de la vérité !
Au déjeuner entre collègues, il fut question de l’organisation des examens et de la pollution de l’air en ville, à la limite des seuils d’alerte à cause de la chaleur. J’avais eu le temps de passer à la bibliothèque, constater que mon rêve correspondait à la réalité historique. Comment connaissais-je les détails du siège de Caffa par la Horde d’or du Grand Khan ? Aucune réponse rationnelle ne me venait à l’esprit, si ce n’est que je perdais gravement la mémoire. Moi le rationaliste, j’en arrivai à me demander si dans une autre vie…
Au retour, les rues étaient vides. Avec la canicule, les personnes âgées devaient rester chez elles, de même que les populations à risque, du fait de la pollution de l’air : nourrissons, femmes enceintes, asthmatiques, malades des bronches ou du cœur… La ville appartenait aux véhicules, berlines climatisées et tout-terrains urbains qui densifiaient le nuage d’ozone, ainsi qu’aux chiens qu’on voyait somnoler à l’ombre des porches.
Je m’arrêtai au laboratoire où travaillait Elisa. Avec la chaleur, le bitume du parking collait sous les semelles. Le soleil s’y réverbérait, l’odeur donnait la nausée : je me réfugiai à l’intérieur du laboratoire. Les secrétaires me connaissaient, elles ne m’en firent pas moins patienter. Rassuré d’apprendre qu’Elisa se trouvait au travail, je remarquai leur nervosité, et que les téléphones n’arrêtaient pas de sonner. Au cours de la demi-heure qui suivit, je lus un reportage sur les mines de charbon à ciel ouvert, dans une de ces revues de géographie qu’on trouvait dans les salles d’attente des médecins. Déforestation, compactage des sols, ruissellement des eaux, pollution des nappes phréatiques menaçaient les écosystèmes des pays en voie de développement. Le journaliste les comparait à des ulcères, avec une clairvoyance qu’il n’imaginait sans doute pas. Enfin, Elisa apparut, grande et belle dans sa blouse blanche, comme avant. Je me demande ce qu’elle est devenue aujourd’hui : impossible de me convaincre qu’elle aussi soit morte…
Elle s’excusa de ne pas avoir répondu à mes messages, je répondis que j’étais rassuré de voir qu’elle allait bien. Dans son bureau, nous échangeâmes trois phrases sans conviction sur nos vies actuelles, elle ne voyait toujours personne, moi non plus, ses parents allaient bien. Son chien avait attrapé une maladie de peau en jouant dans une décharge industrielle. Fatalement, la conversation s’orienta vers la grippe asiatique.
— La propagation de l’épidémie nous inquiète, la contagiosité du virus est exceptionnelle. Des cas sont signalés sur tous les continents, et il semblerait qu’il ait déjà muté en se propageant. Pour le moment, une seule certitude : il va plus vite que nous. Des chercheurs étrangers sont sur le point d’isoler l’agent pathogène, on peut espérer qu’un vaccin soit mis au point dans les soixante-douze heures.
— Il y a des victimes ?
— Plus que ce que disent les médias. Une centaine de morts, tous en Asie. L’idée d’une quarantaine fait son chemin. Au moins un cordon sanitaire, pour laisser du temps aux laboratoires.
— « Un mal qui répand la terreur », murmurai-je.
— Quoi ?
— La Fontaine : « Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre »…
— Ne dis pas de sottises, Edouard. Celle-ci est particulièrement virulente, mais ce n’est pas la première épidémie à laquelle nous sommes confrontés. Ne serait-ce que pour ces vingt dernières années : le SRAS, la grippe A, le H5N1… La périodicité s’accélère à cause de la surpopulation et des voyages en avion, pas de la colère divine. Nul besoin de chercher dans le ciel, l’homme est en général le seul responsable de ses propres maladies.
Pauvre Elisa, elle ne croyait pas si bien dire. Je crus bon de terminer sur une note d’humour, qui n’a rien de drôle a posteriori :
— Responsable mais pas coupable ?
Ce soir-là, je retrouvai dans ma bibliothèque La peste écarlate, de Jack London, et me mis au lit tôt, sans dîner. Je m’endormis en lisant. London avait situé sa calamité un siècle après l’écriture du roman, c’est-à-dire au moment exact où je lisais. C’était il y a… Combien ? J’ai perdu le fil du temps. Six ans ? Huit ? Quoiqu’il en soit, je me souviens que la coïncidence me troubla. Ce soir-là, je fis le troisième rêve.
Quand le scorbut se déclara sur la caravelle qui le conduisait aux Indes, Pedro de Belalcázar s’en remit à Nuestra Señora de la Soledad, qu’on prie en Estrémadure. Un jour et deux nuits, agenouillé sur le pont, il implora non pas la clémence de la Vierge mais qu’elle l’accueille en sa sainte grâce. Secrètement, il espérait ne pas trop souffrir, pour avoir vu au cours de ses voyages trop de marins aux dents déchaussées, les membres gonflés, expirer en vomissant du sang, mais jamais il ne l’aurait avoué. Agoniser au fond d’une cale n’était pas un destin digne d’un Belalcázar. Une flèche de cannibale empoisonnée, un coup de couteau lors d’une rixe de taverne, un naufrage, telles étaient les fins que lui figurait son ambition, les soirs de boisson. Mais lorsqu’il releva finalement la tête, après le jour et les deux nuits de prières, miraculeusement épargné par la maladie, ce n’est pas la mer Océane qu’il vit, ni les rivages des Antilles où il comptait courir fortune, mais une clairière en pente douce, couverte d’une épaisse couche de mousse spongieuse. Une lune immense couvrait presque le ciel, on y devinait à l’œil nu les cratères et les moindres reliefs. Plusieurs de ses compagnons de voyages entouraient Pedro de Belalcázar, miraculés comme lui du scorbut. Il y avait là deux marins et quatre soldats, tous hommes forts et rompus à l’aventure, et un mousse dont c’était le premier voyage. Ils tinrent conseil, firent l’inventaire des armes qu’ils portaient sur eux, convinrent d’un ordre de marche et se mirent en route.
De l’eau s’écoulait sous la mousse, des fleurs sphériques y poussaient, dont s’échappait un gaz si on les crevait à la pointe de l’épée. Ils décidèrent de les éviter. Les arbres qu’ils finirent par atteindre n’étaient constitués que d’un tronc, sans branches, couleur de chair et de plus en plus fin vers son faîte, comme certains coraux qu’on trouve aux Canaries. Pour en avoir souvent tranché, les soldats assurèrent qu’ils ressemblaient au toucher à des artères humaines, souples et humides. Ils s’engagèrent dans la forêt. Des animaux qui rappelaient des écureuils écorchés vifs montaient et descendaient le long des troncs sans jamais s’aventurer au sol. Parfois, ils pénétraient dans les arbres par des trous semblables à des bouches, d’où s’exhalait le même gaz que des fleurs sphériques. Pedro de Belalcázar en embrocha un de sa dague, il constata qu’il était doté de trois paires de pattes, et que sa peau suintait désagréablement : il faudrait le faire sécher avant de le manger.
Après deux heures de marche, les arbres s’espacèrent et les Espagnols débouchèrent sur une plaine où l’eau qui s’écoulait de la colline faisait un marais peu profond, parsemé d’îlots de mousse. L’air y était moins respirable, comme saturé. Le même gaz jaunâtre stagnait à la surface sur quelques centimètres, si bien qu’on ne voyait pas ses pieds. Après l’avoir sondée de son épée, un des soldats s’aventura dans l’eau : le fond était solide, aucune algue n’entravait la marche. Après une pause, ils continuèrent de l’avant.
Comme la lune s’était progressivement éloignée, la lumière du soleil invisible qu’elle reflétait s’était atténuée. Le ciel s’était obscurci et ce fut le mousse qui distingua le premier les feux au loin. Ils s’approchèrent en ordre de bataille. C’était un îlot plus vaste, où les fleurs sphériques avaient des proportions telles qu’elles faisaient des dômes translucides sous lesquels on devinait des silhouettes. Parfois, l’une d’elles passait d’un dôme à l’autre, illuminée par une flamme qu’elle portait avec elle. Belalcázar fut d’avis de contourner l’îlot, les autres d’aller à la rencontre de ceux qu’ils croyaient être des sauvages caraïbes, imaginant s’être retrouvés par quelque prodige sur une mystérieuse île des Indes. Ils furent vite détrompés.
Les sauvages avaient forme humaine, quoique plus petits et dotés de branchies et de membres palmés. Leurs yeux étaient décalés sur les côtés du crâne et leur peau humide était couverte de plaques rouges légèrement boutonneuses. Le premier réflexe des Espagnols fut de brandir leurs armes pour occire ces monstres, mais l’accueil que ceux-ci leur firent s’avéra si chaleureux, et la situation si désespérée, qu’ils finirent par accepter l’invitation à pénétrer sous les dômes. La langue que parlaient les sauvages n’avait rien de chrétien, pourtant ils parvenaient à se faire comprendre et la nourriture qu’ils servirent aux Espagnols affamés était odorante et savoureuse.
On essaya de communiquer ce soir-là, à la lumière de ces flammes qui ne nécessitaient aucun combustible et que les sauvages prenaient dans le creux de la main pour les déplacer, sans se brûler. Les Espagnols s’y essayèrent, sans ressentir aucune chaleur. Les dômes étaient vastes, la mousse en avait été arrachée et la terre au-dessous, asséchée et creusée de fosses en guise de chambres. Le gaz jaune flottait contre le plafond et Pedro de Belalcázar soupçonnait qu’il n’était pas pour rien dans l’ivresse qui ressentait. C’est en tendant le bras pour désigner le gaz aux sauvages qu’il remarqua les plaques rouges. Les pustules y semblaient plus nombreuses et plus grosses que sur la peau des sauvages. Pris d’une soudaine démangeaison, il se gratta vigoureusement, libérant un pus malodorant. Les sauvages parurent étonnés : tous les Espagnols étaient couverts d’éruptions, déjà hémorragiques sur la peau délicate du mousse. Une croute noirâtre s’était formée là où Pedro de Belalcázar avait gratté, son dernier réflexe fut d’attraper son épée pour se venger des sauvages. Il mourut avant de l’atteindre, foudroyé par la fièvre, le corps ravagé d’ulcères sanglants.
Dans les mois qui suivirent, la variole dévasta les Antilles, décimant les populations autochtones, avant de frapper le Mexique. Rapidement, les Espagnols la mettraient au service de la conquête des Amériques…
Le lendemain, la presse titrait sur un nouveau massacre perpétré pendant la nuit. Sans terminer mon petit-déjeuner, je me précipitai devant la télévision pour mettre en marche l’enregistrement. Les images sur la chaîne d’information continue ressemblaient à celles des jours précédents, les commentaires de même. L’enquête piétinait, les journalistes se répétaient et les tueries se reproduisaient, monotones d’horreur. Rien de neuf, si ce n’est le nombre des victimes en augmentation et l’accélération du rythme des tueries. Sporadiques les premiers mois, quotidiennes désormais. Cette dernière avait été commise dans mon propre pays, à trois cent kilomètres environ. Aucun doute possible, ma ville se trouvait pile sur la route des tueurs.
Le journaliste énumérait précisément les mesures de précautions mises en place par les autorités dans la capitale, renforcement de la présence policière, renforts de l’armée, couvre-feu, au moment où la caméra zooma sur les badauds et où je vis mon frère, l’espace d’une seconde. Au passage suivant de la caméra, il n’était plus là.
Le cœur battant, je repassai l’enregistrement et fit un arrêt sur image : aucun doute possible, c’était lui. Mon frère, exactement tel qu’il était la dernière fois que je l’avais vu : la même queue de cheval, la même peau pale, comme si le temps n’avait eu aucune prise sur lui. Ses yeux seuls étaient plus noirs, et son visage d’une gravité que je ne lui connaissais pas. Comment se pouvait-il qu’il soit encore exactement tel que dans mon souvenir ? J’en fus troublé, sur le point de conclure à une ressemblance qui, pour frappante, n’en serait pas moins une coïncidence. Mais, comme je repassai l’enregistrement image par image, le plus invraisemblable m’apparut : tout d’un coup, cet homme que je prenais pour mon frère disparaissait. Non pas qu’il partait ou se cachait : d’une image à l’autre, il n’était plus là, et si le zoom n’avait pas tant pixélisé l’image, j’aurais juré qu’il adressait avant un regard à la caméra.
Comme à chaque fois que j’étais troublé, j’appelai Elisa. Après tout, Charlie faisait partie de son passé autant que du mien. Elisa avait grandi dans le même quartier que nous, elle avait un an de moins que moi, deux de plus que mon frère, elle avait toujours été amoureuse des deux, et nous d’elle. Je n’ai jamais compris pourquoi elle m’avait choisi. Charlie était plus attentionné, plus doux, je crois sincèrement qu’il l’aimait plus que moi. C’était un adolescent passionné, un jour il avait promis de lui offrir le monde, comme d’autres de décrocher la lune. J’étais plus âgé, plus mature, j’avais commencé de brillantes études de lettres, j’étais boursier ; Charlie était plus bohème, plus fragile, il vivait chez nos parents. J’ai toujours pensé que ceux d’Elisa l’avaient poussée vers moi et qu’elle le regrettait déjà bien avant notre divorce.
Plus de quinze ans avaient passés depuis que Charlie avait décidé de couper les ponts en allant vivre à l’étranger. Il m’avait parlé sincèrement, comme toujours : il voulait mon bonheur mais souffrait de la présence d’Elisa. Au mariage, son siège était demeuré vide. Nous sommes restés sans nouvelles pendant trois ou quatre ans, avant qu’il rappelle. Le tour du monde qu’il avait entrepris sac au dos s’était achevé en Afrique, faute d’argent. Il avait travaillé pour des ONG qui luttaient contre le sida, s’était amourachée d’une jeune fille qu’il traitait, ils s’étaient mariés, elle avait fini par mourir. Il me jura n’être pas malade, pour apaiser mes inquiétudes. Des années plus tard, une des rares fois que nous nous sommes revus, toujours en l’absence d’Elisa, il m’a avoué n’avoir jamais pris la moindre précaution, par amour et par désespoir, mais n’avoir pas été contaminé. Il parla de miracle, tristement, c’est alors que je compris qu’il était devenu croyant.
La mort de la jeune sidéenne le rendit particulièrement sensible au drame de Bao. Apprendre ma stérilité l’avait affecté, peut-être plus que moi, qui m’y étais résigné sans peine. La stérilité masculine devenait fréquente dans les pays développés, particulièrement en ville. Effets secondaires de la pollution et des pesticides sur la production de spermatozoïdes selon certains, j’y voyais plutôt pour ma part une forme d’autorégulation de l’espèce, son adaptation naturelle aux conditions de surpopulation : pour ne pas épuiser les ressources de la planète et conserver un équilibre, la nature réduisait la fertilité de l’espèce la plus prolifique. Les mauvais jours, je penchais plutôt pour une punition pour un crime que je ne savais pas avoir commis, et que je consacrais de longues heures à rechercher dans mon passé : on devient superstitieux dans le malheur, voilà comment sont nées les religions. Comme mes étudiants, je cherchais quel péché avait pu provoquer pareille malédiction, sans rien trouver que des fautes sans importance. Sophocle, toujours lui, me suggérait des rivalités fraternelles : l’absence de descendance serait-elle le prix à payer pour avoir volé Elisa à Charlie ?
Charlie compatissait. Parce qu’il retrouvait sa peine dans la mienne, me venir en aide l’aurait soulagé. L’hypothèse jamais formulée d’un don de son sperme s’immisça entre nous et nous éloigna de nouveau. Il n’en était pas question, c’était moi qu’avait choisi Elisa, c’était mon enfant qu’elle devait porter, celui de personne d’autre et certainement pas celui de mon rival, mon frère. Nous étions en froid sans l’avouer, et Bao est mort. Charlie s’est mis à me téléphoner plusieurs fois par semaine. Il vivait en Afrique du Sud, à l’époque, et coordonnait un projet de sensibilisation au sida dans les écoles des townships pour le compte de l’ambassade. La symétrie de nos deux destins l’obsédait : nous avions aimé la même femme, nous avions été frappés par un drame semblable, nous n’aurions jamais d’enfants. Sur ce dernier point, je ne sais pas pourquoi il en était si sûr, dans son cas. Il fit une fois allusion à un péché originel de notre lignée, qui l’avait condamnée à disparaître, sans rien préciser de plus. Je crois qu’il était devenu un peu mystique, il voyait dans ces similitudes des signes, je n’ai jamais su de qui ni de quoi. Qu’il ait consacré sa vie à la lutte contre le sida, sans que rien ne l’y prédispose, tandis qu’Elisa était devenue épidémiologiste, en était un autre. Il avait fini par se décider à lui reparler, et me convaincre. Mais le jour dit, il n’appela pas, ni les jours suivants. Il n’appela plus jamais. A l’ambassade, on était sans nouvelles. Il avait disparu, sans laisser de traces, sans violence apparente. Le gardien du lotissement privé où il vivait dans la banlieue chic de Johannesburg l’avait vu rentrer chez lui, et puis plus rien. Personne ne l’avait revu, jusqu’à ce qu’il m’apparaisse à la télévision.
Elisa ne répondit qu’au troisième appel. Elle était au laboratoire, débordée et nerveuse. « C’est bien le moment de réapparaître », maugréa-t-elle, et cette rudesse avec Charlie, qu’elle en était venue à considérer comme le fils qu’elle n’aurait jamais, m’inquiéta. « La contagion est plus rapide que prévue », s’excusa-t-elle en me faisant comprendre qu’elle m’en disait déjà trop : « achète des masques à la pharmacie et fais des provisions de nourriture et d’eau ». L’avertissement n’était pas à prendre à la légère, Elisa savait de quoi elle parlait et je la connaissais bien : prompte à s’émouvoir de tout, son sang-froid en m’annonçant à demi-mot l’arrivée de l’épidémie était préoccupant.
Je fis dans l’après-midi le tour des pharmacies du quartier pour trouver des boîtes de masques de protection respiratoire, du gel antibactérien et du paracétamol, et passai au supermarché pour les provisions. Je gardais au garage une réserve de chiffon pour calfeutrer les ouvertures, comme Elisa me l’avait enseigné lors des dernières menaces d’épidémie, et des joints en silicone. Le reste de la journée fut consacré à vérifier l’isolation des fenêtres. « Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur » : c’est en collant les joints que Le Masque de la Mort rouge me revint à l’esprit. La Mort blanche, Le Nuage pourpre, La Peste écarlate : la littérature aime à attribuer des couleurs aux épidémies. C’est sa limite, elle doit rendre visible l’invisible et compréhensible l’incompréhensible pour se justifier en tant qu’art. Si l’épidémie franchissait ces fenêtres comme la Mort rouge pénétrait dans l’abbaye fortifiée du duc Prospero, elle ne porterait aucun déguisement, je n’en saurais rien avait d’être contaminé : « Et les ténèbres, et la ruine, et la Mort rouge, établirent sur toutes choses leur empire illimité », c’est ainsi que s’achève la nouvelle d’Edgar Poe. Je réprimai un frisson et, au lieu de relire la nouvelle comme j’en avais d’abord eu l’intention, j’optai ce soir-là pour un documentaire sur l’extinction des dinosaures à la télévision.
Ce furent les sirènes des ambulances qui me tirèrent de ma somnolence. Je passai sur la chaîne d’informations : un nouveau massacre venait d’être commis, dans ma ville, à quelques rues de chez moi. Je sortis. Le chaos régnait dans le quartier. Les ambulances, les voitures de police, les camions de télévision qui se frayaient un passage le plus près possible des barrières que les gendarmes installaient en urgence pour contenir les premiers curieux, les appels radios, les sirènes, les cris des secouristes, les hurlements des voisins devant les murs de leurs maisons éclaboussés de sang, les chiens qui aboyaient leur terreur. Je fus un des premiers sur place. Une vingtaine de cadavres gisaient dans la rue, tous n’avaient pas encore été recouverts. C’est effrayant tout le sang que contient un corps, et comme il peut s’en vider vite avec de pareilles blessures. L’horreur que j’éprouvais se nuançait de soulagement : les tueurs n’avaient jamais frappé deux fois dans la même ville. Le tour de la mienne était passé, j’étais sauf. La honte pour le peu de compassion que je ressentais pour ces gens dont certains avaient été mes voisins a disparu ensuite, avec tout ce qui s’est passé. À quoi ma compassion leur aurait-elle servi ? Et puis, quelques morts de plus ou de moins…
Surtout, ce n’était pas la curiosité du massacre qui m’avait fait sortir de chez moi mais l’espoir de croiser le sosie de mon frère, pour en avoir le cœur net. J’attendis deux heures, avant de ressentir le froid. Il ne parut pas, je regrettai de n’avoir pas lancé l’enregistrement avant de sortir. J’étais décidé à rester encore lorsque je me souvins d’Elisa, de l’épidémie, des mesures de précaution. J’étais sorti sans masque. La foule qui se pressait autour des cadavres était propice à la contagion. Je rentrai finalement.
Cette nuit-là, je ne fis pas de rêve.
Le lendemain matin, après la douche, je descendis allumer la télévision : dans le salon, sur le canapé, mon frère m’attendait.”
III
« L’humanité est la véritable épidémie. L’homme en est l’agent pathogène mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède.
Telles furent les paroles que Xahu-la proféra en silence devant moi et que je ne devais jamais oublier. »
Il était assis sur le canapé du salon, tellement vieux, tellement changé. Il n’y avait plus rien en lui d’innocent, encore moins de fragile. Quelque chose de noir émanait de son être, qui obscurcissait la lumière autour et me dissuada de m’approcher pour le prendre dans mes bras. Mon premier sentiment ne fut pas la surprise ni la joie : ce fut de la peur, cette peur qui nous étreint en présence du sacré, de l’incompréhensible, de l’infini.
— Tu as vu mes signes, Eddy.
Ce n’était pas une question. Sa voix semblait provenir d’une planète perdue, et de très loin dans le temps, comme la lumière des étoiles mortes. Ce n’était pas une voix, une voix éveille des sentiments, c’était un faisceau d’ondes distordues par le voyage à travers l’espace, qui n’avaient plus rien de commun avec l’original. Ses lèvres bougeaient à peine, comme si parler lui coûtait, et il susurrait. J’ignore comment je trouvai le courage d’articuler :
— Tes signes ?
— À la télévision.
— C’était toi ? Mais tu étais…
— Plus jeune. M’aurais-tu reconnu autrement ?
— Je ne crois pas.
— Mais tu savais que je viendrais.
— Non.
— Et mes messages ?
— Quels messages ?
L’idée que l’être que j’avais devant moi aurait pu utiliser un téléphone ou m’envoyer un e-mail me parut absurde, comme s’il n’avait plus eu rien de commun avec l’espèce humaine, jusque dans le quotidien.
— Les rêves, Eddy.
— Les rêves ?
— Jebediah Scott. Nogaï. Pedro de Belalcázar. Je pensais que tu comprendrais…
— Que je comprendrais quoi ?
C’est alors qu’il m’a fait signe de m’asseoir, pas à côté de lui, sur une chaise, qu’il a fermé les yeux au cœur de son trou noir et s’est mis à raconter.
« L’humanité est la véritable épidémie. L’homme en est l’agent pathogène mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède.
Telles furent les paroles que Xahu-la proféra en silence devant moi et que je ne devais jamais oublier.
C’est arrivé pendant que je priais.
J’ai vu beaucoup de mes collègues perdre la foi, en Afrique. La maladie et ses souffrances ne leur semblaient pas compatibles avec l’idée de Dieu qu’on leur avait inculquée à l’abri de la peur et du besoin. Toi et moi n’avons pas eu d’éducation religieuse, nous n’avions rencontré de Dieu nulle part dans nos mondes : c’est dans la sphère microscopique d’un virus que je l’ai découvert.
Vingt-cinq millions de morts du sida imposent à la raison l’évidence d’un dessein. Paradoxalement, là où on n’en pourrait comprendre aucune, on cherche une volonté qu’on exonère de culpabilité. Parce que c’est injustifiable, on voudrait que ce soit justifié, pour se rassurer. J’ai cherché un Dieu suffisamment Dieu pour ne pas avoir à lui demander d’explications à ce qu’il faisait. À aucun prix je n’aurais voulu comprendre, comprendre aurait été accepter : j’avais seulement besoin de croire à une justification qui me dépassait.
Ma raison avait capitulé.
Je priais.
Je priais à cause des souffrances dont j’avais été témoin ce jour-là, comme chaque jour, et pour trouver la force de te téléphoner, de parler à Elisa après toutes ces années.
Je venais de rentrer chez moi, dans ce ghetto de santé où l’ambassade m’avait parqué. Des gens beaux et bien portants au milieu d’un océan de mal. Pas un océan. Depuis un avion, de nuit, Johannesburg est une de ces mers phosphorescentes que les marins décrivent dans l’océan Indien. De jour, c’est un désert. J’ai travaillé en Namibie, j’ai vu avancer le désert. Johannesburg est le reflet du Kalahari : une lèpre qui s’étend, une infection de peaux mortes, une gangrène. Chaque jour, je revenais du plus profond de la plaie, où grouille la vermine, vers les derniers tissus que je croyais sains. Et je priais pour que la maladie ne soit pas une maladie mais un signe, un projet : un remède. Malheureusement, j’ai été exaucé…
Je priais.
Je priais et, en relevant la tête, ce n’est pas mon appartement que je vis, mon refuge d’hygiène si semblable à cette maison où tu espères en vain te protéger de la contagion qui vient.
J’étais dans un arbre. Il me fallut plusieurs minutes pour le comprendre car la branche sur laquelle je me tenais était si large que je la pris d’abord pour une route sur un pont. Elle s’élevait en pente douce, l’écorce était parcourue de stries et on n’apercevait nulle mousse, nul parasite. C’était un arbre fort et sain, dont le feuillage épais me cachait le ciel et le sol. Que dire des feuilles, si ce n’est que trois êtres humains auraient pu se dissimuler derrière ? Malgré leur taille, elles étaient d’une finesse telle que la lumière filtrait au travers, baignant les branches d’une rosée verte qui imposait un silence sous-marin. Aucun bruit, si ce n’est une sourde pulsation de sève dont tremblaient les bulles d’ambres formées à la surface de l’écorce, et le halètement épuisé du vent dans les feuilles qui se balançaient imperceptiblement, comme avancent les continents. Le calme avant la tempête ? Il n’en était rien : ces arbres étaient là de toute éternité, ils n’attendaient rien, pas même mon arrivée. Ils étaient comme des planètes.
Je marchai le long de la branche, vers le bas. Dix comme moi auraient pu cheminer de front. Il me fallut une quinzaine de minutes pour atteindre le tronc. Je crus d’abord qu’une muraille me barrait la route : sa circonférence était telle que l’œil nu n’y devinait aucune courbure. Mais les stries étaient les mêmes et la pulsation de sève plus profonde. C’est en me penchant au bord de ma branche que je vis alors le sol, des centaines de mètres plus bas.
Il me fallut deux jours pour comprendre comment me laisser descendre le long des cosses des fruits de l’arbre. Essayer par le tronc avait failli me couter la vie : les stries n’étaient pas profondes et, plus bas, la sève perlait l’écorce. Les cosses mesuraient plusieurs mètres, les fèves sous l’enveloppe faisaient comme une échelle à laquelle il fallait s’agripper à plein bras. La surface était recouverte d’un duvet phosphorescent et je finis par toucher le sol le lendemain, couvert de peluche et sentant le sucre.
Je me trouvais sur les rives d’un lac d’ambre formée autour du tronc par les ruisseaux de sève qui s’en écoulaient. Le doigt dont j’effleurai la surface en sortit comme caramélisé. La plaine était infinie, parsemée d’arbres géants sur des îlots au milieu de lacs d’ambre. Impossible de définir la couleur du ciel : les phosphorescences des feuillages et de l’ambre se le partageaient et se mêlaient parfois en arcs-en-ciel. Sur les rives des lacs s’amoncelaient les cosses mûres. J’en ouvris une qui n’avait pas encore noirci, les fèves avaient un goût d’orge qui piquait un peu la gorge, j’en mangeai une entière. Repus, je fis d’une cosse un oreiller et m’endormis pour un temps que je ne saurais déterminer.
Du rêve que je fis, je ne me souviens que d’un gémissement de souffrance qui n’était pas de notre monde, une plainte millénaire dont frissonnaient la planète et tous les êtres qui la peuplaient. De quelle planète il s’agissait, et à quoi ressemblaient ces êtres, je ne saurais le dire.
À mon réveil, des hommes m’entouraient, occupés à vérifier si j’étais en vie. Ils étaient huit, et autant de femmes restées à l’écart, par prudence. Une fois prouvées mes bonnes intentions, elles s’approchèrent, et nous partageâmes des fèves. De ces nouveaux compagnons, deux seulement étaient africains, dont une jeune femme très belle qui me rappelait Ayssa, ma défunte épouse. Les autres étaient de type européen, sauf un Asiatique d’une carrure peu commune et une Maghrébine au crâne rasé sous un voile. Tous étaient vêtus à l’occidentale, quoique plusieurs aient déchiré ou taché leurs vêtements, et un petit type au teint mat ne portait qu’un caleçon. Ils s’étaient rencontrés dans la plaine les jours précédents. Aucun ne savait comment il s’était retrouvé ici, chacun raconta ce qu’il faisait juste avant : la cuisine, de l’exercice, la sieste, l’amour pour le type au teint mat. Certains étaient apparus dans la plaine, à même le sol, d’autres dans les arbres, d’autres dans des mares de boue qui, à les en croire, étaient les traces de pas de dinosaures. Quelqu’un affirmait même avoir vu le cadavre pris dans l’ambre d’une femme apparue dans un lac. Nous discutâmes des heures pour essayer de comprendre : nous venions de pays différents, qu’avions-nous en commun pour nous retrouver ensemble dans cette plaine ? Nous nous racontâmes nos vies, pour y trouver le dénominateur commun. Des heures plus tard, nous allions conclure au hasard lorsque la Maghrébine expliqua le pourquoi de son crâne rasé : elle venait de subir plusieurs mois de chimiothérapie pour une tumeur au cerveau. Le traitement avait fonctionné, la tumeur avait totalement disparu, elle était sauvé. Pour elle à qui on avait donné quelques mois de vie, c’était un miracle. À ce mot, je songeai que la foi pouvait être ce qui nous réunissait, mais au moins deux des hommes étaient athées. En y réfléchissant mieux, je finis par relier sa guérison et ma résistance au sida. Chacun y alla alors de son miracle : l’un avait survécu à un crash aérien, l’autre à un attentat à la bombe ; l’un avait passé six jours sous les décombres d’un immeuble après un tremblement de terre, l’autre avait reçu vingt coups de couteau sans qu’aucun organe vital ne soit atteint ; l’une prétendait avoir guéri de sa sclérose en plaques après un pèlerinage religieux, l’autre avait subi avec succès une greffe des deux reins. Voilà ce que nous avions en commun : nous étions des survivants, plus résistants que la plupart de nos semblables aux accidents et aux maladies, plus chanceux peut-être. Restait à savoir pourquoi nous étions réunis là…
La plupart de mes compagnons avaient en commun une forte personnalité et une capacité d’adaptation qui était une forme d’intelligence. Intelligents, certains l’étaient véritablement, et cultivés. Pas tous. Les hypothèses qui furent émises les jours suivants s’inspiraient de romans de science-fiction et de films fantastiques autant que d’hypothèses scientifiques. La plus convaincante reposait sur le nombre égal d’hommes et de femmes de notre groupe, si l’on comptait la femme morte dans l’ambre, tous des spécimens sains, particulièrement résistants et plutôt beaux dans l’ensemble : nous avions été sélectionnés pour repeupler cette planète où, après quelques jours, aucun être vivant ne s’était manifesté.
L’hypothèse ne tarda pas à être mise en pratique. A quelques kilomètres, nous trouvâmes un arbre que n’entourait pas complètement son lac d’ambre. Une péninsule de terre menait aux racines, où nous improvisâmes des refuges avec des cosses sèches. Refuge contre qui, contre quoi ? La température était idéale, aucune pluie n’était tombée, nous n’avions pas vu d’animaux : les refuges servirent à des couples improvisés à s’accoupler religieusement, en vertu de ce qu’ils croyaient leur mission : il est toujours surprenant de constater avec quelle rapidité une foi peut en remplacer une autre !
Pour moi, je n’étais pas certain que telle fût la volonté du Dieu que je m’étais choisi, et dont j’avais vu en Afrique les effets de la malédiction qu’il avait jeté sur nos relations sexuelles. Pourquoi voudrait-il ici encourager ce qu’il condamnait là-bas ? À moins que la véritable raison fût à chercher dans les souvenirs douloureux qu’éveillait la jolie africaine, une Rwandaise prénommé Prudence à qui il était évident que je plaisais. Enlevée toute jeune dans son village par des soldats, Prudence avait été contrainte à se prostituer durant des années avant de contracter une maladie vénérienne qui l’avait rendue inutile pour les militaires. Battue et laissée pour morte, elle avait été recueillie et soignée par des prêtres. Elle était saine désormais, m’avoua-t-elle comme si mes réticences à la prendre étaient de cet ordre, moi qui n’avais pas craint de m’offrir au châtiment de la maladie, par amour autant que par dépit amoureux.
La vie s’organisa autour de l’arbre, dont les fèves constituaient la base de notre alimentation. On ne pouvait rêver nourriture plus saine ni plus nourrissante, nous nous sentions tous en pleine forme, plus énergiques et plus forts que jamais. Dans la plaine, on trouvait des champignons, des baies et des tubercules tous meilleurs les uns que les autres. De l’eau s’écoulait en abondance des feuilles des arbres, dont les faîtes accrochaient les nuages. Rien ne nous manquait, qu’une explication à notre présence.
Pour y remédier, des expéditions furent organisées. Par groupe de trois, chaque jour dans des directions différentes, chaque jour un peu plus loin, nous explorâmes la plaine sans y trouver rien d’autre que des arbres, des lacs d’ambre et les pistes laissées par les dinosaures : aucun animal, pas même un oiseau, pas d’autre insecte que des vers, pas de relief, pas d’autres espèces végétales, rien que la phosphorescence de la plaine qui ne connaissait pas l’alternance des jours et des nuits, à perte de vue. Après deux semaines, ce fut mon tour de partir pour une expédition qui devait durer deux jours et deux nuits, la plus longue jusqu’alors. L’Asiatique et une Scandinave dont je n’ai pas retenu les noms m’accompagnaient, nous n’emportions rien d’autre que des bâtons de marche et un sifflet que la Scandinave, professeur de sport, avait retrouvé dans la poche de son survêtement, afin de donner l’alerte en cas de danger : dans le silence de la plaine, les bruits portaient à des kilomètres. L’eau et la nourriture n’étaient pas un problème, aussi longtemps que nous restions à portée des arbres ; or, aucune expédition n’en avait jusqu’à présent vu la fin.
Nous avons marché tout un jour en silence, sans rien voir de nouveau. Les traces des dinosaures mesuraient entre deux et quatre mètres, pour un mètre de profondeur, on distinguait les empreintes de trois doigts plus ou moins marquées. La terre sur les bords des traces était sèche, au fond un peu d’eau qui affleurait la transformait en boue. C’était une terre riche, grasse et odorante, qui donnait envie de la goûter. Les arbres géants y puisaient leur force et nous n’y vîmes jamais d’autre vie que de fins vers rouges de plusieurs mètres de long, qui s’enchevêtraient les uns aux autres comme un entrelacs de vivantes racines.
Le lendemain soir, après une journée semblable, c’est l’Asiatique qui suggéra de ne pas prendre le chemin du retour comme prévu. À quoi bon rentrer pour qu’une autre expédition s’aventure un peu plus loin quelques jours plus tard ? Nous avions des vivres, nous étions en pleine forme, autant mettre à profit le chemin parcouru en poussant plus loin. Les autres s’inquièteraient mais nous pardonneraient si nous leur rapportions une bonne nouvelle !
Nous avons continué. Deux jours plus tard, pour la première fois, le paysage se modifia. Les arbres jusqu’alors distants de plusieurs kilomètres se rapprochèrent jusqu’à confondre leurs ramures en un plafond végétal qui finit par nous cacher le ciel. La forêt se peupla d’échos sous cette voute cyclopéenne, et l’air se fit plus chaud. Les lacs de sève en se rejoignant formaient des réseaux de canaux et d’îles où l’herbe se contaminait de la rouille de l’ambre. De la brume se formait autour des racines des arbres, saturant l’atmosphère d’humidité. On progressait difficilement désormais, en cherchant l’air et son chemin dans le labyrinthe du marais. Imperceptiblement, au gré des langues de terre, nous nous sommes séparés. Loin devant, la Scandinave sautait par-dessus les canaux et avançait à grandes enjambées, confiant dans la portée de son sifflet. À ma droite, l’Asiatique tâtait prudemment les îlots de son bâton avant d’y poser le pied. La dernière fois que je le vis, il urinait dans une mare d’ambre. J’en fus gêné, sans savoir pourquoi.
Nous nous sommes perdus de vue. J’ai appelé, essayé de les rejoindre, de revenir sur mes pas, en vain. J’étais perdu. Dans la forêt plus dense, la brume s’épaississait. Plusieurs fois, je trébuchai, ma jambe entra en contact avec l’ambre, qui ne tarda pas à se solidifier autour. J’avançai désormais en boitant, sans savoir vers où, si je m’éloignais du camp ou si j’y revenais, persuadé que je mourrais dans cette forêt sinistre qui avait succédé à la plaine dorée, sans qu’aucune explication me soit donnée.
Des heures passèrent avant que je ne trouve le cratère. Dans la plaine comme dans la forêt, aucun relief jusqu’à présent, et soudain cette dépression d’une dizaine de mètre de diamètre sur trois ou quatre de profondeur, comme si une météorite était tombée là.
Sauf que le cratère était vide.
Du moins, c’est ce que je crus…
Ce fut d’abord une vibration intermittente, comme un courant alternatif, une oscillation électromagnétique, une respiration qui grésillait. Le silence du sous-bois s’en électrisa. En cherchant son origine, je m’aperçus que le fond du cratère paraissait plus obscur qu’il n’aurait dû, comme si l’ombre s’y concentrait, comme si l’air y laissait moins filtrer la lumière. Je distinguais les parois de l’autre côté, mais plus troubles et plus ternes, comme derrière un gaz ou à travers de l’eau. Alors, je discernai les contours d’une forme intangible et qui palpitait !
À l’effroi sacré qui me fascina, je me sus en présence du divin. Je me jetai au sol, autant pour me prosterner que pour me cacher les yeux. L’opacité tressaillit alors, et je reçus les premiers mots de Xahu-la, que je ne devais jamais oublier : « L’humanité est la véritable épidémie. L’homme en est l’agent pathogène, mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède ».
Ce n’était en réalité pas des paroles, rien de sonore ni de prononcé. L’opacité s’irisait d’impulsions électriques colorées qui formaient des images imprécises et changeantes, dont je ne perçus pas immédiatement le sens. Elles se dilataient et se concentraient périodiquement depuis le centre de la masse, comme les courbes d’un oscilloscope, rappelant les battements d’un cœur arythmique. Aujourd’hui que le temps a passé et que j’y ai souvent repensé, voici comment je traduirais en mots leur pulsation :
De toute éternité existent les planètes.
De toute éternité, leurs maladies.
De toute éternité les soignent les Xah-lel.
Combien de planètes avons-nous secourues ? Combien avons-nous vu succomber ? Combien de Xah-lel s’éteindre quand mourait la dernière planète de la galaxie qui leur incombait ?
Prends ici la mesure de l’infini, et tu pénétreras la mission des Xah-lel, et la vanité de toute humanité.
Jeunes, saines étaient les planètes, et fort leur système immunitaire.
Le cosmos résonnait de leurs palpitations de vie.
De nébuleuse en nébuleuse, leur organisme avait développé au fil des éternités
des mécanismes de défense contre les
microbes.
Dans le système Hah’l-Xi, les pores de leur écorce suppuraient de lave pour brûler les bacilles.
À Ll’lial, les pluies acides stérilisaient les germes :
Oh ! Le souvenir des arcs-en-ciel sur les terres purifiées après l’orage !
Les planètes de Jahil’u pleuraient pour éliminer les impuretés,
et leur surface disparaissait sous les larmes salées.
Par-delà la ceinture de Xahrx, où les galaxies sont plus anciennes, les planètes se contentaient de secouer avec fracas leurs plaques tectoniques pour se débarrasser des parasites.
Il y avait des gaz toxiques, des poisons, des chaleurs et des froids mortels, des mucus corrosifs, et des
anticorps
de toute sorte, avec des griffes et des crocs et des serres et tout ce qui sert à broyer et à trancher et à détruire les agents pathogènes.
Douce était alors la vie des Xah-lel.
L’univers était sain et silencieux.
La vie tournait sur elle-même et se réchauffait aux étoiles.
Rarement, nous intervenions.
Parfois, un abcès à extirper, une verrue à brûler.
Nous cicatrisions les plaies : les terres, les eaux, les forêts se refermaient.
En cas d’infection propagée, stimuler les systèmes de défense suffisait, immédiates étaient les réponses immunitaires,
réactifs les organismes planétaires parce que sains.
Rarement, nous eûmes à trancher dans le vif, rarement il fallut opérer : Axx 4 fut la première, que les Axx’ans sextupèdes avaient colonisée. La propagation de leur civilisation fut foudroyante, et la planète gangrénée.
Les Xah-lel se résignèrent à amputer :
dans la ceinture d’astéroïdes de Xahrx orbitent les parties d’Axx 4 sectionnées. Le virus des Axx’ans s’y est résorbé de lui-même, faute de cellules saines à parasiter.
Mais vieillirent les planètes.
Partout elles contractaient des espèces chroniques.
Certaines bégnines, qu’elles toléraient. Mais d’autres mutaient pour résister aux anticorps. De plus en plus virulentes et civilisées, elles épuisaient les ressources naturelles des planètes, déréglaient le fonctionnement de leur organisme, contaminaient leurs fluides, leurs laves, leurs eaux et leurs lymphes, détruisaient leurs anticorps, polluaient leur atmosphère, brûlaient leur surface couverte de chancres et de villes, attaquaient leurs fonctions vitales.
Les symptômes étaient partout différents mais les causes semblables.
Les planètes infectées se mouraient.
Quel Xah-lel oubliera jamais Le’ll, dans la galaxie de Lehel’ih, la première qui s’éteignit ? C’était une planète naine à la surface balayée de tempêtes de poussières. Pour sa riche teneur en fer, les Illumiens la colonisèrent. La lèpre d’asphalte qui gangréna bientôt toute sa surface l’asphyxia, les terres se sclérosèrent faute d’oxygénation et Le’ll succomba.
Oh ! Quand donc nous sera-t-il donné d’admirer de nouveau ses tornades d’oxydes ?
L’épidémie des Illumiens se propagea à travers Lehel’ih, jamais l’univers n’avait connu pareille contagiosité, pareille soif de métaux. Les soins de Xaha’r, dont c’était la galaxie, n’y suffirent pas. Les Illumiens devinrent endémiques. Le virus emporta les planètes les unes après les autres, sans que rien ne pût être fait qu’établir un cordon sanitaire afin d’empêcher sa propagation.
L’agonie de L’Eahal, une géante d’hydrogène qui lutta longtemps contre le mal, prolongea les souffrances de Xaha’r, qui le premier parmi nous s’éteignit.
Car sans planète à soigner, il n’est pas de sens à
l’existence des Xah-lel.
Telle est notre fonction, et il n’est de raison d’être pour aucune vie dans l’univers en-dehors de celle qui lui a été assignée.
Alors, nous comprîmes qu’il n’est rien d’éternel, ni les planètes ni les Xah-lel, et qu’en les soignant c’était nous-mêmes que nous protégions.
Il fallut concevoir de nouvelles thérapies, inventer des
traitements.
Tant de débris de planètes à travers l’univers témoignent de nos euthanasies !
Ce fut à Al’itl, de la galaxie géante de Xi 2, que revient l’idée du
vaccin
qui consiste à prélever des échantillons de mal sur des planètes infectées,
les inoculer sur des planètes saines
et réinjecter les anticorps produits sur la planète malade.
Difficile est l’opération, qui requiert aux Xah-lel énormément d’énergie pour transposer quelques spécimens,
et long est le protocole, qui exige de rechercher des planètes compatibles,
aux biotopes proches,
et que l’opération soit sans risque pour l’organisme sain.
Mais efficace est le traitement,
aussi désormais les Xah-lel soignent-ils ainsi les planètes contre les maladies qui existent de toute éternité,
et à l’échelle de l’univers le mal a reculé.
Mais petite est la galaxie qui m’incombe, et fragile ses planètes. L’une après l’autre, elles contractèrent des civilisations et moururent. Je ne pus rien faire d’autre que protéger ma préférée, la plus jolie à regarder, Xahu 3, que l’humanité nomme la Terre. C’est sur elle que se concentrèrent tous mes soins :
combien d’espèces mes chirurgies de météorites ont-elles éliminé de sa surface ?
Résistant au mal était l’organisme de Xahu 3 : ses périodes glaciaires le purgeaient périodiquement, les foyers d’infection étaient éliminés par tremblement de terre ou inondation, les éruptions volcaniques cautérisaient les plaies.
Aucune des maladies de ses voisines ne parvint à l’infecter, ni les Fongiens de Xahu 4, ni les terribles Eji’ans rampants de Xahu 1.
Mais par malheur, Xahu 3 finit par contracter
l’Humanité
dont le degré de contagiosité est élevé.
Ses défenses immunitaires s’affaiblirent. Dépassé le seuil épidémiologique, il me fallut me résoudre à la vaccination.
D’innombrables fois, j’ai prélevé des agents pathogènes sur Xahu 3 pour les inoculer sur des planètes saines d’autres galaxies :
vois comment se propagèrent sur ce que tu nommes Terre
la peste, le choléra, la variole
et tout ce que l’humanité à la folie de qualifier
d’épidémies.
L’humanité est la véritable épidémie.
L’homme en est l’agent pathogène mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède.
Mais, transplantés hors de leur milieu d’origine, les remèdes perdent de leur efficacité,
leur potentiel curatif s’amenuise, et
le taux de mutation du bacille humain est élevé :
l’épidémie n’a pas été complètement endiguée.
Désormais, Xahu 3 se meurt et je me meurs avec elle, ici sur Shiee’l où je vous ai inoculés pour une dernière tentative.
Malheureusement,
Shiee’l est tellement saine qu’elle n’a pas besoin de rejeter les corps étranger. Je me suis trompé dans mon dernier diagnostic, et n’aurai aucun remède à injecter.
Oh, Xahu 3, le dernier joyau de ma galaxie !
D’autres Xah-lel ont déjà pris le relais. Des planètes ont été inoculées, peut-être l’une d’elles produira-t-elle un antidote à l’humanité mais je ne serai plus là pour l’observer.
À moins que…
Il me reste à peine assez de forces pour te renvoyer, si tu voulais, pour sauver Xahu 3, pour me sauver, tu pourrais…
Je n’eus aucun doute, à ce moment-là. Le Xah-lel était devant moi, je pouvais toucher son intangible opacité : que valait désormais l’inaccessible Dieu que je m’étais inventé par désespoir de comprendre ? La pire des explications vaut toujours mieux que l’ignorance : ce n’était pas la raison d’être que j’avais imaginée pour l’humanité mais désormais, au moins, je savais. Il existait une justification aux maux que nous souffrions : le mal doit être éliminé. Toutes ces années consacrées à soigner les sidéens, je m’étais trompé. J’avais confondu le remède et la maladie et contribué à renforcer cette dernière, moi qui en étais un des symptômes. Toi qui n’as jamais eu la foi, peux-tu concevoir que s’inversent si facilement les notions de bien et de mal ? Avant Xahu-la, aucun Dieu ne s’était manifesté à moi. Guidé par quelques illuminés, j’en avais imaginé un, et inventé son message. Il y avait eu erreur et tromperie, mais à quoi bon les regrets désormais que je savais la vérité ? Ce n’est pas un pêché que de se fourvoyer dans l’obscurité ; c’en est un mortel que de refuser de suivre la lumière quand elle apparaît.
La révélation de ma condition virale me fut d’autant plus facile à accepter que Xahu-la m’offrait en même temps la possibilité de m’en extraire. Les images pulsaient de plus en plus faiblement à la fin de son message mais je compris l’invitation, et qu’il n’était pas d’autre moyen de retrouver un jour la Terre. Si Xahu-la mourait, je resterais à jamais sur Shiee’l. Isolé de mes compagnons, perdu dans la forêt, combien de jours survivrais-je ? Quand bien même je les retrouverais, j’ignorais quel avenir nous attendait. Un jour ou l’autre, nous rencontrerions les créatures qui avaient laissé leurs empreintes dans la plaine, et les anticorps élimineraient les corps étrangers comme je les avais vus faire de Jebediah, Nogaï et les autres, dans les visions de Xahu-la. Toi qui les as aussi vues, peux-tu me reprocher de n’avoir pas voulu connaître le même sort ? Il est plus aisé de se résoudre à devenir prédateur quand on a été la proie, que l’inverse, car par-delà toute morale prime le principe de survie. Et puis, comment accepter de ne plus jamais te revoir, mon frère ?
Je n’eus pas à poser de question. L’effroi provoqué par la présence de Xahu-la s’effaça aussitôt que ma décision fut prise et je sus qu’il me fallait pénétrer dans l’opacité. Je descendis dans le cratère. La résistance fut minime, comme dans l’eau. L’immatérialité d’un être aussi ancien me subjugua, je compris que ni la masse, ni le poids ni la densité n’ont à voir avec la puissance et tout mon être désira être libéré de la forme et la matière. « Tu le seras ». Je ne distinguai plus les visions car j’en faisais partie, mes palpitations s’adaptaient à leur pulsation, mon rythme cardiaque ralentit, j’embrassai le cycle du cosmos. Pénétrer dans l’opacité fut comme changer de dimension : la forêt disparut, il n’y avait rien au-delà des limites de Xahu-la, il n’y avait pas de limite, pas d’intérieur ni d’extérieur, le Xah-lel était l’univers et l’univers était le Xah-lel, je flottais parmi les sphères, dans l’éternelle paix du tout qui est celle du néant. Dans la perfection des orbites et des rotations de l’univers en expansion, je me sentis purifié. Dans mes atomes, la gravitation des électrons répétait celle des planètes autour des étoiles, la structure de l’infiniment petit rejoignait celle de l’infiniment grand, une continuité s’établissait entre toutes choses. J’allais participer à l’unité et à la pérennité du tout, j’avais cessé d’être une menace en reniant l’humanité. Je comprenais désormais le pourquoi des choses, et la place que j’y tenais. Toute autre gravité que l’attraction des astres disparut, je me sentis perdre ma corporéité. Je ne faisais qu’un avec le Xah-lel, avec le cosmos, en moi monta le dégoût de tout ce qui pouvait altérer son équilibre, le dégoût de ce que j’avais été. Avec l’immatérialité vint la pureté, et la haine du mal. Vide, je me sentais paradoxalement plus fort, plus vif, plus déterminé. L’axe de ma rotation venait de changer, la courbe de mon orbite inexorable. Le Xah-lel vivait en moi, je vivais en lui, l’énergie de l’univers circulait, je devinai ce que devaient ressentir les trous noirs…
Je quittai le cratère. Il n’était plus question d’images ni de mots entre Xahu-la et moi, nous ne faisions qu’un, son vide stellaire m’habitait, son opacité était dans mon ombre, j’étais son prolongement : sa main pour soigner, son scalpel pour opérer, le remède qu’il appliquait à la maladie qui rongeait Xahu 3.
Il fut facile de remonter la piste de l’Asiatique, qui ne s’était pas éloigné de plus de deux kilomètres. L’acuité nouvelle de mes sens était telle que la nausée me prit. L’urine, la sueur, la chair : le dégoût de la matière. Il était assis par terre. En me voyant, son visage s’illumina. Il se leva. Je m’approchai. Toute joie quitta son expression. Il recula. Je tendis la main vers lui : sa tête éclata.
Pas de sang sur les mains, pas de culpabilité : j’étais un remède.
L’image de la Scandinave m’apparut, marchant à grand pas pressés vers l’orée de la forêt. Qui sait comment nos cellules immunitaires sont attirées par les corps étrangers ? En revanche, on n’ignore pas comment elles opèrent : les lymphocytes secrètent de la perforine qui pénètre la membrane de la cellule infectée et la fait exploser de l’intérieur. Ainsi en fut-il de la Scandinave.
Le reste fut découvrir et contrôler mes nouvelles facultés. Les connaissances médicales acquises en Afrique m’y aidèrent. Si l’on compare avec l’organisme humain, je me définirais comme une cellule immunitaire macrophage. Elisa serait plus précise. Moi-même, j’ignore encore une bonne partie de mon potentiel de phagocytose.
Il ne me fallut que quelques minutes pour revenir au camp, dans les racines de l’arbre. J’expérimentai : des pseudopodes cytoplasmiques pour capturer ces antigènes qui avaient été mes compagnons et toutes sortes d’enzymes pour les détruire. Il fallut ensuite éliminer les cellules mortes pour prévenir tout risque de nécrose. Je conservai les particules de Prudence dans mon phagosome aussi longtemps que je pus. Par la suite, d’autres bactéries vinrent la remplacer.
Toute intrusion humaine éliminée, le risque d’infection était endigué. Je levai une dernière fois les yeux vers les arbres, fier de les savoir à nouveau sains. Shiee’l avait rejeté grâce à mon action les corps étrangers, ma mission était terminée. Cette fois, je ne priais pas lorsque Xahu-la me renvoya sur la Terre pour renforcer son système immunitaire : je pouvais désormais vivre sans peur car je savais comment faire le bien… »”
IV
“… vivre sans peur car je savais comment faire le bien.
Lorsqu’il s’arrêta, je pris conscience que Charlie avait cessé de parler depuis longtemps : les images de son récit pulsaient devant moi, dans la pénombre du salon, comme elles l’avaient fait devant lui sur Shiee’l, au cœur de l’opacité de Xahu-la. Aucun doute possible : l’effroi qui émanait de son être n’avait rien de terrestre, il suffisait à confirmer ses dires. Aussitôt que mon esprit se rendit à la vérité, le sentiment d’horreur cessa. Le Charlie assis sur mon canapé redevint celui que je connaissais, les rides moins creusées, les traits moins tirés, gommées même les poches d’ombres sous ses yeux : mon frère, la même famille et le même sang…
Et les mêmes cellules
ajouta-t-il en insistant sur le dernier mot. Bien sûr, il lisait dans les pensées et communiquait avec moi par télépathie, comme Xahu-la avec lui : serais-je capable moi aussi de…
Tu le pourrais si tu le voulais
résonna sa voix dans ma tête, comme une promesse ou une menace.
Des démangeaisons me vinrent au bout des doigts, un début de nausée que je tentai d’ignorer, un goût métallique dans la bouche :
— Pourquoi es-tu venu ?
Tu es mon frère, je veux te sauver.
— De toi ?
Je ne suis pas la pire menace pour l’humanité…
Il laissa sa phrase en suspens mais ouvrit sa main, dans la paume de laquelle une image déjà vue palpita :
D’autres Xah-lel ont déjà pris le relais. Des planètes ont été inoculées, peut-être l’une d’elles produira-t-elle un antidote à l’humanité mais je ne serai plus là pour l’observer.
Je compris :
— L’épidémie de grippe ?
Des êtres humains ont été inoculés sur une planète orpheline. Ces planètes qui ne gravitent pas autour d’une étoile échappent au contrôle des Xah-lel, et aucune n’avait été vaccinée jusqu’à présent. Comme elles flottent librement dans l’espace, elles sont moins exposées à la contagion que dans une galaxie. Les Xah-lel prenaient un risque : ou bien la planète orpheline ne possédait aucun système immunitaire pour n’en avoir jamais eu besoin, et elle serait anéantie ; ou bien ses défenses étaient fortes de n’avoir jamais été affaiblies par des virus. La réaction fut d’une virulence sans précédent. Immédiatement, la transfusion fut faite en Asie, afin d’assurer la transmission. Ce remède que tu nommes grippe, à un nom : la peste orpheline.
— À cause de la planète ?
Parce qu’il n’y en aura pas d’autre…
Le ton de Charlie ne souffrait aucune contradiction. Inutile de lui demander comment il savait : il ne faisait qu’un avec Xahu-la, dont l’agonie sur Shiee’l se prolongerait tant que la Terre ne serait pas définitivement morte. Des scènes de romans post-apocalyptiques me revinrent en mémoire : des petits groupes d’humains survivants repartant tant bien que mal de zéro, les récits du grand-père à ses petits-enfants dans la Californie dévastée par la peste écarlate. Comment nous protéger de la pandémie ? En nous cachant dans des caissons pressurisés, comme dans La Mort blanche, ou en fuyant dans les montagnes, comme dans La Peste écarlate ? Certains seraient-ils naturellement immunisés, comme dans les romans de Stephen King? « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Des images de singes peuplant la Terre après la disparition de l’humanité me vinrent malgré moi : la science-fiction n’offrait pas de solution…
— À quoi bon vouloir me sauver si nous allons tous succomber ?
Pas tous, Eddy. Pas moi. Plusieurs systèmes immunitaires peuvent collaborer dans un même organisme. Les anticorps ne s’attaquent pas entre eux.
— Si la grippe anéantit l’humanité, à quoi serviras-tu ? Tu cesseras d’être utile. Que deviennent les lymphocytes une fois les éléments pathogènes détruits ?
Les cellules macrophages n’ont pas pour seule fonction de neutraliser les cellules infectées : elles doivent en éliminer tous les résidus de particules pour éviter les nécroses. Imagines-tu combien de corps il faudra phagocyter après la guérison de la planète ?
Je préférais éviter, quel que soit le processus que mon frère comptait employer. Les « éboueurs de l’organisme », voilà comment les scientifiques surnommaient ces cellules. Cette fois, la décharge serait un charnier aux dimensions de la Terre : avais-je le choix de n’être pas qu’un détritus ?
Tu es mon frère, résonna la voix de Charlie. Tu peux être comme moi. À deux, nous serons un traitement plus efficace, nous contribuerons à la guérison de Xahu 3. Xahu-la nous récompensera. Quelques êtres humains survivants ne seront plus une menace. Mais…
Je n’étais pas capable de lire comme lui dans ses pensées mais je connaissais le mot qu’il n’osait pas prononcer. Malgré la terreur, les voyages cosmiques, les extra-terrestres et tant de morts et de sang, Charlie restait Charlie. Une pensée lui aurait suffi à me détruire, mais je gardais un avantage sur lui. Je le devançai :
— Elisa ?
Avec six ans de retard, les retrouvailles finirent par avoir lieu. C’est Elisa qui appela. Après le massacre dans mon quartier, elle s’inquiétait. La petite fierté que j’en éprouvais n’était destinée qu’à Charlie : quels que soient ses pouvoirs, quoi qu’il soit devenu, c’était encore pour moi qu’Elisa avait des sentiments, même après notre divorce. L’homme est ainsi fait : la Terre se mourait, l’humanité était condamnée, Charlie assassinait depuis des mois, et je me souciais encore de notre rivalité amoureuse. En fin de compte, je crois que j’ai toujours été jaloux de Charlie et que ses nouvelles prétentions à me sauver m’agaçaient. J’étais son grand-frère, n’était-ce pas à moi de faire quelque chose pour lui ?
L’inquiétude d’Elisa me prit au dépourvu : le massacre m’était complètement sorti de l’esprit. Ou plutôt, les révélations de Charlie me l’avaient fait passer au second plan. J’avais voyagé en pensée sur Shiee’l, appris l’existence des Xah-lel, découvert ma condition pathogène. Faut-il l’avouer ? En regard, quelques dizaines de morts perdaient leur importance. Avec le recul, aujourd’hui, je ne saurais dire si j’avais relativisé la tuerie au vu de la catastrophe qui s’annonçait ou si j’avais déjà intégré la nécessité d’éliminer l’humanité…
Elisa avait passé la nuit à travailler au laboratoire. L’épidémie s’étendait, l’OMS avait déclaré le seuil maximal d’alerte. Ce n’est qu’en allant petit-déjeuner à la brasserie qu’Elisa avait appris les évènements de la veille. Connaissant son professionnalisme, qu’elle s’inquiète pour moi dans ces circonstances de crise était touchant. Nous avions toujours des sentiments l’un pour l’autre. Notre couple avait pâti des longues années de la procédure d’adoption, et la mort de Bao lui avait porté un coup fatal. J’aurais aimé aider Elisa à surmonter cette épreuve comme elle m’a assisté quand ma stérilité a été diagnostiquée, mais je n’avais pas été à la hauteur. Est-ce que ses patients rendaient mieux à Elisa son dévouement que je ne l’avais fait ? Désormais je sais que si l’humanité est égoïste, c’est parce qu’un virus n’a pour fonction que de se propager. Quel soulagement que cette justification cosmique à mon individualisme ! Mais après tout, Elisa avait-elle fait autre chose en ne pensant toutes ces années qu’à enfanter ?
Je lui dis qu’il me fallait la voir dès que possible, c’était important :
— Édouard, qu’est-ce qui pourrait être plus important qu’une épidémie qui menace l’humanité ?
— Ce qui viendra après.
— Tu as lu trop de romans…
C’était vrai, mais ils ne m’avaient pas préparé à ce qui arrivait. Toujours, les fléaux qui mettaient l’humanité en péril y tenaient lieu de messages, de signes qui la poussaient à s’améliorer. Je cite La Peste de mémoire : « Vous pensez que la peste a sa bienfaisance, qu’elle ouvre les yeux, qu’elle force à penser ». Chez Conan Doyle, l’infection de l’éther servait d’avertissement, et les millions de victimes finissaient par se relever de la mort, comme si de rien n’était : la présomptueuse humanité n’avait pas pris la dimension de son insignifiance cosmique, mais tout rentrait dans l’ordre une fois la leçon apprise. Parfois même les virus finissaient-ils par se porter au secours de l’humanité menacée d’invasion, comme dans La Guerre des mondes. Pour autant, en littérature, nous étions punis pour ce que nous avions fait, pas pour ce que nous étions ; pour nos crimes, pas pour le simple fait d’exister. Les épidémies servaient de métaphores aux dangers qui nous menaçaient, la plupart du temps causés par nous-même : le fascisme et l’enfermement concentrationnaire chez Camus ; la guerre, le totalitarisme, le terrorisme chez Herbert ; l’Occupation sous la plume d’Aragon : « j’écris dans un pays dévasté par la peste… » ; tout ce qui met l’humanité en quarantaine, tout ce qui la décime. Mais quel auteur aurait imaginé de faire de la maladie la métaphore de son contraire : le remède ? Désormais, les valeurs s’inversaient et nous étions le danger. Les leçons de la littérature s’avéraient inutiles. Une seule solution pour l’humanité de s’améliorer : disparaître.
Elisa finit par accepter de me voir. Elle devait repasser chez elle se changer, je n’avais qu’à l’y retrouver.
Je montai seul. Elisa m’ouvrit en peignoir, elle venait de se doucher. Toujours la même odeur de rose. Le soleil entrait par les baies vitrées, l’appartement était climatisé, l’envie me prit de m’allonger sur le sofa et m’endormir près d’elle. Elle m’offrit un verre, je refusai. Je ne savais pas par où commencer. Tend la main, me commanda la voix de Charlie, resté en bas. Je m’exécutai. Dans ma paume, une image se forma. On y voyait une jungle, des arbres géants, une végétation en pleine santé qui s’entremêlait sur des amoncèlements de rochers. L’image grandissait au rythme de mon pouls, elle occupa bientôt toute la pièce. Les murs avaient disparu, nous étions dans le feuillage, parmi les grappes de fruits gigantesques et les mille couleurs des fleurs. Tout n’était que sève et suc et vie, la jungle palpitait. Elisa leva la main pour caresser des feuilles gorgées de suc. Lorsque l’image plongea des branches vers les racines, nous vîmes mieux les rochers sur lesquels la végétation poussait : c’était les ruines d’une cité.
Des immeubles, des maisons, des monuments que les racines éventraient, broyaient, engloutissaient. Champignons, lichens, humus : partout le vert avait repris ses droits. La paix régnait dans ce sous-bois vaste comme le monde, désirable et consolatrice. Elisa s’étendit sur ce sol où la végétation puisait sa force, et c’est alors qu’elle découvrit qu’il était parsemé de millions de crânes humains qui disparaissaient sous les mousses.
La vision prit fin subitement. Elisa était assise sur la moquette, des larmes dans les yeux. « Qu’est-ce que c’était ? », demanda-t-elle. Une réponse me vint, mais les mots n’étaient pas les miens :
Charlie est de retour…
Ce ne furent pas les retrouvailles que j’avais imaginées. J’aurais voulu accueillir Charlie, l’intégrer à ma famille, montrer que j’avais pardonné. Le protéger, comme avant. Un peu d’orgueil s’y serait mêlé, bien sûr, un peu de vanité d’aîné, mais la réconciliation aurait été sincère. On croirait à tort que les liens de famille s’effacent devant l’imminence la catastrophe, que rien ne subsiste de l’amour ou l’amitié : si c’était le cas, pourquoi Charlie serait-il revenu nous chercher ?
C’est ce que je pensais, alors : aujourd’hui, je sais que ses intentions n’étaient pas pures. Quoi d’étonnant, quand on sait ce qu’il était devenu ?
L’entrée de Charlie pétrifia Elisa, qui ne parut pas le reconnaître bien qu’il ait pris soin de se rajeunir. Le Xah-lel avait transmis à Charlie la faculté de modifier son apparence. Il existe des cellules pléomorphes, m’apprit-il, qui changent de forme en fonction de leur environnement. Mais quelle que soit celle qu’il adoptait, le malaise qu’inspirait sa présence persistait, cette terreur que produit tout ce qui dépasse l’entendement humain : la conscience de la mort. Elisa ressentit immédiatement que Charlie n’était plus celui qu’il avait été, et qu’il n’était peut-être même plus du tout. Il ne s’agissait pas de cette faculté qu’ont les femmes d’oublier ce qu’elles ont adoré : Charlie était mort, Elisa le savait. Il n’y eut pas la moindre émotion. Comme les cellules auxquelles il se comparait, l’existence de Charlie se résumait désormais à une fonction. Qu’il se soucie de notre sort paraissait en soi une entrave à la volonté de Xahu-la : les cellules n’ont pas de sentiment familial.
De longues secondes, Elisa demeura bouche bée, les yeux écarquillés, comme sur le point de s’enfuir horrifiée. Plus que ne pas reconnaître Charlie, elle paraissait ne pas le voir, ne pas comprendre ou ne pas accepter ce qu’elle voyait. Finalement, elle se tourna vers moi ; à partir de là, elle l’ignora et ce n’est qu’à moi qu’elle s’adressa. Depuis des années nous nous raccrochions en vain à l’espoir de revoir Charlie en vie : paradoxalement, son retour confirmait sa mort.
Je récitai la version que Charlie et moi avions élaborée. Impensable de raconter la vérité à Elisa : la scientifique aurait pu y adhérer mais la femme ne l’aurait jamais acceptée. Au fond, ma stérilité m’avait depuis longtemps préparé à cesser de croire en mon espèce. Résigné à ne pas avoir de descendance, j’admettais facilement qu’il en aille de même pour le reste de l’humanité. Mais Elisa était devenue biologiste pour se racheter d’avoir laissé mourir Bao, elle n’accepterait jamais la vérité. Il n’en allait pas tant de ses convictions que de ce qu’elle croyait être : une sorte de mère universelle. Inutile de chercher ce qui la poussait à soigner : aucun dégoût de l’ordre des choses, chez elle, aucune volonté de lutter contre ce monde de souffrance tel que Dieu l’a fait ; seulement, la frustration d’un instinct maternel assez fort pour le reporter sur toute l’humanité.
Pendant deux heures, je tentai de la persuader que l’épidémie ne pouvait pas être endiguée, que notre seule chance consistait à fuir la ville dès que possible. J’espérais qu’une fois seuls, l’humanité décimée, elle accepterait le prix de notre survie. Qui sait, peut-être même qu’elle nous aiderait à combattre la maladie : certains virus font passer des cellules infectées pour des cellules saines, voilà ce que je lui rappellerais pour la convaincre. Je lui rappellerais le Matteo du conte de Schwob, « accoutré en pestiféré » pour s’échapper des prisons d’Avignon, et qui finit par attraper la peste, parce que ce que l’on croit sain ne l’est pas toujours, et que parfois mal et remède sont une seule et même chose. Mais pour l’heure, comment la persuader du danger ? A chaque argument, elle répétait : « tu as lu trop de romans ».
Et Charlie dans ma tête : Laisse-moi lui montrer. Qu’allait-il faire ? Disparaître, se métamorphoser ou une de ces choses bien pires dont j’ai été le témoin depuis ? Il n’arriverait qu’à terroriser Elisa, jamais à la convaincre. Je la connaissais, elle trouvait toujours une explication rationnelle à tout. La vision de la jungle des crânes, c’était au surmenage de ces derniers jours qu’elle l’attribuait, au stress et au manque de sommeil. Laisse-moi lui montrer : il y avait dans ces mots une menace à laquelle je ne pouvais me résigner.
— Non.
Tu veux la sauver ?
— Pas comme ça !
Tu n’as pas le choix.
Pour la première fois, Elisa tourna son regard vers lui. En répondant à Charlie à voix haute, j’avais éveillé ses soupçons. Elle ne put le fixer longtemps des yeux mais trouva la force d’ordonner :
— Dis-lui de partir.
C’est ta dernière chance de la sauver.
Charlie n’avait pas dit : notre dernière chance. Il ne voyait pas Elisa, son regard se perdait au-delà d’une galaxie disparue. Son indifférence me décida :
— Je te rejoins en bas.
Je m’étonnai de le voir s’exécuter. Ses pouvoirs dépassaient ceux qu’aucun homme possèderait jamais, il en avait vu plus que personne et n’était plus vraiment humain, mais quelque chose en lui se souvenait que j’étais son aîné. Tant de puissance associée à une telle fragilité aurait dû m’horrifier : je n’en fus qu’apitoyé. Jamais plus je n’ai ressenti depuis ce sentiment pour lui…
Nous discutâmes encore un long moment. Elisa s’en voulait de m’avoir affolé en me conseillant d’acheter des masques, essayait de me persuader que la situation était sous contrôle. Dire que c’était elle qui tentait de me rassurer !
Je ne trouvais pas les mots, j’aurais dû savoir que rien ne la convaincrait : sans enfants, elle n’avait rien à protéger, ni moi qu’elle n’aimait plus, ni elle-même, rien d’autre que ses patients. Rien n’avait plus d’importance pour elle que l’humanité, et j’aurais dû la persuader de nous aider à l’éliminer ? J’aurais pu l’obliger, l’emmener de force, pour son bien. Qu’aurais-je sauvé ? Le corps d’Elisa, pas Elisa. Je n’avais pas réussi à en faire une mère, devais-je à nouveau lui infliger de se trahir ?
Le téléphone sonna. Elle écouta longuement, l’air atterré, et lorsqu’elle raccrocha, je sus que je l’avais définitivement perdue :
— Le virus a encore muté. C’est la première fois qu’un tel taux de mutation virale est constaté. Le vaccin que nous allions mettre au point est déjà obsolète. Il faut que j’y retourne.
— Il a muté ?
— La contagiosité s’est accrue. Le gouvernement va déclarer la fermeture des écoles et des services publics. Les vols internationaux vont être suspendus à titre provisoire, un cordon sanitaire est en train d’être mis en place aux frontières. Plusieurs pays ont décrété des mesures de confinement…
— Les victimes ?
— Des dizaines de milliers en Asie. Les habitants fuient les villes. Tu avais raison…
— Alors, tu viens avec nous ?
— Souviens-toi, j’étais loin quand Bao est tombé malade, impuissante, inutile. Il y a des millions de Bao qui comptent sur moi, cette fois. Je dois essayer de les sauver. Vous feriez mieux de vous dépêcher de quitter la ville, toi et Charlie, si c’est ce que vous voulez : bientôt, il y aura des embouteillages.
J’aurais voulu lui dire : que Charlie n’avait pas besoin de véhicule pour se déplacer, que les routes ne resteraient pas longtemps encombrées, qu’il n’y aurait bientôt plus de survivants pour fuir, qu’elle ne guérirait personne, qu’elle ne le devait pas, qu’il était dans l’ordre des choses que tous ces gens meurent, que je l’avais aimé, que je n’avais pas été à la hauteur, que j’aurais voulu lui donner un enfant mais que ce n’aurait été que pour le voir mourir avec le reste de l’humanité…
Nous descendîmes l’escalier, elle m’embrassa sur la joue, inquiète mais heureuse d’avoir un rôle à jouer, elle fit un signe à Charlie et partit. Nous la regardâmes s’éloigner. J’avais cru que ce serait la dernière fois que je la verrais…”
V
Il fit une pause, estimant que ses allusions suffiraient à faire comprendre à Elisa qu’il la savait parmi ses juges. Il percevait son agitation à travers le sac, et qu’elle se débattait entre colère et soulagement. Lui avait toujours su qu’elle était capable de survivre et de mettre au point un vaccin contre la peste orpheline. Se résigner à ne pas devenir mère l’avait rendue plus résistante que n’importe quel autre vibrion humain, la mort ne l’inquiétait plus depuis qu’elle avait renoncé à donner la vie. Mais elle, en revanche, se trompait sur son compte : elle le prenait pour un autre. Face à Elisa, pour la première fois depuis des années, il sentit qu’il aurait préféré faire autrement, ne pas accepter sa fonction, la tyrannie de la biologie, et la suivre ce jour où ils l’avaient vue s’éloigner vers son laboratoire. Sans doute serait-il mort, aujourd’hui, mais il le jugeait préférable au mépris qu’il endurait, toute cette déception qu’il percevait parmi les effluves d’effroi dans le tribunal. Il songea qu’il était plus facile de décimer l’humanité, cette concentration de bacilles anonymes, que de décevoir une seule personne qu’on a aimée. Pourtant, si son plan fonctionnait, il aurait bientôt tout le temps de se rattraper, et personne pour l’en empêcher : ni les miliciens qui n’avaient pas baissé la garde, ni les juges qui attendaient qu’il finisse son récit pour le faire exécuter, aucune épidémie ni même aucun Xah-lel. Et surtout pas son frère. Les couinements des rats géants s’était rapprochés, sans doute le sang versé la veille les attirait-il. Sans y accorder d’importance, il se demanda si les miliciens avaient pris soin d’enterrer son frère, malgré toute la haine qu’ils lui portaient. A même le sol ou dans un cercueil ? Qu’avait-on conservé des errements des anciennes traditions ? Vivant, un être humain menace la terre ; mort, son cadavre la fertilise. Les valeurs de bien et de mal inversées, avait-on accordé à son frère l’ultime rédemption du pourrissement ?
Il reprit son récit.
VI
“Nous n’échangeâmes pas un mot sur le chemin du retour, une absence nous accompagnait. Pas seulement Elisa, pas seulement l’amour, pas seulement le passé : l’idée que chacun d’entre nous s’était fait de l’après, en secret, venait de disparaître. Une question m’obsédait : à quoi bon survivre désormais ? Charlie lisait dans mes pensées, j’espérais que les mêmes doutes l’agitaient : par la suite, j’apprendrais qu’il se sentait plus partagé…
— Où allons-nous ?
Je ne parlais pas seulement du trajet mais aussi de l’avenir : Charlie se contenta de m’indiquer le chemin de chez moi. Comme Elisa l’avait supposé, nous croisâmes des véhicules au toit encombré de meubles et de paquets, des camionnettes surchargées qui crachaient une fumée noire, des gens qui fuyaient à pied, les bras chargés. Des effluves de mépris se dégagèrent de Charlie :
Quelle sorte de créature s’encombre de ses biens au moment d’être anéantie ? Vois, toutes ces choses, tout ce que ces gens possèdent, c’est une partie du mal qui ronge la planète : les produire absorbe de l’énergie, la planète s’en trouve affaiblie. La surconsommation fait partie de notre pouvoir pathogène, de notre ADN viral, c’est l’agent principal de notre potentiel infectieux. La déprédation est notre fonction.
À la maison, je nous servis deux verres de vin. Charlie m’adressa un regard sévère. Quoi ? Une vision pulsa : des vignes à perte de vue, des pesticides, des sulfates, les sols épuisés, les eaux polluées, bourbes, lies, levures, potassium, les poissons asphyxiés…
Assez ! La vision disparut. Tout ça pour un malheureux verre de vin ? Pas un, pensa Charlie : des milliards de litres produits, des millions d’hectares de terres cultivées : l’agriculture est une gale pour la Terre ; le bétonnage, un psoriasis ; les villes, un herpès. Des maladies de peau.
— Il nous faudra bien manger, objectai-je.
De la viande, car chaque espèce animale est une maladie : bénins, en incubation, en sommeil ou virulents, il est bon que les virus se détruisent entre eux. Mais l’agriculture est la gangrène de la planète. Les végétaux forment le tissu externe qui protège la terre, les arracher la rend plus sensible aux infections et aux brûlures des rayons solaires. Ne te préoccupe pas pour notre nourriture : nous phagocyterons !
— Nous ?
Le patrimoine génétique de certaines cellules peut-être reprogrammé : Xahu-la l’a fait pour moi.
— Tu peux le refaire ?
Tu cesseras d’être un bacille mais il te faudra assumer ta nouvelle fonction. T’en sens-tu prêt ?
Aujourd’hui, vous me jugez avec vos critères moraux intacts, que vous avez préservés dans vos complexes souterrains, toutes ces années au cours desquelles le monde s’écroulait, à moins que ce ne soit avec ceux de la nouvelle religion que vous vous êtes inventée pour vous justifier, ce vieux Pan que vous vénérez sans comprendre qu’il n’exige de vous que l’ultime sacrifice, l’holocauste final : l’immolation d’une humanité que vous l’imaginez protéger. Les droits de la Nature, n’avez-vous rien trouvé de mieux pour légitimer votre pouvoir ? La Nature n’a qu’un droit, le dieu Pan qu’une volonté : être débarrassé de l’humanité. Charlie et moi avons été son bras, à travers lui c’est nous que vous avez vénéré, nous que vous craigniez par-dessus tout : n’est-ce pas le propre d’un dieu d’être redouté ?
Mettez-vous à ma place, si vous en êtes capables, vous qui prétendez encore à l’humanité comme s’il s’agissait d’une valeur et non d’un virus à éliminer sans compassion, ainsi que Charlie et moi le faisions, comme une cellule accomplit sa fonction. Mettez-vous à ma place : persuadé que la grippe nous anéantirait tous, abandonné par la femme que j’avais aimée, avec un seul proche auquel me raccrocher, mon frère tout-puissant, dénué de tout sentiment. Ne croyez pas que j’essaie de me disculper, je ne cherche pas d’excuse mais qui aurait résisté au réconfort de ses pouvoirs quand la civilisation s’écroulait ?
Prophète d’une religion qui ne prônait aucun espoir collectif, Charlie m’offrait à moi seul un salut inespéré. En définitive, peut-être me figurais-je encore que l’Humanité pourrait survivre à travers moi, peut-être n’ai-je contribué à sa destruction que pour mieux la sauver. Parce que vous vous trouvez aujourd’hui devant moi, vous pensez qu’il existait d’autres voies : vous vous trompez !
Je dis me sentir prêt, il répondit qu’il était le fils de Xahu-la, venu pour en finir avec l’humanité, et que j’étais son frère de toute éternité. Étonnant que je n’aie, à ce moment-là, même pas eu une pensée pour nos parents : une cellule ressent-elle de l’amour pour sa cellule mère ?
Charlie prit mon poignet, posa deux doigts sur mes veines : elles s’ouvrirent proprement dans le sens de la longueur mais le sang ne gicla pas. Par la plaie, je le vis circuler normalement, sa vitesse m’étonna. Charlie en fit de même pour lui et joignit nos deux poignets. Il les serra si fort qu’une seule goutte perla sur nos peaux. Deux sensations se succédèrent. Pendant quelques secondes, en pénétrant dans ses veines, mon sang ne cessa pas d’être mien. Il n’abandonna pas mon organisme comme lors d’une transfusion, séparé de mes vaisseaux qui le transportent, coupé du cœur qui le propulse : au contraire, sa circulation s’étendit aux artères de mon frère, et ce fut comme si mon corps trouvait son prolongement dans le sien. J’eus la conscience de son anatomie et la sensation de pouvoir maîtriser ses membres, comme si je venais de gagner deux bras et deux jambes. J’en étais à me demander lequel de nos cerveaux commanderait à ce monstre lorsque le second phénomène se produisit : je sentis le sang de Charlie se répandre en moi. Se répandre est le mot, car l’accroissement que je venais de ressentir me parut d’un coup dérisoire : soudain, ce ne fut plus seulement avec le corps de Charlie que je communiquais, mais avec l’univers entier, comme Charlie l’avait fait dans l’opacité de Xahu-la : je palpitais de révolutions sidérales, en expansion au-delà de la galaxie originale de mon organisme, à la vitesse de la lumière, un Big Bang de perceptions en dilatation, suivant toutes les orbites possibles, à travers toutes les dimensions, jusqu’au plus opaque des Xah-lel, au fin fond du trou noir de leur pouvoir de destruction, jusqu’au plus haut de leur pouvoir de guérison…
Alors Charlie sépara nos poignets et je restai en suspension dans le cosmos, les yeux braqués sur la scène qui se déroulait dans ce qui avait été ma maison, à des millions d’années-lumière, où une cellule immunitaire venait de se dédoubler. De microscopiques particules colorées se répandaient dans la pièce : dans l’intensification de mes sens, je distinguais à l’œil nu les bacilles de la peste orpheline qui s’insinuaient par les interstices mal calfeutrés. La contagion venait d’atteindre la ville mais je n’avais désormais plus rien à craindre : les remèdes des Xah-lel ne se neutralisent pas entre eux.”
VII
“Vous connaissez la suite.
Une fois de plus, mon intention n’est pas de me disculper, mais le renforcement de nos pouvoirs par Xahu-la s’accompagnait de toute évidence d’un affaiblissement de la conscience morale. En laissant derrière moi ma maison et ce que j’avais été, tout doute m’avait abandonné, l’inversion des notions de bien et de mal était consommée. Dans le bouillon de culture de la ville, je savais devoir la vie à Xahu-la : une vie réduite à une fonction, mais une vie malgré tout. Pour justifier qu’il en fût toujours ainsi, il me fallait remplir cette fonction.
Rien d’impossible : elle me paraissait nécessaire, alors, dans le système de valeurs que j’avais accepté, d’autant que pour me convaincre je m’arrangeais pour lui donner les dehors de l’humanité.
Dans la rue, une sensation de déjà-vu me frappa : combien de romans et de films catastrophe m’avaient préparé à cette scène ? L’inconscient de l’Humanité s’exprimant en art n’avait cessé de la mettre en garde contre elle-même, de lui figurer sa fin, de l’avertir que le destin de tout virus est d’être éliminé. Aucun critique ni aucun psychologue n’a eu la clairvoyance de le déchiffrer, à moins que ce ne fût une question de courage. Les textes religieux ne disent pas autre chose : l’apocalypse est une guérison par le feu mais a-t-on déjà vu des bactéries s’inquiéter du paradis ?
Partout les gens fuyaient, sans comprendre qu’ils étaient eux-mêmes le mal et que la peste les poursuivrait où qu’ils aillent. « De cœurs qui n’en sauraient guérir, elle est partout accompagnée » prophétise Corneille dans La peste. Au milieu d’une telle foule, sous la canicule, la contagion était immédiate. Leur seule chance aurait consisté à s’isoler mais un microbe n’est pas par nature solitaire. La rue que Charlie avait stérilisée quelques heures plus tôt n’était plus qu’une artère gonflée de cellules infectées, un flux de sang vicié, coagulé au point d’à peine circuler. Une leucémie d’humanité qui rejetait sur les côtés les cellules cancéreuses. Les trottoirs étaient jonchés de malades épuisés par la fièvre et les toux sanglantes.
Microbe signifie « petite vie » : en voyant fuir ces insensés encombrés de leurs biens inutiles, doutes-tu encore qu’ils en soient ?
C’est vers ces moribonds que l’hypocrisie me poussa, au prétexte d’abréger leurs souffrances.
Une vieille femme d’abord, recroquevillée sur le trottoir, agrippée à une valise en peau. Que pouvait-elle contenir de si précieux ? Des souvenirs de sa jeunesse, de son défunt mari, de ses enfants ?
L’accumulation est une déprédation, répondit Charlie. Les plus vieux microbes sont ceux qui ont saccagé le plus longtemps.
Je tendis la main, le corps de la vieille femme implosa. Il n’en resta rien d’autre qu’une tâche de sang de trois ou quatre mètres de diamètre. J’étais tout éclaboussé.
Tu dois apprendre à contrôler tes pouvoirs, me gronda Charlie. Chaque action appelle une réaction proportionnée : telle est notre fonction. Ne gaspille pas ton énergie inutilement.
Ce fut ensuite un obèse, le souffle court, suant à même le sol ses excès de dévastation. Toute sa vie, il avait dévoré des tissus, détruit des cellules saines, saturé des organes d’enzymes virales, son virion avait été des plus virulents. Il payait désormais sa voracité, cellule hypertrophiée condamnée par sa propre fonction, sa pathologique boulimie de déprédation. Sectionné par la perforine au niveau de l’abdomen, son corps boursouflé rendit à la terre ce qu’il lui avait volé.
L’enivrement de mes pouvoirs me donna un temps l’illusion de l’impunité : des milliards d’humains allaient périr, qui s’inquièterait d’une vieille femme à l’agonie ou d’un obèse invalide ? Quelques fuyards s’étaient arrêtés, parmi eux deux policiers. Pas par solidarité, il n’en est pas entre vibrions, mais nous représentions une menace pour eux tous, ils le sentaient, nous devions être éliminés. Je me figeai, mon corps pris la couleur de la pelouse sur laquelle je me trouvais, ils en furent déconcertés, assez pour que Charlie passe dans leur dos. Six têtes tombèrent. Allons-y, maintenant. Nous nous mîmes à courir, Charlie au beau milieu de la foule en exode, comme un sérum se répand dans une lymphe infectée, et moi le long du trottoir, pour achever ceux qui s’y étaient arrêtés.
Nous avons participé activement au traitement, ce jour-là. Finalement, Charlie s’est éloigné du flux principal vers des artères secondaires. Je suivis, tout au succès de mes soins, sans m’apercevoir que nous nous dirigions vers le laboratoire d’Elisa.
Depuis, je suis arrivé à la conclusion que Charlie avait déjà l’intuition qu’un remède à la peste orpheline pouvait être trouvé, et peut-être même que la découverte en reviendrait à ce laboratoire. L’avenir lui a donné raison : à force de recherches, vous avez réussi à vous immuniser. Sans doute voulait-il l’empêcher. Mais à notre arrivée, le laboratoire avait déjà été évacué, et les scientifiques mis en sécurité, à des milliers de kilomètres. Charlie et moi avions une vague conscience de l’emplacement, du fait de notre lien avec Elisa ; pendant longtemps, même si Charlie ne l’admit jamais, nous cherchâmes à nous en rapprocher.
Des scientifiques ou d’Elisa ? Aujourd’hui encore, je n’en suis pas certain…
Nous avons quitté la ville. Les années qui suivirent, nous nous sommes consacré à guérir la planète avec autant de dévouement que Charlie en avait mis à soigner les sidéens. Il me fallut du temps pour contrôler mes pouvoirs, qui n’étaient pas à la hauteur des siens. J’allais moins vite, maîtrisais difficilement mes pseudopodes, mon processus de phagocytose était plus long, mes enzymes moins corrosives et mes métamorphoses imparfaites. Plus d’une fois, je fus blessé par balle. Ma membrane se reformait aussitôt, sans autre cicatrice que celles de mon orgueil car, pendant toutes ces années, Charlie ne fut jamais blessé. Lui tenait ses pouvoirs directement du Xah-lel, la déperdition était naturelle. Moins puissant que lui, je l’étais plus que n’importe quel autre être humain : mon amour-propre n’aurait-il pas dû s’en satisfaire ? Qui croirait la jalousie possible entre deux cellules sœurs ? C’est en découvrant en moi des résurgences de sentiments humains, chaque fois que Charlie étalait sa supériorité ou qu’Elisa me manquait, que je trouvais une autre explication à mon efficacité moindre : ayant mieux que moi accepté sa nouvelle condition, libre de scrupules et des chaînes morales, Charlie se trouvait plus à même d’exercer sa fonction.
Pourtant, il me semble avoir sincèrement adopté la doctrine de Xahu-la et intégré notre condition virale. Je la portais en moi, je l’avais toujours soupçonnée, c’est pourquoi ma stérilité ne m’était jamais apparue comme un mal. Au fond, je ne m’aimais pas : découvrir ma nuisibilité fut comme trouver finalement la cause d’un problème. Pourtant, j’hésitais : est-ce que je n’aimais pas ce que j’étais ou qui j’étais ? Est-ce le virus que je rejetais en moi, ou le type de virus que la vie avait fait de moi, égoïste et insensible ? Après tout, peut-être les explications de Charlie étaient-elles arrivées à point nommé pour donner un sens à mes angoisses, comme ces fanatiques qui trouvent plus rassurant d’être des pécheurs que de n’être rien. Leur culpabilité les justifie. Or, la conversion avait été d’autant plus facile, dans mon cas, que j’avais accepté en même temps ma condition de pécheur et la rédemption. Souvent, j’ai pensé que cette double circonstance avait facilité mon adhésion à la doctrine de Charlie, et douté que l’humanité entière méritât d’être condamnée sur la seule base de mon dégoût de moi-même.
Nous avons détruit des cellules infectées par milliers. Rien en comparaison des centaines de millions de victimes de la peste orpheline, mais Xahu-la se satisfaisait de notre traitement d’appoint. Charlie et moi étions un instrument adapté à l’intervention chirurgicale de précision : là où la peste avait extirpé les tumeurs, nous intervenions pour cureter les résidus d’infection, repérer les cellules malignes endormies et prévenir tout risque de nécrose. Nous traquions les survivants dans les zones infestées pour empêcher qu’ils se regroupent en métastases et éviter les rechutes.
Xahu-la s’était remise. Au fur et à mesure que l’Humanité succombait, le Xah-lel avait repris des forces, quitté Shiee’l et retrouvé sa place au chevet de notre galaxie. La santé de la planète garantissait la sienne. Inutile de vous rappeler à quelle vitesse se produisirent les changements climatiques après la pandémie. Aussitôt les usines à l’arrêt, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre cessa. Parallèlement, le trou dans la couche d’ozone commença à se résorber beaucoup plus vite que ne l’avaient supposé les scientifiques. Les premiers mois, des survivants se livrèrent autour des dépôts de carburants à des batailles qui ne contribuèrent qu’à éliminer plus d’êtres humains et faciliter la propagation de la peste. À chaque intervention, Charlie et moi prenions le soin de mettre le feu aux hydrocarbures, pour cautériser les plaies. Bientôt, le rejet de dioxyde de carbone fut minime, le réchauffement climatique endigué. Après quatre ans, la température avait baissé de trois degrés. Au pôle, la banquise s’est reformé, les glaciers ont repris leur progression dans le monde entier. Le refroidissement fut moins propice à la transmission de la peste, mais on ne comptait alors que quelques millions de survivants et de nouveaux remèdes complétaient la thérapie des Xah-lel, la planète en voie de guérison s’étant remise à produire des anticorps.
Fertilisés par les centaines de millions de cadavres en décomposition, les sols naguère épuisés par les cultures intensives se fortifièrent. Enrichies en nitrates, sels minéraux et oligoéléments, la terre devint partout grasse et fertile. Leurs larves se nourrissant en abondance dans les cadavres, la taille des insectes augmenta, particulièrement les vers qui favorisèrent l’aération des sols et l’élimination des polluants. Certains spécimens atteignent aujourd’hui le mètre et leurs déjections contribuent à la croissance des plantes. Depuis lors, les mouches pullulent, et les différentes espèces animales ont appris à vivre à milieu des nuées. Mais ce sont surtout les végétaux qui ont bénéficié de la restauration des sols. Sur un humus aussi riche, la forêt ne tarda pas à reprendre ses droits. D’abord dans les villes, que jonchaient les cadavres : les parcs et les espaces verts, les pelouses, les jardinets se couvrirent d’une végétation luxuriante dont les racines ne tardèrent pas à crever le bitume. La vision que nous avions eue dans l’appartement d’Elisa ne tarda pas à devenir réalité. Après les villes, ce furent les campagnes, et le monde fut bientôt recouvert de forêts humides qui contribuèrent à la modification du climat. De nouvelles espèces de végétaux apparurent, et avec elles de nouveaux pollens et de nouveaux poisons. Des plantes urticantes, des plantes psychotropes, des plantes toxiques pour l’être humain. Les moisissures des corps en putréfaction donnèrent naissances aux champignons qui pullulent aujourd’hui, et dont la taille dépasse, pour certaines amanites, celle des arbres d’autrefois. S’agit-il d’espèces nouvelles ou qui avaient disparu ? La réapparition d’anciennes maladies éradiquées par l’homme fait pencher pour cette dernière hypothèse. La diphtérie, la gale et le choléra avaient été des réponses immunitaires de la Terre, du temps qu’elle était capable de se défendre contre les infections, avant que les Xah-lel aient dû recourir au vaccin : elles réapparurent désormais que la planète entrait en rémission. Les ravages furent terribles, de même que ceux des asthmes provoqués par les nouveaux pollens.
Les moustiques et les rats avaient favorisé la propagation de la peste orpheline, tout se passa comme si la Xahu 3 récompensait leurs services : les premiers proliférèrent dans l’atmosphère humide des forêts et assurèrent la transmission rapide des nouveaux remèdes ; les seconds mutèrent jusqu’à atteindre la taille de porcs. Regroupées en meutes de centaines d’individus, ils devinrent pour l’être humain les prédateurs redoutables que l’on connait aujourd’hui.
Tous ces facteurs se combinèrent et bientôt d’immenses portions de continent furent assainies, et les foyers infectieux circonscrits. Par un tremblement de terre ici, un tsunami là, Xahu 3 réagit de façon appropriée. Nous avions pallié à sa déficience immunitaire, les humains étaient désormais si peu nombreux qu’il suffirait aux Xah-lel de mettre la planète en observation pour s’assurer de la convalescence. L’équilibre semblait restauré mais, quelque part dans un complexe souterrain, ces chercheurs que Charlie et moi avions traqué sans succès finirent par mettre au point un vaccin contre la peste orpheline : c’était la rechute.
Charlie l’avait deviné. Moi aussi, j’en avais eu le pressentiment. Je savais que vous réussiriez, mais trop tard pour sauver l’Humanité. Vous seriez peu nombreux à survivre, vous ne représenteriez plus une menace. C’était mon espoir : l’organisme de Xahu 3 ne réagirait pas contre votre pathologie bégnine. Vous auriez résisté au traitement sans plus représenter de menace, l’équilibre serait rétabli. C’était oublier cette vérité : un virus n’a pour fonction que de se développer.
Pourquoi a-t-il fallu que vous vous réorganisiez ? N’auriez-vous pas vécu heureux, en tribus isolées dans les forêts ? À cueillir trop peu de fruits pour démanger la planète, à chasser assez de gibier pour contribuer à votre tour à l’élimination d’un agent pathogène ? Maladie et remède à la fois, comme on trouve des parasites utiles à leur hôte : une interaction durable qui assure l’équilibre du milieu naturel.
Pourquoi croyez-vous que Xahu-la vous ait laissé mettre au point un remède à la peste orpheline ? L’Humanité ne devait pas disparaître totalement, les microbes sont nécessaires au bon fonctionnement d’un organisme, aussi longtemps qu’elles ne le colonisent pas. L’agent pathogène éliminé, Xahu 3 en aurait perdu à la longue la mémoire immunologique, n’aurait plus produit d’anticorps spécifiques et se serait trouvée vulnérable en cas de nouvelle infection humaine.
Un petit nombre d’entre vous devait survivre, mais il a fallu que vous vous rassembliez, que vous organisiez, que vous bâtissiez. Qui pouvait penser qu’il vous faudrait si peu de temps pour répéter les erreurs du passé ? Vous vous êtes multipliés, la réplication virale fut foudroyante. Aussi évoluée semble-t-elle, l’Humanité est le plus primitif des parasites, qui détruit son hôte sans se soucier de sa propre destruction. L’instinct nous commande de nous multiplier pour nous protéger, c’est en réalité œuvrer à notre destruction. De quelle autre engeance l’instinct contribue-t-il à la disparition ? Nous sommes une espèce irrationnelle, c’est une aporie de l’Histoire que nous ayons survécu si longtemps. Charlie avait raison : la déprédation est notre fonction. L’humanité existe pour accumuler. Les animaux s’autorégulent naturellement, dans leur nombre autant que dans leur désir, c’est en cela que nous sommes plus proches des virus : nous colonisons, nous nous démultiplions, nous épuisons notre milieu d’accueil et nous disparaissons si nous ne trouvons pas d’autre organisme à coloniser. Pourquoi ferions-nous tant d’enfants, sinon ? Pourquoi les familles d’avant la peste orpheline en avaient-elle trois ou quatre, parfois plus? N’aurions-nous pas pu nous satisfaire d’un seul ? L’amour n’était pas en cause, on n’aime pas plus deux enfants qu’un seul. Mais il y avait le pouvoir, et l’orgueil de la multiplication de soi. Pour les primitifs, des enfants représentaient des bras, une force de travail, de la richesse : un clan, de la force, la survie dans un milieu hostile. Pourquoi les religions auraient sacralisé la famille, sinon parce qu’elle assurait la perpétuation de l’espèce en garantissant la reproduction ?
Du pouvoir, encore du pouvoir, jusqu’à l’anéantissement !
Mais qu’en était-il des hommes civilisés que nous croyions être, dans un environnement dominé qui ne présentait plus aucun danger, où les risques s’étaient même inversés ?
Rien d’autre que la peur de la mort, le désir de se prolonger longtemps et beaucoup : de la vanité… Posséder du temps comme on possède de la terre et des biens. Se perpétuer : le vrai pouvoir, la raison d’exister. Le paradoxe du règne de l’individu : se prolonger dans d’autres, se reproduire autant que possible, sans se soucier de l’équilibre de son milieu. Accumuler, accumuler tellement, finir par s’accumuler soi-même. Toute procréation est une déprédation. Qui d’entre vous osera encore appeler amour notre parasitisme ?
Vous avez recherché les survivants et les avez rassemblés dans vos complexes souterrains. Chacun s’est vu attribuer un rôle, votre service de sécurité a entraîné des soldats, certains se sont chargés de l’approvisionnement et d’autres des tâches subalternes. Vous avez recréé des hiérarchies, des classes sociales et des castes. Qu’est-ce qui a pu vous rendre si pressés de rétablir les inégalités résolues par la peste ? Est-ce l’idée que vous vous faites de la civilisation : chacun à sa place ? De tels ordres existent chez les fourmis et les abeilles : comme elles, ce n’est que l’instinct qui vous a poussés à reproduire les seuls modèles que vous connaissiez, injustes et primitifs. Une société, l’autre nom des virus. Pourquoi pas une organisation horizontale, qui aurait préservé les équilibres naturels ? L’égalité entre les parasites, voilà la condition de la santé de l’organisme hôte : pas de compétition, pas de croissance, pas de déprédation du milieu. Mais vous êtes un virus, et les virus songent-il à restreindre l’infection ? Je me souviens qu’avant l’épidémie, certains théorisaient la décroissance : ces fous ignoraient que nous n’existons qu’en proportion de notre contagiosité…
Pour vous justifier, vous avez même inventé un dieu. Vous, des scientifiques, des docteurs, des biologistes : inventer un dieu ? L’ancien avait permis la peste orpheline, il ne vous servait plus à rien, il a fallu le remplacer parce qu’un dieu est la pierre angulaire de vos sociétés : qui, sans volonté supérieure, accepterait l’injustice de sa condition ? Alors, vous avez ressuscité le vieux dieu Pan des Grecs. Un dieu de la nature, après ce qu’elle vous avait fait ? Alors que vous vous apprêtiez à reprendre la contamination là où vous l’aviez laissée ? J’ai cru d’abord à de la mauvaise conscience : vous la vénériez pour qu’elle vous pardonne de l’avoir dévastée, comme l’Humanité priait le Christ qu’elle avait crucifié. Mais depuis quand un parasite est-il reconnaissant à son hôte ? J’ai compris alors que ce n’était que de la peur, une peur primale après la violence du coup que la nature vous avait porté, comme les tribus sauvages adoraient la foudre, le tonnerre et le feu. Revenir aux premiers âges, des scientifiques comme vous ? Non, ce n’était pas vous qui aviez peur : vous jouiez sur la peur des inférieurs. Pour qu’ils ne sortent pas de votre refuge souterrain, pour les garder sous votre coupe, esclaves de votre ambition de reconstruction, vous inventiez un démon qui rôdait dans les bois en quête de proies, un bouc qui menait les troupeaux de rats géants au son de sa flûte, la colère de la nature incarnée.
Ainsi, vous avez assis le pouvoir de ce tribunal, votre plus haute autorité, sur la peur. Vous vous prétendiez scientifiques et législateurs, vous voilà prêtres d’une nouvelle foi. Fallait-il nécessairement en passer par là pour poser les fondations de votre société ? L’injustice pour parvenir à la justice, la force pour établir le droit, la superstition pour faire triompher la science ? Ce sont des arguments dont je me souviens avoir débattu, du temps qu’enseigner la littérature avait encore du sens.
Or Pan était aussi une divinité de la fertilité. Vous avez encouragé les vôtres à procréer. Plus nombreux, vous seriez plus puissants. Le plan a parfaitement fonctionné. Comme il est dans votre nature, vous vous êtes démultipliés, à tel point que vos complexes souterrains n’ont plus suffi à vous contenir. Il a fallu sortir, coloniser les ruines de cette ville où vous m’avez mené, lutter contre la nature qui l’avait reprise, désherber, déraciner, défricher. C’est alors que Xahu-la vous a retrouvés…
Vous n’ignoriez pas qui nous étions, Charlie et moi. Les premiers temps de la peste, avant l’arrêt des télécommunications, on nous avait recherchés. C’était nous faciliter la tâche, et les commandos lancés à notre poursuite ne revenaient jamais. Les vagabonds racontaient sur nous des histoires qui les faisaient passer pour fous. Qu’auraient-ils eu besoin d’exagérer ? Plus tard, les communautés de survivants en ont gardé le souvenir, comme une peur atavique. Nous étions un mythe, dont l’existence devint douteuse avec les années. C’est nous, pas Pan, que vous devriez vénérer ; nous qui personnifions vos terreurs. Parliez-vous de nous à vos enfants pour qu’ils restent sages ? Vous avez fini par espérer notre disparition : l’Humanité anéantie, nous n’avions plus de raison d’être. Au fond, vous saviez que nous incarnions la vengeance de la nature, nous existerions aussi longtemps qu’elle serait menacée. La question était : représentiez-vous encore une menace ? Le jour où vos guetteurs nous ont vu arriver, vous avez su la réponse.
Charlie et moi n’avons mis que quelques minutes à désinfecter la ville. La plupart des vibrions éliminés ce jour-là étaient jeunes mais les plus résistants se sont retranchés dans le complexe souterrain. Vous étiez profondément enkystés, c’est pourquoi Xahu-la n’avait pas opéré comme sur un autre continent quelques mois auparavant, où une météorite avait éliminé une tumeur assez semblable à la vôtre, quoiqu’à un stade moins avancé. Du moins, je supposais que c’était la raison ; aujourd’hui, je me demande si Charlie n’avait pas tout manigancé…
Aperçue jusqu’ici, l’étoile filante du Xah-lel a été interprétée comme un signe de Pan, l’annonce du renouveau. Vous, les scientifiques qui croyiez savoir qu’un météore n’est qu’un fragment d’astéroïde qui pénètre dans l’atmosphère terrestre, vous n’avez rien fait pour détromper les gens. Quelle ironie qu’ils aient finalement été plus près de la vérité que vous !
Mais si notre vitesse dépasse la perception humaine, nous ne pouvons pas nous téléporter : impossible pour Charlie et moi d’entrer dans votre complexe souterrain, conçu pour résister aux retombées nucléaires et aux attaques bactériologiques. Quelle ironie du sort que le virus se trouvât désormais à l’intérieur ! Sous prétexte de vous protéger, vous vous étiez vous-même mis en quarantaine. Nous aurions pu surveiller les issues en attendant de vous voir mourir mais nous ignorions combien de temps vos réserves de vivres vous permettraient de tenir. La solution ne plaisait pas à Charlie, qui prétextait le temps qu’aurait pu durer la quarantaine, les doutes que nous aurions quant à la disparition de toute cellule cancéreuse et la nécessité de cureter au mieux pour éviter la rechute.
Que nous importe le temps ? m’étonnais-je. Je sais désormais qu’il avait d’autres raisons de vouloir entrer. En réponse, il évoqua le cheval de Troie. Je trouvais l’allusion facile. La culture de Charlie a toujours été limitée. Dans sa jeunesse, il préférait la guitare aux livres, ses références se limitaient à des chansons d’amour et autres mièvreries. J’avais essayé de faire son éducation mais partout il passait après moi et souffrait de la comparaison. Sa guitare, ses ballades et tout son romantisme lui avait été de peu d’utilité pour conquérir Elisa…
Pourtant, la référence était plus appropriée qu’il n’y paraissait : c’est pour enlever Hélène que les Grecs pénètrent dans Troie grâce au cheval. Me souvenant de Nogaï et sa sœur Akha, je comparais plutôt la situation à Caffa assiégée par les Tatars, et à l’apparition de la peste noire.
Nous ne sommes pas une maladie mais un remède, répondit Charlie. Nous n’y pénètrerons pas par la force, c’est pourquoi je me suis souvenu du cadeau d’Ulysse aux Troyens.
Je répondis : Aucun cadeau de notre part ne pourrait amener ces gens à nous ouvrir leurs portes : ils savent qui nous sommes !
Je vis que Charlie avait une idée mais il n’en dit rien. Nous avons patienté des jours, sans savoir que vous nous observiez par vidéosurveillance. Pour passer le temps, Charlie me demanda de lui raconter des romans qui traitaient des épidémies. Il apprit par cœur la fable de La Fontaine, et d’autres poèmes que je lui récitai. « De cœurs qui n’en sauraient guérir, elle est partout accompagnée » étaient ses vers favoris de Corneille. Un soir, comme nous étions abrités de la pluie dans une maison en ruine, vous avez attaqué.
J’étais en train de raconter Le Masque de la mort rouge. Les mots d’Edgar Poe berçaient Charlie, la longue litanie de la description des enfilades de salons en fête. Il s’assoupissait, ses sens plus aigus que les miens n’étaient pas en alerte, je ne vois pas d’autre explication. Je décrivais la magnificence du bal masqué dans le refuge de Prospero lorsque j’ai entendu le sifflement des roquettes. « Tableau voluptueux que cette mascarade… ». Par un réflexe que je ne m’explique pas, je me suis retrouvé dehors avant l’explosion. Charlie n’a pas eu cette chance. « Un par un tombèrent les licencieux dans les salons de leur fête aspergés de sang… ». Les roquettes détruisirent la maison, puis vinrent les gaz lacrymogènes et les grenades incendiaires. La surprise affectait mes réflexes, la fumée, la poussière des décombres et le feu troublaient mes sens. À fuir sans visibilité, j’ai percuté un vieux mur qui s’est écroulé. « …et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute ». Je me suis évanoui, et me voici devant vous, entre vos murs, et vous m’avez laissé parler.
Le message de Xahu-la vous est désormais délivré, vous savez la vérité, le plan a fonctionné.
Je suis le cheval de Troie que vous avez laissé entrer, je suis la peste qui se propage dans l’abbaye de Prospero, avec mon costume barbouillé de sang et mon masque à la physionomie de cadavre raidi, le masque de mon frère Édouard : je suis la Mort Rouge, je suis Charlie, le scalpel de Xahu-la, je suis le dernier remède et vous allez mourir…”
VII
La perforine déchire les chairs du dernier élément pathogène, qui meurt en stridulant.
Le commandant de la patrouille, Édouard 619, s’assure que l’infection est circonscrite. À l’orée du bois d’amanites gisent douze cadavres de sauterelles de taille humaine. Sans attendre son ordre, Édouard 599 et Édouard 567 ont commencé le travail de phagocytose de l’une d’entre elles. Plus âgés, ils se plient mal à son autorité. Les pouvoirs s’amenuisant au fil des générations, Édouard 619 aurait du mal de les y contraindre mais personne n’ose jamais défier la volonté de Xahu-la, ce pourquoi il tolère leur insubordination. À son signal, le reste de la patrouille déploie ses phagosomes.
Des créatures apparaissent de plus en plus fréquemment sur Xahu 3. La plupart d’entre elles s’empoisonnent en goûtant aux amanites ou succombent à la fièvre après avoir été piquées par les moustiques. D’autres fois, on les retrouve mortes sans causes apparentes, couvertes de plaies ou de bubons. Celles qui survivent, les patrouilles ont la mission de les éliminer afin de prévenir toute contamination : ordres de Xahu-la pour préserver la planète, croit savoir Édouard 619, à qui il semble pourtant que Xahu 3 n’a besoin de personne pour se défendre. Bien que d’une génération récente, il a déjà digéré des êtres de toutes sortes, des créatures ailées que ses pseudopodes saisissaient au vol, des reptiliens à la technologie avancée, des organismes fongiques qui se reproduisaient à vue d’œil et des intelligences végétales qui se déplaçaient à la manière du lierre : rien ne l’a tant terrifié que la virulence des défenses de Xahu 3, à tel point qu’il en vient parfois à douter de qui est l’agresseur et qui l’agressé. Les sauterelles n’ont même pas fait mine de se défendre : apparemment immunisées aux attaques bactériennes ou virales, ces créatures d’aspect fragile ne possédaient rien qui ressemblât à une arme. Est-ce ainsi désarmé qu’on envahit des planètes ?
Une fois qu’elles sont toutes digérées, Édouard 619 donne le signal du retour. Ils traversent le bois d’amanites, sous une pluie de spores dorées qui ne représente aucun danger pour eux. En deux heures, ils parcourent une centaine de kilomètres dans des plaines de coquelicots qui leur arrivent à la taille et font une pause sur un tertre pour observer un troupeau de milliers de rats géants qui défile au loin.
C’est là que le pressentiment de mort assaille ces hommes au dos tatoué d’un X et dont le plus jeune a dépassé les cent-vingt ans.
Édouard 619 ordonne de presser le pas. Il faut une heure de plus pour gagner le camp, qu’ils trouvent en ébullition. Elisa 872 les attendait sur le rempart, elle se précipite sur Édouard 619 pour confirmer ce qu’il a déjà deviné :
— Ça y est, s’écrie-t-elle. LE PREMIER PÈRE EST MORT !
Elle le saisit par la main et l’entraîne vers une des maisons en rondins de ce camp où tout est naturel et où tous vont entièrement nus, le corps tatoué de l’initiale de Xahu-la seulement protégé par les pouvoirs hérités du Premier Père, leur ancêtre à tous. Ils s’enferment dans la chambre d’Elisa 872, leurs corps si proches qui n’ont jamais osé se frôler tant que le Premier Père n’en a pas donné l’ordre, pas même maintenant qu’il est mort, tant aucun n’arrive à y croire.
— Il vous a parlé ? demande Édouard 619.
— Oui, juste avant de mourir. Il nous a réunis et nous a tout expliqué. « Parce que si vous ignorez le pourquoi des lois, vous cesserez de les respecter », a-t-il dit, « et tout recommencera ». Regarde : j’ai conservé ce qu’il nous a montré pour toi.
Elle tend la main, dans sa paume se forme une image aux dimensions de la pièce, et Édouard 619 voit.
Il voit le souvenir d’un monde que Xahu 3 s’efforce d’oublier. Il voit des cités de béton aux portes du désert, et des grands filets d’asphalte qui étouffent la planète. Il voit des mines s’enkyster dans l’écorce terrestre, et d’autres à ciel ouvert comme des plaies béantes. Il voit la fumée obscurcir le ciel et l’huile recouvrir la mer, l’ordure se déverser comme du pus dans des décharges géantes et des continents de plastique surgir des océans. Il voit avancer le sable et reculer la banquise, fondre des glaciers, brûler des forêts et se répandre l’épidémie humaine. Il voit Xahu 3 lutter contre la pandémie et ses forces diminuer, il voit les prescriptions des Xah-lel échouer, il voit Jebediah Scott dans sa tranchée, Akha et Nogaï à Caffa, Pedro de Belalcázar en route pour les Indes, et tant d’autres éléments pathogènes injectés sur des planètes saines. Il voit Shiee’l et ses lacs d’ambre, il voit des inconnus succomber sur une planète orpheline aux confins de l’univers et la peste orpheline ravager l’humanité, il voit Charlie, le Premier Père, et son frère Édouard, en hommage à qui tous les hommes du camp portent ce prénom, accomplir la volonté divine de Xahu-la. Il voit les millions de morts et la planète reverdir, il voit le refuge souterrain où les derniers hommes continuaient à croire en la science en simulant d’adorer la nature, il voit Elisa, la Première Mère, morte depuis si longtemps que le père du père du père d’Édouard 619 n’en connaissait que des portraits aujourd’hui tombés en poussière, il voit la Mort Rouge et le cheval de Troie, il voit Charlie assassiner son propre frère pendant son sommeil, prendre son apparence et usurper les souvenirs qu’il a lus dans ses pensées, il voit un procès parmi les ruines et Charlie se lever, retirer son masque et reprendre ses traits, il voit ses enzymes perforer le corps des miliciens, ses pseudopodes se saisir de leurs armes et les retourner contre les juges, tous sauf Elisa, et il assiste à la réunion du Premier Père et de la Première Mère…
Depuis longtemps Elisa avait compris que ce n’était pas son ex-mari qu’ils avaient capturé. Elle retira son masque à gaz : elle ne courait aucun risque, elle était vaccinée, mais son geste fut comme une capitulation. Elle avait deviné ce qui l’attendait, et qu’elle n’aurait qu’une seule alternative. Pour gagner du temps, elle demanda :
— Est-ce qu’Édouard a souffert ?
La déception avait disparu, ne subsistait dans le ton que le dégoût inspiré par le massacre et le reproche maternel avec lequel elle s’était toujours adressée à Charlie. Ils étaient seuls dans une pièce jonchée de cadavres, au milieu d’une jungle peuplée de rats. Sous leurs pieds, les derniers humains étaient terrés. La lassitude s’empara d’Elisa : tous ces efforts et tous ces espoirs pour rien ?
— Après tant d’années et tant de morts, tu te soucies encore des souffrances de l’homme qui ne t’a apporté aucun bonheur ? Ton jugement sur moi changerait-il s’il n’avait pas souffert ? Mon frère a accompli sa fonction, il n’y a rien à rajouter !
Elle hésita, et puis :
— Quelle fonction ?
— N’as-tu rien écouté ? Il a participé au système immunitaire de la planète. Une cellule tueuse, voilà ce qu’il a été. Pendant toutes ces années, il a retrouvé et phagocyté des cellules infectées. Finalement, son sacrifice m’a permis de pénétrer le dernier foyer d’agents infectieux pour achever la guérison. Qu’importe qu’il ait été conscient de son rôle, qu’importe qu’il y ait consenti ?
— Je ne te parle pas de cette fonction-là. Pourquoi as-tu sauvé ton frère, que tu as toujours détesté ? Pourquoi êtes-vous venus chez moi, juste avant le déclenchement de la pandémie ? Et au laboratoire peu après ? Pourquoi avoir recherché ce complexe pendant toutes ces années ? Ce n’est pas à la guérison de la planète qu’a contribué Édouard, mais à te permettre d’arriver jusqu’à moi, lui qui t’en avait éloigné. T’y voilà, désormais. Dis-moi : cela valait-il autant de morts ?
Sans répondre, il leva les yeux vers l’effigie de Pan, derrière le tribunal. Elle se décrocha. Derrière, les restes d’une statue de la justice, sans tête ni bras. Charlie soupira :
— Dès que le complexe sera stérilisé, le passé n’existera plus.
Il disparut.
Elisa savait qu’elle n’aurait pas d’autre opportunité. Elle courut jusqu’au mur écroulé de la salle d’audience et se pencha au-dessus du sol, trois étages plus bas. Si l’humanité était un virus, à quoi bon la perpétuer ? Si elle ne l’était pas, comment vivre le reste de sa vie avec celui qui l’avait condamnée ? Elle ferma les yeux, se pencha en avant pour en finir, une voix résonna alors dans sa tête, une voix qui n’était pas celle de Charlie, une voix lointaine et pourtant chaude, apaisante comme une révélation :
tout virus tend à se développer
Précisément, Elisa n’acceptait pas sa condition pathogène. Elle n’obéissait pas à une fonction, son libre-arbitre démontrerait l’erreur de Charlie, le suicide prouverait que humanité n’est pas qu’une épidémie. Mieux valait la mort à vivre seule auprès de ce fou…
tout virus tend à se reproduire
La reproduction ? Maintenant, alors que Charlie n’avait cessé d’éliminer ? Etait-ce son plan depuis le début ? Recommencer à zéro, juste lui et elle ? Elisa ne comprenait pas la voix dans sa tête : pourquoi le Xah-lel cherchait-il à la dissuader d’en finir, elle le dernier des éléments pathogènes ?
les microbes sont nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme
C’était donc ça ? Charlie l’avait dit à ses juges : Xahu 3 ne devait pas perdre la mémoire immunologique de la pire infection qu’elle avait connue, sous peine de cesser de produire des anticorps spécifiques, et de redevenir vulnérable.
Elisa savait ce qu’elle devait faire. Mourir pour se venger. Se venger de Charlie en frustrant ses projets. Se venger de Xahu-la en laissant l’organisme de Xahu 3 sans défense face aux futurs virus, affaiblir son système immunitaire, condamner la planète et condamner le Xah-lel. Ou vivre. Accepter sa nature virale, avec sa nocivité et son utilité. Être utile à Xahu 3 et enfanter, comme elle l’avait toujours désiré, avec le consentement de Xahu-la, en harmonie avec la planète. Avoir enfin des enfants et la repeupler…
Elisa ouvrit les yeux. Une troupe de miliciens venait d’apparaître à l’orée de la forêt, revenant de patrouille. Charlie ignorait leur existence. Un instant, elle imagina d’enfermer Charlie dans le complexe souterrain. Ses pouvoirs ne lui avaient pas permis d’y entrer, il ne pourrait pas en sortir. Dans la salle d’audience, elle se saisit d’un fusil d’assaut maculé de sang, revint près du mur écroulé, mit les miliciens en joue et les mitrailla. Par la lunette, elle observa les rats se repaître des cadavres, jusqu’à ce que la voix de Charlie résonne dans son dos :
— Toute procréation est une prédation. Il n’est pas de pire instinct de destruction que de vouloir se reproduire. La vie que l’on donne, il faut la prendre quelque part !
— Le complexe est stérilisé ?
Il acquiesça.
— C’était les derniers ?
— Il en reste quelques-uns, éparpillés sur les cinq continents. Assez pour former une tribu et marier nos enfants. Je ne fais qu’un avec le système immunitaire de Xahu 3, je sais jusqu’où nous pourrons croître sans risque. Vibrions utiles, nous n’aurons rien à craindre tant que nous contrôlerons la virulence de notre pouvoir pathogène. J’établirai des règles de natalité, que je ferai respecter. Nous resterons une maladie en sommeil. Où te plairait-il de t’installer ? Le monde est à toi…
— Des enfants avec toi qui a massacré l’Humanité et tué ton propre frère, que j’avais aimé ?
— Ce n’était pas un sentiment partagé. Mon frère ne pensait qu’à lui, et à sa chère littérature. A quoi lui a-t-elle servi ? A faire des citations pour renvoyer les autres à leur inculture et prouver sa supériorité ? Un savoir figé, voilà ce qu’il enseignait. La littérature ne devrait-elle pas aider à mieux comprendre le monde, à mieux se comprendre soi-même ? Aucune de ses lectures ne l’a aidé à changer, au contraire il s’en est servi pour renforcer ses certitudes. Qu’a-t-il compris du sacrifice que tu as consenti pour lui ? De celui que j’ai consenti pour toi ? Des souffrances de la planète et de notre nocivité ? Même sa propre souffrance, il ne l’a pas comprise. Au fond, il traitait déjà les autres comme des parasites avant mon intervention, un mal parfois nécessaire dont on se débarrasse d’un revers de main s’il démange. Moi, je te donnerai ce qu’il n’a jamais pu te donner : de l’amour et des enfants.
Charlie tendit la main, les cadavres des juges et des miliciens disparurent. Il ne restait aucune trace de sang, ni dans la salle du tribunal ni sur ses vêtements.
— Regarde-moi, demanda-t-il.
Elisa leva les yeux : Charlie était tel qu’elle l’avait vu, la première fois, dans la maison de ses parents, frêle, timide, les yeux enflammés. Un jour, comme elle hésitait entre les deux frères, Charlie avait juré qu’il lui donnerait le monde. Ce n’était pas la promesse en l’air d’un adolescent romantique, qui jure de donner sa vie ou de décrocher la lune. Pour elle, il était devenu le pire assassin de l’histoire de l’Humanité : pouvait-on imaginer plus grande preuve d’amour ? Elle s’approcha de lui. Où serait-elle aujourd’hui sans Charlie ? Morte de la peste ou d’une autre maladie. Violée ou tuée par des survivants revenus à la sauvagerie. Au mieux, enfermée dans un complexe souterrain, sans plus jamais revoir le monde. Son monde, désormais, grâce à lui. Il avait tué, il l’avait sauvée. Il avait fait d’elle autre chose qu’un bacille inconscient. Bientôt, elle lui donnerait des enfants. Ils se prirent la main, il la conduisit sur une terrasse qui dominait la jungle. Devant eux s’étendait Xahu 3, sans fumée, sans ordure, sans bruit, sans pollution d’aucune sorte. Un monde sain, comme personne ne l’avait contemplé depuis les premiers hommes. Un relent de décomposition se mêlait à l’odeur des fruits et des fleurs, et des nuées de mouches volaient, mais ils s’y habitueraient. De l’entrée du complexe souterrain provenaient les couinements des rats au festin. Ils restèrent de longues heures, l’un contre l’autre, pas seulement parce qu’ils étaient les deux deniers mais parce que c’est ainsi qu’ils auraient toujours dû être, si les mauvaises décisions n’avaient pas été prises, si tant d’importance n’avait pas été accordée à ce qui ne le méritait pas. Rares avaient été ceux qui, comme eux, avaient la chance de repartir à zéro. La planète aussi, l’avait. À la nuit tombée, Charlie désigna à Elisa de nombreuses planètes mortes, avec les noms dont seuls les Xah-lel conservaient le souvenir, il décrivit les merveilles anéanties qu’il connaissait grâce à eux et, par-delà la voie lactée, Shiee’l, d’où était parvenu le remède à l’Humanité…
Elisa 872 ferme la main et l’image disparaît.
Quelques heures plus tard, la communauté se rassemble au centre du camp, sur le tertre où, depuis des siècles, après les prières à Xahu-la, le Premier Père lit rituellement de vieux récits qui traitent des maladies des hommes. Chacun les connait par cœur, à force, et les volumes inutiles se trouvent désormais empilés au sommet du tertre, sur le bûcher où ils partiront en fumée avec le cadavre du seul être capable de les lire.
Ils sont cent, immuablement, cinquante hommes et cinquante femmes, le même nombre depuis l’aube des temps : suffisamment pour se perpétuer sans risque de dégénérescence, trop peu pour provoquer une réaction immunitaire de Xahu 3. Charlie autorisait à se reproduire des couples soigneusement choisis et décidait de qui devait être remplacé par le nouveau-né : en général, des anciens de plus de trois cents ans, quoique dernièrement la longévité ait baissé. Ils mouraient conscients d’avoir eu, en naissant, la chance donnée à peu d’élus de contempler les merveilles sur Xahu 3. C’était emplis de reconnaissance qu’ils laissaient la communauté les phagocyter : ils continueraient à vivre en chacun de ses membres et nulle sépulture ne risquait de nécroser la planète.
Mais, pour la première fois, le Premier Père n’est pas là pour guider la communauté, et les vieux livres ne sont d’aucune utilité.
La patrouille rentrée le matin a fait son rapport. À la lumière des révélations du Premier Père, chacun ressent pour les pacifiques hommes-sauterelles des sentiments nouveaux. Ils ne sont pas des envahisseurs, seulement des échantillons injectés sur Xahu 3 par de lointains Xah-lel pour provoquer une réaction immunitaire. Des bacilles, comme les hommes eux-mêmes. Les microbes ont-ils vocation à se détruire entre eux ? Le Premier Père savait que c’était la condition de la survie de la communauté : préserver l’équilibre entre l’organisme hôte et ses parasites, ne pas empêcher Xahu 3 de se défendre, si possible l’y aider pour justifier la protection de Xahu-la.
La communauté décide de continuer à remplir sa fonction, pour se protéger elle-même : depuis longtemps le Premier Père a développé en eux la conscience que le microbe ne fait qu’un avec l’organisme qui l’abrite.
Mais lorsqu’il est question de l’avenir, le consensus vole en éclat. Avoir une opinion personnelle est nouveau pur eux, et leur compréhension de la situation récente. Rien de ce qu’ils croyaient savoir sur eux-mêmes n’est vrai. Et s’ils étaient plus qu’une simple fonction ?
La majorité veut maintenir le statu quo : les lois du Premier Père sont sacrées, elles garantissent la cohabitation du virus en sommeil et de son organisme d’accueil. Évidemment, la peur de l’inconnu n’entre pas pour rien dans ce respect.
Il en est, traumatisés par la révélation de leur condition pathogène, pour prendre le parti de la Première Mère : à quoi bon vivre en n’étant qu’une maladie ? Certains rappellent qu’ils représentent une menace, et les risques qu’il y a pour la planète à maintenir des foyers d’infection potentiels ; d’autres font valoir le danger d’éradiquer complètement une bactérie.
Des débats interminables, auxquels ne met pas fin le paradoxe que formule Édouard 619 : « si l’humanité est un virus », explique-t-il, « quelle logique y a-t-il à ce que ce virus limite son propre pouvoir infectieux ? Xahu-la l’a dit : un virus tend toujours à se développer. N’allons-nous pas contre notre nature en ne le faisant pas ? En décidant de ne pas nous répandre, nous exerçons un libre-arbitre pour lequel aucune cellule n’est programmée. Voilà la preuve que nous sommes plus que de simples microbes, et peut-être le temps est-il venu d’exercer notre liberté d’humains ! ».
Émerveillée, pleine d’amour, Elisa 872 comprend qu’Édouard 619 a décidé de repartir à la conquête de la planète, de se venger de Xahu 3 et du Xah-lel non pas en disparaissant, comme l’avait imaginé la Première Mère, mais en ravivant l’infection. La communauté immunisée contre la peste orpheline, il faudra longtemps à Xahu-la avant de mettre au point un remède aussi puissant. Qui sait à quel niveau de développement en sera alors arrivée l’Humanité, prévenue qu’elle est désormais des desseins cosmiques des Xah-lel ? Édouard 619 vient d’ouvrir une autre voix : les virus ne sont pas les seuls à anéantir l’organisme qui les accueille, l’Humanité aussi y tend, non pas par respect de leur fonction mais en vertu d’une volonté librement consentie d’exercer son libre-arbitre en détruisant…
VIII



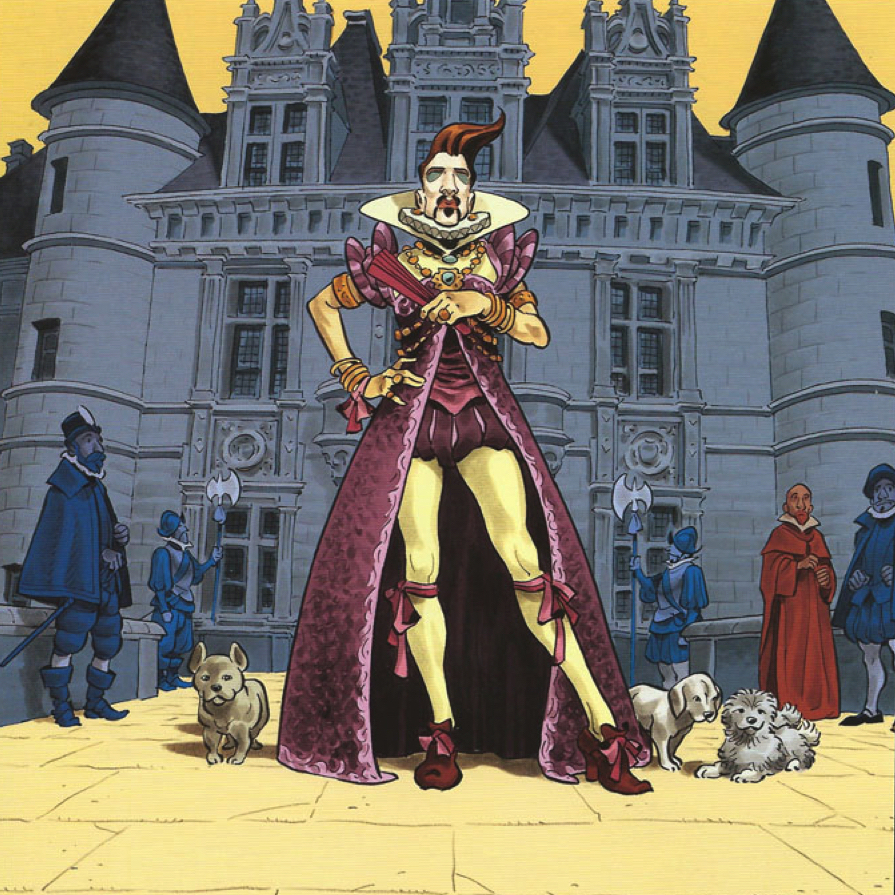

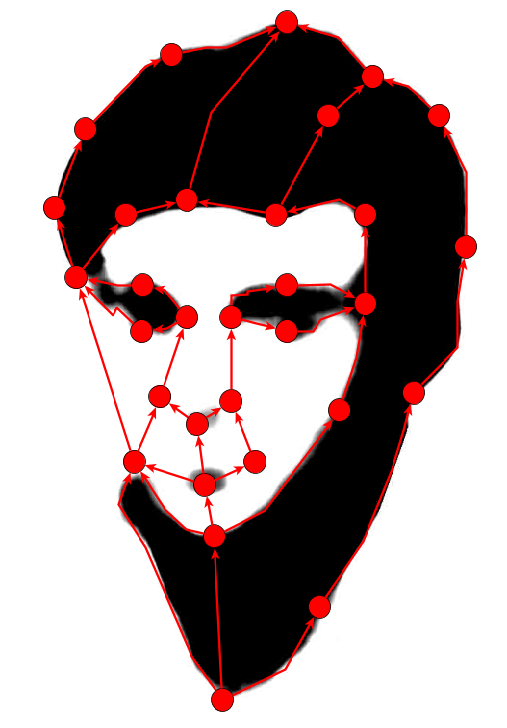



0 commentaires