[À ceux qui diront que s’acharner ainsi sur un cas désespéré n’a pas de sens, que multiplier les traitements ne peut que conduire à l’échec, je répondrai qu’il est des cas qui peuvent certes paraître décourageants, mais qu’abandonner purement et simplement, en d’autres termes condamner un être humain, n’est pas digne de qui se prétend médecin, fût-il littéraire. Je ne sais si la présente prescription aura ou non un quelconque effet, mais j’appelle d’ores et déjà mes confrères à ne pas tourner le dos à un cas certes consternant, voire rebutant, mais que le devoir nous ordonne de prendre en charge, encore et encore.]
François Hollande défend le social-libéralisme parce que, voyez-vous, “c’est le libéralisme sans la brutalité”. Voilà qui rappelle vaguement ce qui se dit de l’édulcorant (le goût du sucre sans les calories), les plats allégés (le plaisir sans les kilos), les régimes miracles (la perte de poids sans les privations) mais aussi les tomates de supermarché (l’aspect du fruit sans le goût), l’égalité femmes-hommes (les déclarations à la pelle sans équivalences salariales), la réforme de l’université (les études sans la transmission du savoir), l’usage intensif du 49-3 (la démocratie sans les débats), etc… Bref, ça rappelle tout un tas de choses très modernes et on se dit que, décidément, le chef de l’État en campagne est vraiment dans le vent, qu’il surfe allègrement sur les nouvelles tendances, de façon extrêmement décomplexée et c’est vrai que cet engagement plein et entier dans un songe utopique ainsi revendiqué force le respect. Eh bien oui, quoi, pouvoir par exemple affirmer “mon adversaire, c’est le monde de la finance” au Bourget en 2012 avant de faire dire à son ministre des Affaires étrangères, toujours au Bourget, en 2015 : “Toute notre tâche va être de faire que les gouvernements représentés par leurs ministres soient à la hauteur des instructions qu’ont données les présidents et les Premiers ministres et à l’unisson de l’effort que l’on constate dans le secteur financier”. Affirmer une chose et puis dans la foulée assurer et même faire le contraire : vous me direz, quoi de plus banal, c’est le socle même de la pratique politique. Je vous répondrai qu’il y a pratique et pratique, et que peu de politiques ont cette aisance dans le reniement, dans le déni, dans le renoncement. Savoir fermer les yeux, oublier au bon moment, savoir faire volte-face, retourner sa veste avec l’air ahuri de qui n’y met pas malice. Pas facile facile, essayez donc.

Dans le roman récemment paru de Gilles Marchand, Une bouche sans personne (éditions Aux forges de Vulcain), des amis se retrouvent le soir, dans un bar (parce que “les amis, c’est ce qu’il y a de plus important dans la vie et […] les amis, c’est dans les cafés qu’on les trouve”). Tous se rendent compte, à un moment ou à un autre, que les rêves, parfois, présentent plus d’intérêt que la réalité, “la réalité est un peu surfaite”. Alors ils s’arrangent avec cette dernière, comme notre bon président, au fond. L’un de ces habitués, notamment, parle souvent de ses enfants. Or, c’est un fait, il n’en a pas. Il se trouve qu’après un accident de mobylette, il s’est réveillé persuadé qu’il en avait. Et, depuis, il essaie sans grand succès d’en faire le deuil. Alors il les évoque souvent, raconte anecdotes et souvenirs divers, les larmes aux yeux. Un autre, Sam, dont les parents sont morts depuis longtemps, se met à recevoir des lettres de sa mère et, dans le fond, “ça [lui] fait plaisir d’avoir des nouvelles…”. Quant au personnage principal, il cache une vieille blessure, laide et cruelle, et tente autant que possible de “transformer son présent pour oublier son passé”.
Il doit avoir cela au fond de lui, notre bon président, le désir d’oublier deux ou trois choses passées, d’arranger un peu le présent, cette envie furieuse qu’on le lâche un peu avec les bilans chiffrés, les engagements à tenir, les valeurs de la gauche à respecter, la politique à mener sur tous les terrains, il aimerait, c’est certain, pouvoir fermer un peu les yeux, s’imaginer que la réalité est différente, qu’on lui dise avec bienveillance mais François, ne te prends pas la tête, les promesses n’engagent que ceux qui y croient, on le sait bien, et quand tes ministres s’en mettent plein les poches en faisant mine de lutter contre l’évasion fiscale, mais c’est de la réalité, du quotidien morne et pesant qu’ils veulent s’échapper, ce ne sont que des rêveurs, des poètes, en somme, et on voudrait le leur reprocher ? Ils s’évadent, comme tu t’évades, parce que ton propos, comme celui du personnage de Gilles Marchand, on l’a bien compris, c’est de prendre un peu de hauteur, foin du respect besogneux des engagements de campagne, ce que tu veux, c’est “bousculer la réalité, transformer le décor, ne pas [s]’embarrasser de crédibilité, ce sale concept bourgeois…”, et au diable tout le reste !
Dans tous les cafés de France et de Navarre, les copains qui se réunissent le soir pour discuter autour d’un verre l’ont bien compris, va, ne t’en fais pas.
Sauf que non. En fait, je plaisante, François. Pour tout te dire, les gens, dans leur immense majorité, ne comprennent pas bien. Ta façon de passer à côté de la réalité et même des rêves.
Jette donc un œil au roman de Gilles Marchand. On ne sait jamais, tu pourrais en tirer quelque chose sur le sens et la valeur des rêves, des espoirs et de la façon de contrer certaines réalités douloureuses, sait-on jamais.
Apprendre à rêver ?
Pourquoi pas.

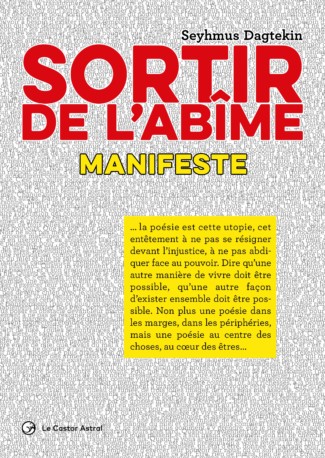






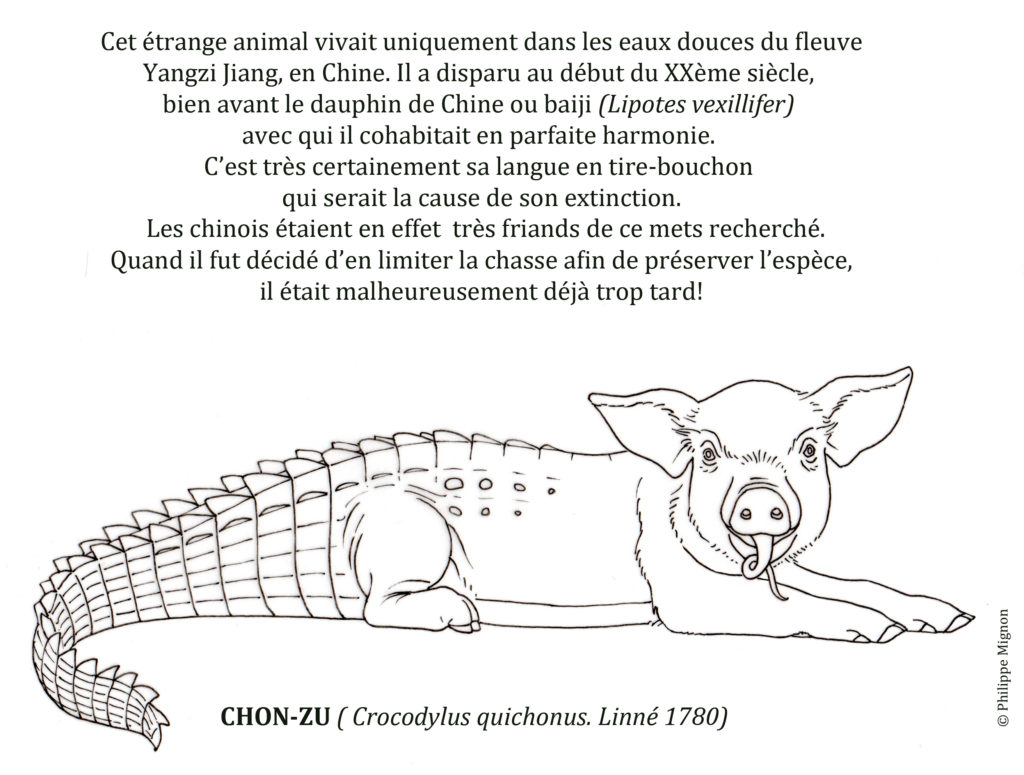
0 commentaires