Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
Dans son édition du jeudi 8 mai, Mediapart consacre un article à BlackRock, « l’institution financière la plus puissante au monde, gérant plus de 6000 milliards de dollars d’actifs ». « Ses combats, ajoute Mediapart, contrer toute régulation financière et imposer la retraite par capitalisation à tous ».
Cet article inquiétant me conduit à m’interroger sur le sens de la règle et sur le paradoxe de nos politiques qui, me semble-t-il, mettent tout sens dessus dessous.
La plupart des démocraties s’emploient aujourd’hui à dérèglementer aussi bien le monde du travail que celui de la finance au nom de la rentabilité : la règle serait contraire à la bonne marche des affaires.
Quand nos États militent pour la dérèglementation du code du travail par exemple, ils s’appuient sur la croyance selon laquelle il existerait une règle immanente à l’économie de marché, croyance illustrée par la théorie de la main invisible d’Adam Smith et qu’on retrouve chez Hayek, un des représentants les plus célèbres du néolibéralisme. Le marché possèderait ainsi un ordre naturel qu’il ne faudrait en rien contrarier sous peine d’enrayer ses mécanismes.
L’histoire a montré, à travers une succession de crises économiques et financières, que cette croyance était erronée : la politique du « laissez faire » n’a conduit qu’à la concentration entre les mains de quelques grands groupes des richesses censées circuler spontanément entre les mains de tous. Il n’y a pas de main invisible.
Pour le dire vite, le « laissez faire », c’est-à-dire le refus de l’intervention de l’État dans le marché, ne peut que déboucher sur un état de nature proche de celui décrit par Hobbes dans son Léviathan. Cette proximité doit toutefois être nuancée : Hobbes parlait de « la guerre de tous contre tous » alors que la dérèglementation, en matière financière notamment, semble plutôt produire la guerre de quelques-uns contre tous : de grands groupes financiers, à l’image justement de BlackRock que j’évoquais plus haut, ne sont pas loin d’être en mesure de dicter leurs volontés aux entreprises (dont ils sont largement actionnaires) comme aux États. Mais parler de volonté est encore beaucoup dire : il serait plus juste de dire qu’ils imposent leurs intérêts aux États.
De la même manière la grande liberté accordée aux banques a conduit à la crise des subprimes dont nous n’avons pas encore fini de payer les conséquences.
Mais quand nous parlons de règles ou quand nous déplorons leur absence, de quoi parlons-nous ? Il existe en effet des règles très différentes. La règle peut désigner un instrument de mesure aussi bien qu’une norme morale ou juridique. En tant qu’instrument de mesure, la règle peut renvoyer à une mesure de type mathématique qui porte sur des quantités (des longueurs, des poids) ou à une mesure subjective qui renvoie à ce qu’on peut appeler une évaluation ou une appréciation. Je peux aussi bien mesurer une distance que l’importance d’un sentiment : on voit sur ces deux exemples que la règle ne saurait être la même quand nous parlons de kilomètres ou d’amour ! En tant que norme, la règle renvoie à un ordre qui peut être ou naturel ou divin ou institué par l’homme. S’il s’agit d’une loi de la nature, la règle est présentée comme immanente : l’ordre de la nature (qui est un ordre mécanique) est une donnée de fait. Nous n’inventons pas les lois de la nature : nous les découvrons peu à peu. Dans les deux autres cas, les règles ne sont plus descriptives mais normatives : Dieu ou les hommes les imposent au monde (il va de soi que ces deux ordres n’ont pas le même sens). Enfin, mais la liste des différents sens de la règle n’est pour autant pas close, nous parlons également des règles de l’art afin de désigner les différents procédés qui permettent de produire un objet.
Quand nous parlons de dérèglementation, dans quel sens prenons-nous la règle ? Il s’agit à l’évidence d’une norme inventée par l’homme, norme qui se veut rationnelle et qui a pour but, comme toutes les lois, à la fois de mettre de l’ordre dans un monde jugé chaotique (le monde de la société par opposition au monde de la nature) et de promouvoir l’intérêt général. Dérèglementer le code du travail, c’est donc, en toute logique, enlever une certaine rationalité au marché de l’emploi : c’est le laisser à l’arbitraire des désirs et de la force. Il me semble pourtant que l’idée de dérèglementation emprunte également à un autre des sens de la règle et qui est celui d’instrument de mesure. Les Grecs de l’Antiquité refusaient d’admettre l’existence des nombres irrationnels parce qu’ils étaient incapables de les exprimer. Ces nombres introduisaient de la démesure dans l’ordre harmonieux des mathématiques. Quand nous refusons de soumettre le secteur bancaire à des règles rigoureuses, nous le condamnons en quelque sorte à la démesure, à ce que les Grecs appelaient l’hybris : les banques ont pu et peuvent encore se lancer dans les spéculations financières les plus folles au risque de ruiner à la fois leurs épargnants et les entreprises qui dépendent d’elles pour se financer.
On voit donc le danger qu’il y a à dérèglementer ce qui devrait être à la fois mesuré et normé : nous laissons libres cours à une forme de désordre contraire à l’idée que nous nous faisons de la culture comme imposition d’une règle au désordre de la violence.
J’en arrive maintenant à l’autre versant de l’action de nos États qui porte non plus sur le monde de l’économie mais sur celui des libertés individuelles. Le tableau d’un déclin du pouvoir politique en matière économique et financière s’accompagne d’un second tableau tout aussi inquiétant : le regain du rôle de l’État cette fois-ci en matière de vie privée et de libertés individuelles. Je me contenterai de quelques exemples éclairants. Nous assistons depuis plusieurs décennies à un renforcement de la répression en matière judiciaire, avec notamment l’abaissement de l’âge de la détention provisoire à 13 ans et de la majorité pénale à 10 ans (loi Perben de 2002). Le fichage génétique, créé d’abord pour lutter contre les crimes sexuels, a été ensuite étendu aux délits de toutes sortes. La vidéo-surveillance se généralise dans l’espace public. Lors des manifestations de rue, les forces de l’ordre pratiquent désormais, de façon quasi systématique, la politique de l’encerclement qui interdit aux manifestants de quitter le défilé, les prenant ainsi dans une nasse. De façon générale nous allons vers des États de plus en plus sécuritaires. Mais ce n’est pas tout. Comme le remarque Ruwen Ogien, un nouvel ordre moral semble se mettre peu à peu en place. Par exemple, lors de sa campagne présidentielle, Ségolène Royale avait fait de la défense de la famille une de ses idées fortes pour lutter contre la délinquance, oubliant que ce mot de famille figurait en bonne place dans la devise pétainiste « travail, famille, patrie ». La loi sur la prostitution du 13 avril 2016, aussi incertaine qu’inutile, est extrêmement répressive. Des expositions d’art contemporain sont régulièrement attaquées au nom de la dignité de la personne humaine (dignité des enfants, dignité des femmes, etc.) et quelquefois interdites. La liste n’est pas exhaustive.
Ces exemples montrent que nos États, la France n’est pas un cas isolé, règlementent de façon quasi mathématique ce qui devrait être laissé à la libre appréciation de chacun. Soumettre les individus à un contrôle incessant par le biais de la vidéo-surveillance ou par celui du fichage génétique représente un empiètement intolérable du pouvoir de l’État sur notre existence. Il est de la même manière injuste d’interdire la prostitution dès lors qu’elle est librement voulue. Ou encore prohiber la consommation de cannabis est sans doute très discutable. Cela ne signifie pas que nos vies soient dépourvues de toute règle, bien au contraire. Mais c’est à chacun d’apprécier de façon subjective ce qu’il peut ou non faire, comment il doit ou non agir dans les limites du respect de la liberté d’autrui. Ruwen Ogien parle à ce propos de « liberté négative » pour désigner une conception de la liberté qu’il appelle également minimaliste : « être libre n’est rien d’autre et rien de plus que le fait de ne pas être soumis à la volonté d’autrui. » (L’État nous rend-il meilleurs ? Éditions Gallimard, 2013). J’ajouterai pour ma part, pour reprendre l’idée de règle que je développe dans cet article, que les hommes sont à l’égard de leur existence dans le même rapport que le génie à l’égard de son œuvre. Kant affirme dans la Critique du jugement que « la nature donne sa règle à l’art » afin de souligner que si la création artistique ne peut être expliquée par les règles de l’école (les règles académiques), elle doit en revanche admettre une règle d’un type supérieur (« la règle de la nature ») afin d’éviter de faire de la création le règne de l’arbitraire et du n’importe-quoi. Cependant cette règle supérieure n’est pas rationalisable : elle est par définition mystérieuse. C’est pourquoi il n’existe pas de mesure ou de définition objective de la beauté. Refuser cette évidence, c’est à la fois rogner les ailes de la liberté artistique et enfermer la beauté dans le carcan étroit des règles ou des canons d’une époque. Il en va de même de chaque existence qui enferme en elle-même son propre secret, sa propre règle de vie que personne ne peut objectiver. Et c’est bien sûr ce qui fait toute la beauté de l’existence, à condition toutefois que l’État ne se mêle pas de l’enfermer dans un moule.
Pour conclure nous voyons que nos démocraties nous donnent le spectacle d’États faibles face aux grands groupes financiers ou face aux entreprises géantes comme Google mais puissants face à des individus de plus en plus démunis : on ne saurait rien imaginer de pire, écrit à quelques mots près Tocqueville à propos du nouveau despotisme qu’il voit surgir à l’horizon des démocraties modernes.
Gilles Pétel
La branloire pérenne



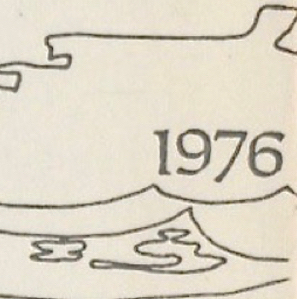




0 commentaires