Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
La manifestation pour le climat qui s’est déroulée samedi 8 septembre à Paris montre l’inquiétude d’une population devant l’inertie des politiques face à un danger dont ils ne semblent pas mesurer l’ampleur.
De façon plus générale, nombre de nos concitoyens ont le sentiment que les hommes politiques, qu’ils soient ou non au gouvernement, manquent singulièrement de vision à moyen ou long terme. Aucun d’eux ne propose de projets de société à même de fédérer une majorité nette.
Dans De la démocratie en Amérique (1835), Tocqueville, qui ne tarit pourtant pas d’éloge sur le modèle américain, ne peut s’empêcher de relever la médiocrité de la classe politique américaine, tant au niveau de l’exécutif que du législatif. Il avoue être parfois abasourdi par l’ineptie des conversations qu’il a eues avec certains représentants du pouvoir. Les Américains de 1830 (date à laquelle Tocqueville entreprend son voyage aux États-Unis) étaient-ils donc moins brillants que les Français ou plus largement les Européens de la même époque ?
Un tel préjugé n’est pas dans les manières de Tocqueville. Les Français n’ont évidemment pas l’apanage de l’esprit. Mais si, en 1830, les hommes politiques du vieux continent sont plus éloquents, c’est parce que la démocratie n’a pas encore achevé chez eux son œuvre. C’est encore l’Ancien Régime qui domine dans de nombreuses têtes.
La démocratie, répète inlassablement Tocqueville, c’est d’abord et surtout « l’égalité des conditions ». Il ne s’agit pas d’une égalité de richesse, à laquelle Tocqueville ne croit pas, mais d’une égalité en droits, telle qu’elle se trouve proclamée dans l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Il n’y a désormais, en théorie tout au moins, plus de privilèges, plus de classes ou de castes sociales détentrices de prérogatives qui seraient, en droit, refusées aux plus humbles. Chacun peut désormais aspirer aux fonctions les plus élevées. Il n’y a plus d’abîme entre le paysan et l’aristocrate. Il n’y a plus d’aristocratie.
Une des conséquences de cette nouveauté inouïe est le développement des ambitions personnelles. Dans Le Rouge et le noir, écrit peu de temps avant le voyage de Tocqueville en Amérique, Stendhal campe justement un personnage de jeune ambitieux pour qui il n’existe plus de barrières sociales infranchissables. Julien Sorel, à l’instar de Napoléon qu’il admire, rêve de conquérir sinon le monde du moins la mairie de Verrières.
Tocqueville analyse avec beaucoup de finesse les conséquences psychologiques de la démocratie. Elle introduit chez l’homme de nouvelles passions qu’il faut alors appeler des passions sociales. La première d’entre elles est sans doute l’envie. Dans une société d’ordre comme l’était celle de l’Ancien Régime, la place assignée à chacun limite considérablement l’envie, c’est-à-dire ce désir de nous trouver à la place de celui qui nous est supérieur, parce que cette place nous est par principe inaccessible. Un paysan ne pourra jamais devenir noble. En démocratie, au contraire, où les rangs sont mobiles et donc instables, chacun peut espérer, sans doute au prix d’un bon nombre d’illusions et de déceptions, gagner l’étage supérieur. Chacun désormais envie la position de l’autre dès lors qu’elle est un tant soit peu meilleure que la sienne. Les conditions étant égales, il n’y a plus aucune raison valable de demeurer en bas de l’échelle. La moindre différence de condition est alors perçue comme injuste. C’est ce qui explique la rage qui ne quitte presque jamais Julien Sorel, même au milieu de ses transports amoureux.
La seconde passion que fait naître la démocratie est la recherche du bien-être. La nécessité où se trouve désormais chacun de travailler fixe l’attention des hommes sur ce qui leur est utile. L’oisiveté apparaît comme un vice, la méditation comme une perte de temps : « Tous s’agitant sans cesse à la recherche du bien-être, ils n’ont plus le temps pour la méditation. » (Livre II, chapitre X)
Cette nouvelle passion conduit logiquement les hommes à privilégier les emplois où celle-ci peut le mieux se satisfaire. C’est ainsi que Tocqueville explique, au moins en partie, le développement de l’industrie. C’est elle en effet qui semble le mieux à même de répondre à la fois à l’ambition des hommes et à leur désir de confort. C’est là en enfin qu’ils pourront le mieux donner la pleine mesure de leur talent.
Tel n’est plus le cas en revanche de l’activité politique. Dans le premier livre de son ouvrage, Tocqueville note que le Président des États-Unis n’est plus le souverain. C’est ce qui le distingue d’un roi (chapitre VIII). Son pouvoir et ses ambitions s’en trouvent aussitôt limités. Sans doute objectera-t-on qu’en France, aujourd’hui, les pouvoirs du président sont considérables puisqu’il peut par exemple passer outre l’avis de l’assemblée grâce aux fameux article 49.3, qui n’est autre chose qu’un héritage de l’Ancien Régime. Pourtant ses moyens d’action restent limités. Le succès de sa politique économique tient moins aux mesures qu’il prend qu’à la conjoncture internationale, sur laquelle il n’a guère de prise. De même, il doit tenir compte de l’avis des « capitaines d’industrie ». Les grands groupes, industriels ou financiers, exercent un pouvoir proportionnel à leur richesse. Enfin, l’action du Président est soumise à l’approbation de l’opinion publique. Un homme politique doit plaire s’il veut être réélu.
Ces contraintes expliquent que la carrière politique intéresse peu ceux qui ont du talent. Le véritable pouvoir, dans nos démocraties, est désormais économique. C’est ce qui explique sans doute à la fois le malaise de nos sociétés davantage gouvernées par des groupes de pression que par les représentants du peuple et le taux d’abstention qui ne cesse de progresser à chaque élection. Tocqueville reconnaissait lui-même que l’un des dangers qui guette les nouvelles démocraties est le développement de l’industrie, où il aperçoit le risque de la création d’une nouvelle aristocratie, sans les manières ni les mœurs de l’ancienne, une simple aristocratie de l’argent, donc.
La vie politique attire encore des ambitieux. Le pouvoir, même limité, continue de fasciner les hommes, d’autant que les médias leur renvoient en permanence et en continu une image qui flatte et exacerbe leur narcissisme. Mais ce ne sont là, note encore Tocqueville, que de petites ambitions. Chacun désire toujours plus sans doute, mais tient en même temps à préserver ses acquis. Pour obtenir beaucoup, il faut être prêt à risquer beaucoup. Des réformes d’envergure, des perspectives sur le long terme ou encore ce que nous appelons aujourd’hui des projets de société ne vont jamais sans risques. La vie politique tend de plus en plus à ignorer les débats d’idées au profit des querelles de chefs. Chaque rentrée est l’occasion de voir les grandes figures des partis politiques s’entredéchirer pour occuper la place du leader. Ainsi périt le parti socialiste. Ainsi agonisent les Républicains.
Pour conclure, le spectacle attristant de la vie politique de nos démocraties (car la France n’est pas bien sûr un cas isolé) est celui de femmes et d’hommes ambitieux sans talent. Le parcours de Raquel Garrido est à cet égard significatif. Avocate de formation, présentée comme la porte-parole du parti Les Insoumis, véritable passionaria des plateaux télé, elle amorce enfin un virage à 180° en délaissant la vie politique pour participer de façon régulière à un talk-show sur une chaîne de télévision, émission de divertissement très populaire où son ambition trouve probablement plus de satisfaction que dans un parti dévoué à la défense des classes populaires.
Gilles Pétel
La branloire pérenne



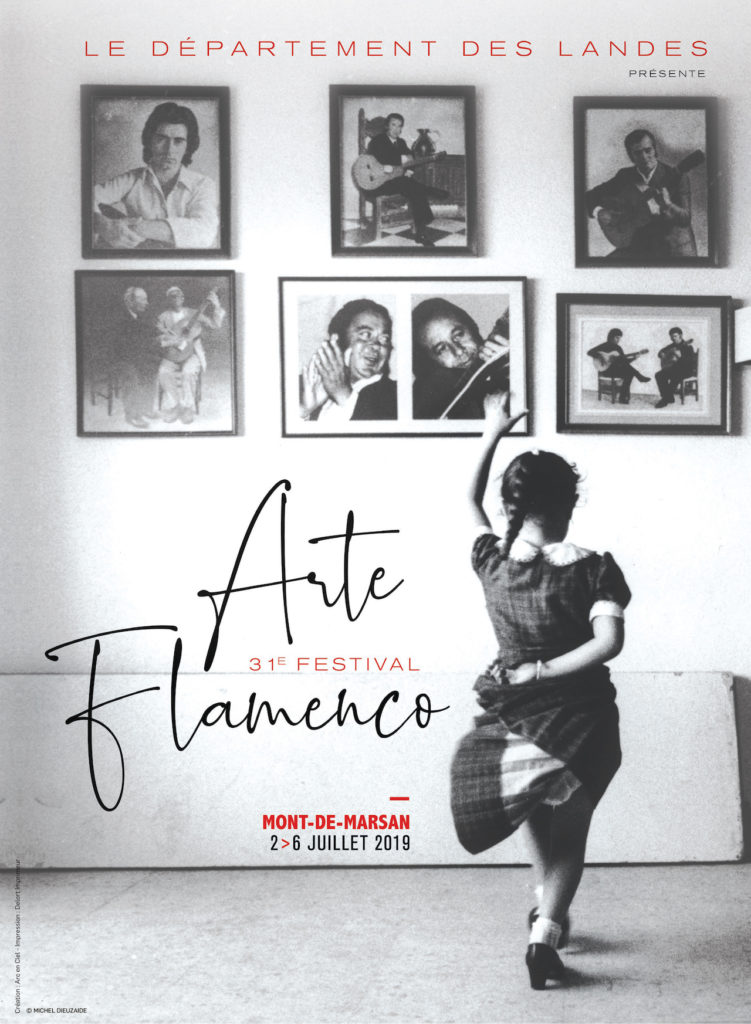

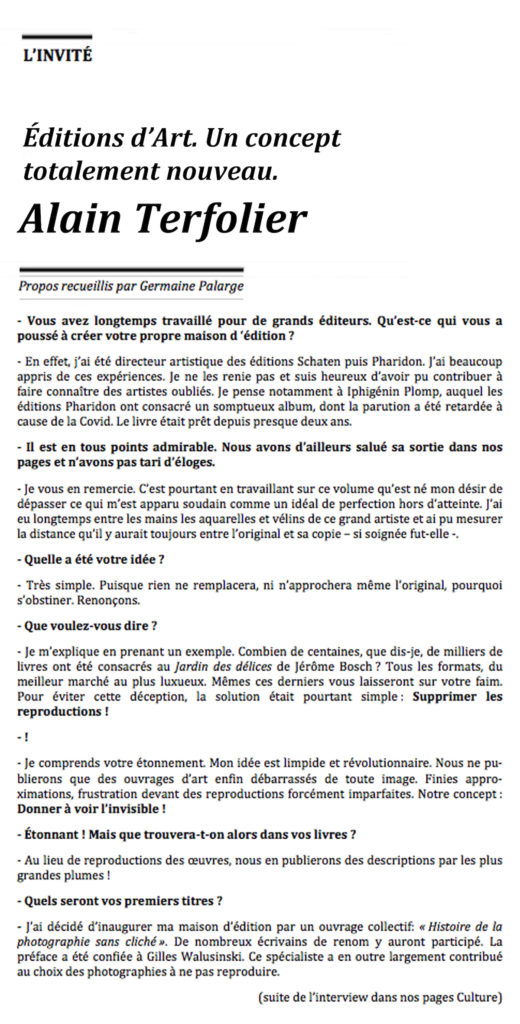

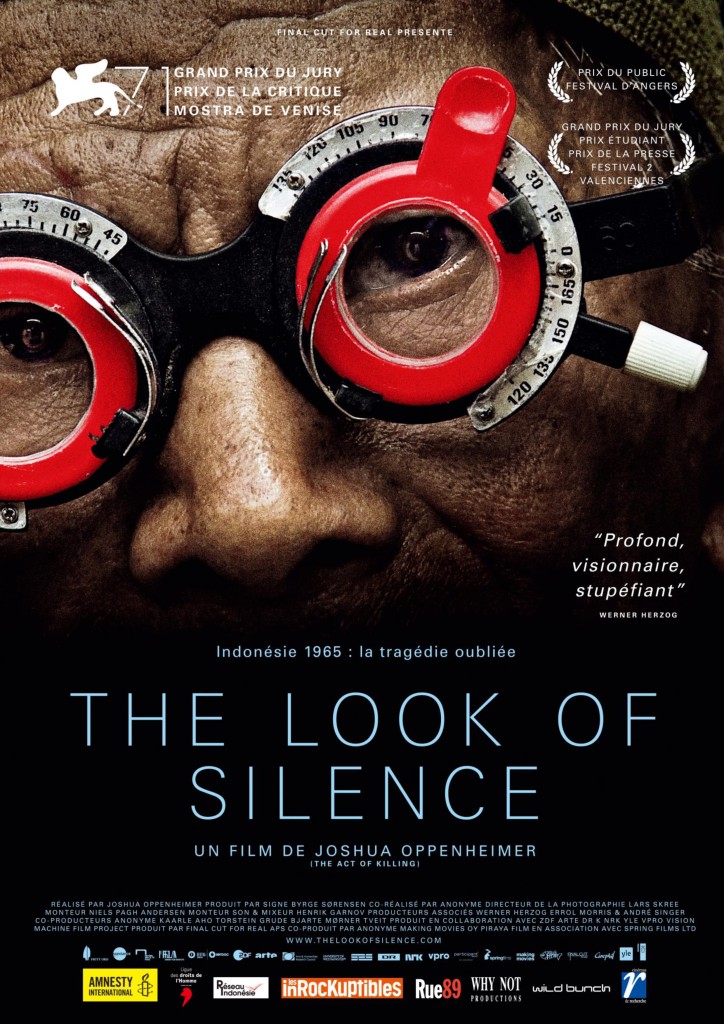

0 commentaires