C’est dans un coin de mail, envoyé par Michel Butel il y a trois ans, sans doute en réponse à une question. « Je pense que Pierre Patrolin est un écrivain considérable ». Ce mot, considérable, était troublant. Mais convenant plutôt bien à un homme qui, lui, semble toujours avoir pris le temps de considérer longuement ce dont il va parler. L’eau, le feu, le flottement, l’instant.
Dans le calme du Quercy où il vit, s’imaginait-on à partir des quelques lignes biographiques qu’il concède. Déroulant ensuite La Traversée de la France à la nage, suivi de La Montée des cendres, de L’homme descend de la voiture, ou Voyage au centre. D’une sensualité précise, d’une loufoquerie austère, d’une poésie certaine, le tout articulé sur une maîtrise remarquable du suspens, de l’inquiétude derrière l’apparente normalité.
Mais, quand il s’agit d’écrire, le Quercy vaut le café parisien. Le doute et les alarmes sont les mêmes, la frustration du mot qui manque, les sauvegardes répétées, les vieilles et les nouvelles versions. « Je ne souhaite plus me soucier des virgules, des temps et des accords, dans l’attente d’instants si lumineux qu’ils seront éphémères ». On ne se méfie jamais assez des écrivains à la langue fluide. C’est beaucoup de travail ingrat. Ainsi Patrolin, l’auteur, décide-t-il de cesser. Vivre le monde, sans se balader avec des trucs notés sur des facturettes, des courriers du gaz, la marge du journal, avec cette ambition, mettre en mot l’instant, le bruissement des feuilles, l’idée traversante, la rue. Laisser vivre le monde.
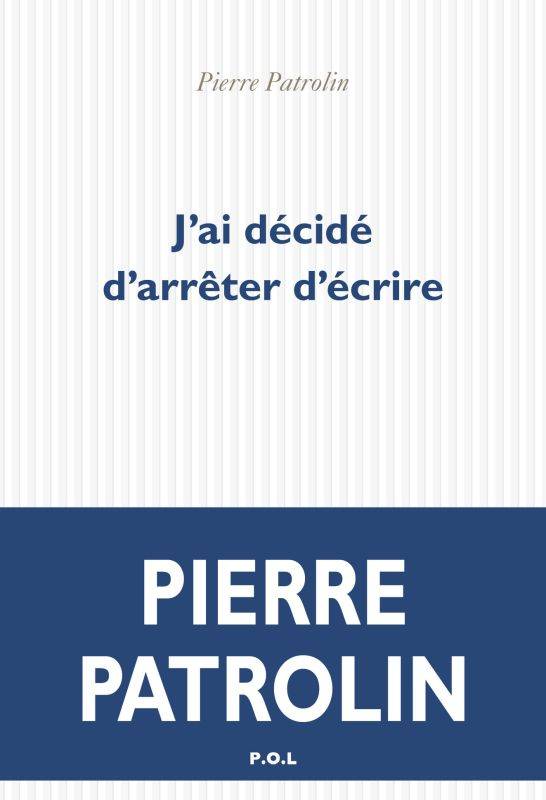 J’ai décidé d’arrêter d’écrire serait donc l’histoire d’une désintoxication. On le sait, la désintoxication est d’abord l’expérience du manque. Que l’on trompe de son mieux mais qui ne se laisse pas oublier. Il y a double bind romanesque : l’écrivain se tait, tandis que le narrateur rapporte le détail du renoncement. Mais ils ne font qu’un.
J’ai décidé d’arrêter d’écrire serait donc l’histoire d’une désintoxication. On le sait, la désintoxication est d’abord l’expérience du manque. Que l’on trompe de son mieux mais qui ne se laisse pas oublier. Il y a double bind romanesque : l’écrivain se tait, tandis que le narrateur rapporte le détail du renoncement. Mais ils ne font qu’un.
Il y a déploiement de ruses. « Cela fait presque deux semaines que j’ai commencé. Mes efforts ne sont pas vains. J’ai écrit quand même un peu, bien sûr. Moins que prévu ». Sans papier, sans stylo (ou seulement un ou deux), restent le téléphone et les textos qu’on s’adresse (avec correcteur décalé et circonflexe introuvable) ; reste le dictaphone, qui s’entête à confondre « poing » avec « . » Ou « Jacqueline », le prénom de la compagne, avec « chaque ligne ». Les outils de remplacement sont invasifs.
Reste surtout, la littérature des autres. Les livres s’entassent partout dans la maison, à tel point que Jacqueline s’interroge et interroge, elle qui voit l’homme sans désir aucun quand l’écrivain se tait. Mais les livres, et il soigne l’italique pour bien montrer que tout ça n’est pas de lui, sont l’occasion de vérifier que tant a été écrit, et parlent souvent à sa place. Aucun nom, ou presque, n’est cité. Quelques titres. Parfois, on se demande si l’écrivain n’avance pas masqué derrière la citation. Mais non. Le choix est pour le moins éclectique, Patrolin fréquente les librairies comme les éventaires d’occasion. On peut voir passer Duras, Cixous, Patrick Varetz, les polars de Kaminsky ou Topol, Nietszche et Stéphanie de Labro, Robbe-Grillet, Abu Bakr Ibn Tufayl ou Wladimir d’Ormesson, Barbey d’Aurevilly. Même si, là aussi, il y a parfois conflit larvé entre l’auteur muet et ceux qu’il lit. « Un peu comme les images de vacances, quand chacun préfère montrer les siennes que s’ennuyer à regarder celles des autres ».
Et dès la page 10, l’échec de la désintox se profile en une phrase. « Une forêt grise et verte ». Puis, plus loin. « Quelqu’un marchera dans les bois » . Ce n’est rien, une incise.
Une matrice ? L’écrivain mutique remonte aux origines du livre, serre au plus près l’instant où s’impose une image, quatre mots, un possible. Ce qui va porter, « dans l’illusion qu’on décidera de tout ». Ainsi donc l’homme apparu dans la forêt grise et verte avancera, une femme le suivra. ils feront l’amour et à manger au bord d’une rivière. C’est la préhistoire se dit-on, tandis qu’ils affutent des pierres et creusent des bols. C’est une histoire d’avant les mots, en tout cas, et la préhistoire possible d’un roman.
Une mésange chaque matin vient se cogner à la vitre de l’écrivain-plus-écrivain, obstinée, à la poursuite d’une image d’elle-même, d’un reflet, à s’en assommer, tandis que dans le récit parallèle l’homme de la forêt laisse en plan un mulet dans les herbes, jouissant du soleil et sans eau. Le narrateur chronique la nécessité d’écrire, tandis que l’écrivain en rupture déclare qu’il faut changer les pneus avant de la voiture. Et Jacqueline trouve que c’est pas mal ce qu’elle a lu, vu qu’il a oublié de fermer l’ordinateur. Pour les pneus d’accord.
Pendant trente ans, Pierre Patrolin a écrit sans publier, pas de son fait, dit-il, jusqu’au jour où il publia 800 pages d’un coup chez POL, en nage indienne à travers la France. Et poursuivit en allumant le feu d’une urbaine cheminée, en achetant une voiture.
Il y a ainsi autre chose, dans ce livre. Un hommage discret à l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens disparu l’an dernier, qui apparaît à plusieurs reprises dans ce texte, qui est peut-être, aussi, un récit de deuil très vivant. « La confiance que m’accorde monsieur Paul m’est si précieuse que je redoute souvent de ne pas être capable de l’honorer ». Et quand Pierre Patrolin explique vaguement ce que pourrait être ce « J’ai décidé d’arrêter d’écrire » alors en gestation, juste cette question de POL : « Vous continuez d’écrire, tout de même ? »
Paul Otchakovsky-Laurens n’aura pas vu la parution de ce livre, ni Michel Butel, qui en aurait aimé le titre. Écrivain et éditeur, considérables.
Dominique Conil
Livres
Pierre Patrolin, J’ai décidé d’arrêter d’écrire, éditions POL, 17 €
La traversée de la France à la nage, dit Pierre Patrolin, est « délicieusement soporifique […] Elle m’apaise, elle me berce. » Ses vidéos promotionnelles sont, elles, délicieusement embrouillées.





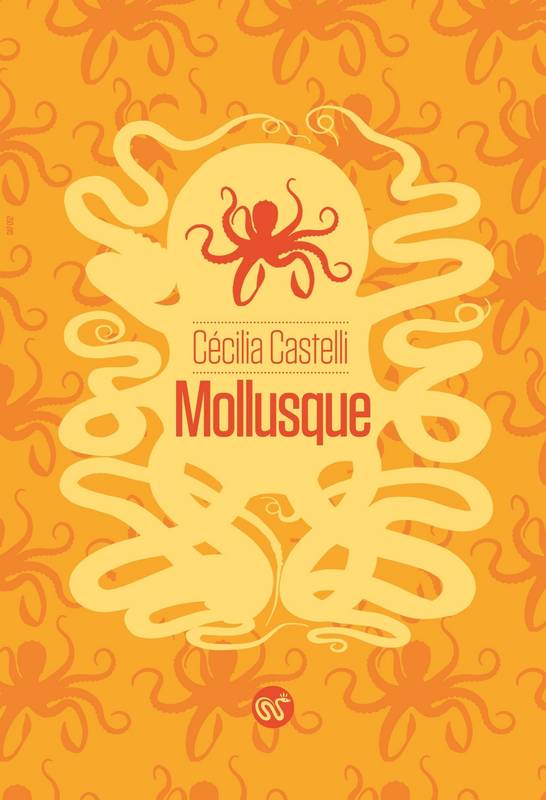



0 commentaires