Comme il l’écrit lui-même dans la lettre que nous avons choisi de rendre publique, Schopenhauer est l’auteur d’une seule œuvre : Le Monde comme volonté et comme représentation. Les autres textes qu’il publia soit avant, soit après celui-ci ne sont que des préparations ou des variations autour du thème central de l’œuvre : le monde est animé par une force aveugle autant qu’inflexible : le vouloir-vivre. Publié en 1819, Le Monde… a connu deux rééditions du vivant de l’auteur, chaque fois enrichies de plusieurs suppléments qui n’ont fait qu’allonger un livre déjà jugé pesant par ses contemporains. Arthur Schopenhauer attendit sa vie durant une reconnaissance qui ne vint jamais.
Après un échec cuisant à la Humboldt-Universität de Berlin où il enseigna six mois devant un parterre d’étudiants presque vide, Schopenhauer mena une vie d’oisif que la fortune de sa famille lui permettait. Il vécut notamment à Francfort, fréquentant assidûment les brasseries où il dînait seul. C’est sans doute là qu’il fit la connaissance de celle à qui il s’adresse avec fougue dans cette lettre qu’il n’envoya jamais : elle fut retrouvée à sa mort dans un de ses cartons.
Mon Ange,
Je comprends ton embarras. Tu n’as pas l’habitude de discuter avec un philosophe. Les idées générales sont pour toi une terre inconnue. L’esthétique, la morale, la métaphysique sont des domaines que tu n’as jamais visités et dont tu n’imaginais même pas l’existence avant de me rencontrer. Il est vrai que tu ne t’attendais pas à recevoir une leçon de sagesse quand je t’ai priée hier soir de t’asseoir à ma table. Je te parle de sagesse mais c’est aussi bien un brin de folie qui s’est emparé de moi quand je t’ai vue. Tu ne saurais imaginer mon trouble.
Tu te tenais légèrement courbée derrière le comptoir, la taille sanglée dans un tablier blanc qui soulignait tes formes généreuses. Le vaste miroir courant le long du mur me permettait de découvrir ta beauté sous ses multiples facettes. Ta carrure m’impressionnait, j’admirais ton fessier qui semblait jaillir hors de ton petit tablier. Le galbe de tes cuisses a achevé de m’enivrer. J’ai su à l’instant que nous étions faits l’un pour l’autre : toi, naturelle, animée d’un vouloir-vivre sans borne, et moi, réfléchi, apte à dompter les élans du cœur. Tu m’offrirais l’instinct, je te donnerais la connaissance. Je voyais déjà une abondante progéniture naître de notre union. De leur mère ils tiendraient la force, de leur père l’intelligence. A nous deux nous maintiendrions la race dans son excellence. Mais il fallait encore te persuader d’unir nos corps. Mon sang n’a fait qu’un tour.
Te rappelles-tu ce geste à la fois timide et langoureux que je t’ai adressé en même temps que je passais ma commande ?
– Un bock de bière, Mademoiselle !
C’était presque une déclaration d’amour, mais tu ne le savais pas, du moins pas encore. Tu étais occupée à essuyer patiemment l’un après l’autre une cinquantaine de verres. Tes yeux languides flottaient sur la salle bondée à cette heure de la soirée, un vague air de tristesse donnait à ton visage une noblesse sans laquelle il n’y pas de véritable passion. Tes gestes étaient lents mais précis. Je sentais en toi une détermination, une flamme qui n’attendait qu’un souffle pour embraser ta chair. En moi se levait peu à peu un vent puissant. Je n’avais d’yeux que pour toi.
Bien sûr tu ne me voyais pas et il m’a fallu hausser la voix pour me faire entendre à travers le brouhaha de la salle. Après plusieurs tentatives infructueuses pour attirer ton attention, tu as enfin tourné ton regard vers moi. Instant sublime, moment inoubliable ! Si j’avais pu tracer une ligne droite entre nos cœurs, elle les aurait transpercés de part en part.
– J’arrive, j’arrive, m’as-tu répondu d’une voix traînante qui révélait une sensualité à fleur de peau.
Un bon quart d’heure plus tard, tu déposais un demi-litre de bière sur ma table.
– Je vous remercie beaucoup, Mademoiselle. Vous êtes charmante.
Mais tu n’as pas entendu mon compliment : tu me tournais déjà le dos pour courir vers une autre table dont les clients piaffaient d’impatience. Je me suis retrouvé face à mon bock, partagé entre l’ennui de le boire seul et la souffrance d’attendre le moment de commander un second demi. Sans réfléchir davantage, j’ai choisi d’agir en homme résolu. Le désir pressant de te revoir à mes côtés dictait ma conduite. J’ai avalé presque d’une traite ma bière pour en commander aussitôt une autre. Tu n’avais pas encore regagné le comptoir que ma voix te faisait tressaillir :
– Mademoiselle ! Mademoiselle ! Un autre verre !
Combien de bocks a-t-il fallu avant que j’entende le son de ta douce voix ? Quatre, cinq ? Je ne sais plus.
– M’sieur est drôlement assoiffé à c’te heure !
Paroles délicieuses, premières lueurs de l’amour ! Tu avais deviné ma soif, tu ne tarderais pas à reconnaître mon désir. Je vacillais de joie, je pleurais presque, je buvais chacun de tes mots. J’aurais voulu t’avaler, toi et tes seins plantureux, ta croupe forestière, tes lèvres charnues. Je me sentais un cannibale en redingote !
Mais tu ne m’as pas laissé le temps de déclarer ma flamme. Tu repartais, appelée par un travail que je juge indigne de toi. Il fallait que tu serves tant de clients, tant d’hommes ! Pour tromper mon attente, j’ai suivi tes allées et venues dans la salle, tes pas pressés, ton déhanchement, ta respiration haletante qui soulevait ta poitrine, rien de toi ne m’échappait, jusqu’à ces gouttes de sueur qui perlaient le long de ton cou et que j’aurais aimé boire, comme pour sécher tes peines. J’ai recommandé plusieurs autres verres et nous avons fini par échanger deux ou trois mots. Quand la salle a commencé à se vider, quelques trois heures plus tard, je t’ai enfin invitée à t’asseoir à ma table.
J’étais un peu ivre, tu paraissais lasse. Tu t’es assise d’un coup, sans façon, en posant sur la table une bière fraîche accompagnée d’un schnaps.
– Faut que je me remonte le moral, m’as-tu dit après avoir descendu ton bock et le schnaps dans la foulée.
Tu avais laissé ta main moite près de la mienne, et j’y ai vu comme une invitation. Bonheur encore inconnu, mystère du vouloir-vivre, miracle de l’amour ! Ma main tremblait quand je l’ai posée sur la tienne. Tu n’as pas esquissé un geste, tu t’es contenté de me regarder droit dans les yeux avant de me demander :
– C’est y après la chose que M’sieur en a ?
Ta sincérité et ton aplomb ont ébranlé mes nerfs. Au fond de moi un lion rugissait, mais j’avais l’apparence d’une biche. Un drôle de phénomène pour emprunter à mon bon Kant. Les quatre ou cinq litres de bière que j’avais ingurgités au cours de la soirée m’avait liquéfié. Je regrettais déjà le temps que j’avais passé à t’attendre, ces heures durant lesquels j’avais construit des châteaux en Espagne, mis au point tant de déclarations d’amour, échafaudé tant de projets, tramé tant de rêves de bonheur – et maintenant que j’y étais, devant la chose, je restais coi. Comme je ne répondais rien, tu as repris la parole :
– Tu n’es pas du genre causant, mon bonhomme !
– Je vais tout t’expliquer, ai-je trouvé le courage de dire.
– Faudrait tout de même pas s’éterniser. J’ai encore la salle à faire.
Alors je me suis lancé. Le bouillonnement qui agitait l’intérieur de mon être, qui montait, montait depuis que je t’avais vue, ce bouillon d’amour passionné est sorti d’un coup. Et je t’ai parlé de mon livre, mon grand livre, l’ouvrage de ma vie. Un philosophe, t’ai-je déclaré, est toujours l’homme d’une seule idée. C’était à ton tour de rester bouche-bée. Tu coulais vers moi un regard languide, voluptueux et chaud. Tu avais étendu tes jambes sous la table et je pouvais sentir le cuir de tes bottines que tu frottais contre mes mollets.
– J’l’ai jamais fait avec un écrivain. Ça doit être que’que chose !
Mais je ne t’écoutais plus. Le Monde… est un livre génial, ai-je poursuivi, sans aucun doute le livre le plus important de notre siècle. Bien sûr les critiques l’ont ignoré mais les sots sont toujours les plus nombreux. Puis qui désire entendre la vérité ? Qui peut la supporter ? Qui pourrait à notre époque dominée par la clique de cet infâme Hegel reconnaître la puissance de l’instinct sexuel ? Toi peut-être ? Oui, en toi, la ruse de l’espèce se manifeste avec l’éclat du soleil. Tu es l’astre incandescent, je suis ton satellite. Mes révolutions autour de ton corps ne s’arrêteront jamais.
– Dis-moi, mon chéri, tu n’es pas en train de me débiter des cochonneries ? Faudrait voir à pas abuser. Je veux bien pour la chose, mais on n’est pas là pour en faire tout un plat. Puis j’aime pas qu’on me cause pendant que je le fais. J’ai des principes.
Le ton courroucé de ta voix m’a ramené à moi.
– Pardon mon ange ! Comme toujours, je me suis laissé emporter par ma passion. Toi qui n’as sans doute jamais lu une ligne de philosophie, comment pourrais-tu comprendre ma métaphysique de l’amour ?
– Oh ! Si c’est pour le sentiment, c’est une autre affaire. Faudrait voir à faire les choses dans les formes.
C’est alors que tu m’as examiné de la tête aux pieds, comme on regarde une pièce de bœuf à l’étalage de la boucherie. J’ai tout de suite vu que quelque chose clochait. Une moue déplaisante déchirait l’expression sublime de ton visage. J’ai tenté en vain de rebattre les cartes en t’expliquant comment les contraires s’attirent et se fortifient mutuellement. Toi, vaillante, jeune et si sexuelle, moi, doux, réfléchi et mature à souhait. Sais-tu que je viens à peine de fêter mes 45 ans ? Le vouloir-vivre est en moi encore bien vivant et plein d’ardeur. Mais c’est toi qui ne m’écoutais plus.
Tu es faite pour moi, je suis celui dont tu as besoin. En toi une puissance invincible te pousse vers moi mais ton petit entendement raisonneur te retient de te laisser aller. Je viendrai t’attendre demain et après-demain encore, je te montrerai l’excellence de mon système et te prouverai que la volonté qui gouverne le monde nous a destinés l’un à l’autre, je vaincrai tes réticences, je te veux toute à moi, pour toujours. Tu es mon samsara.
Ton Arthur







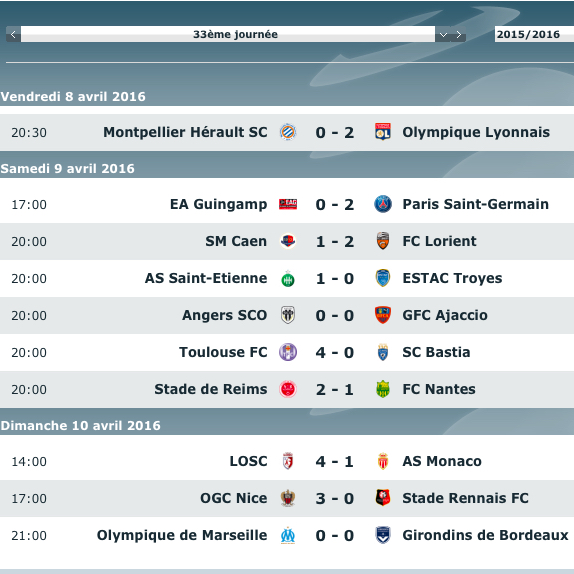
0 commentaires