Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.
On en voit de toutes les couleurs ici, au service de médecine littéraire de l’hôpital. Hildegarde, notre réceptionniste d’origine bavaroise, a d’ailleurs pris l’habitude d’annoncer les patients par la couleur dominante de la salle d’attente. Elle annonce du bleu lorsque les Schtroumpfs de la Dr B la remplissent, ou du violet lorsque les éminences puantes et religieuses du Dr R se pointent, par exemple.
Ce matin, j’ai ainsi pris en charge du vieux rose puis du bleu marine, mais je ne m’attarderai pas ici sur ces cas qui relèvent malheureusement de la routine et pour lesquels j’ai mis en œuvres des protocoles déjà bien établis au sein de l’établissement.
Là, assise depuis quelques minutes dans mon bureau, je me dis qu’il me faut une pause, voire même un petit reconstituant. La Dr B a toujours dans le frigo une réserve de saucisses allemandes qu’elle se procure je ne sais où, je lui en chipe régulièrement une ou deux, ça m’aide à tenir. Je me lève donc, pleine d’entrain soudain, lorsque Hildegarde toque à la porte, avec sa manière bien à elle, trois petits coups secs. Lorsqu’elle l’entrouvre, je vois à sa tête que ce qui m’attend ne sera pas très drôle.
– Alors ? lui dis-je.
– C’est gris, me répond-elle. Je suis vraiment désolée, mais c’est tout gris.
– Il y en a beaucoup ?
– Ma foi oui, la salle d’attente en est comme repeinte. Franchement c’est d’un triste. Marcel dit que dans tout le tas il n’y a pas une seule pointe de glamour, il prend son air horrifié – tu vois ? – quand il traverse.
– Oui, je vois. Notre infirmier a des goûts bien arrêtés qui le font d’ailleurs se promener en blouse rose pailletée toute l’année au nez et à la barbe des règlements et de celles et ceux qui tentent de les faire appliquer. Le gris ne lui a jamais plu.
Je suis donc Hildegarde, renonçant à la gastronomie allemande et prête à affronter la grisaille.
De fait, la salle d’attente est bondée. D’hommes essentiellement. Tous en sévères costumes gris, en effet, assortis de cravates généralement tout aussi sombres. À l’air pincé avec lequel ils suivent les pas toujours dansants de notre infirmier, je vois que le courant n’est pas passé. Il règne là comme un climat d’hostilité. Malgré les airs d’opéra de la Dr R, qu’elle diffuse dans l’hôpital de plus en plus fort, il faut bien le dire [Note personnelle : penser à lui en toucher un mot]. Avant que les choses ne s’enveniment, je m’avance. À peine ai-je fait un pas que l’un d’eux – mâchoire volontaire, lèvres épaisse et cheveux bruns – me tend la main d’un air décidé : « Enchanté, Geoffroy Roux de Bézieux, Président du Medef ».
– Très bien, monsieur, puis-je savoir pourquoi vous êtes ici ?
– Eh bien, j’ai précisément quelques questions à vous poser à ce sujet, madame.
– Docteure, s’il vous plaît.
– Docteure.
– Vous parlez au nom de tous les présents ?
– Oui, je suis leur Président voyez-vous.
– Alors je vous écoute, racontez-moi cela.
– Et bien le Medef, comme vous le savez bien sûr – du fait de sa démarche proactive, force de proposition responsabilisante – a participé au Grand Débat National lancé par le président de la République. Et, à son issu, a déposé 43 propositions. Nous venons de les présenter publiquement : je les ai moi-même lues les unes après les autres. J’en étais arrivé à l’un des points auquel nous tenons beaucoup, « Développer l’entreprenariat », essentiel bien sûr puisque l’entrepreneuriat est l’ADN de toute croissance économique pour nos territoires pour lequel il faut challenger avec toute la flexibilité requise l’esprit d’entreprise pour tous les acteurs concernés. Le public buvait mes paroles (j’ai une voix qui porte, je sais mettre le ton, j’ai un tempérament de leader). J’ai avancé l’une de nos belles propositions : « Attribuer automatiquement un numéro Siret à chaque jeune français pour son 16e anniversaire » [Note de la rédaction : c’est le Medef qui, dans son document, ne met pas de majuscule à « Français »]. J’ai crié : Et que l’homme et l’entreprise ne fassent plus qu’un ! Et vive l’homo entrepreunarius ! D’un coup, alors que tous applaudissaient, des individus en blouse blanche sont entrés, nous ont saisis et nous ont conduits d’autorité ici.
– Je vois.
– Vous voyez quoi ?
– Une crise aiguë de perte de contact avec la réalité. C’est une situation d’urgence, ils ont bien fait.
– La réalité ?
– C’est cette chose que la plupart des humains se coltinent au quotidien.
– Ah.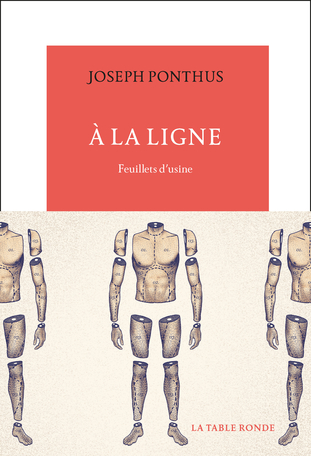
– Il va falloir vous y replonger un peu. J’ai ce qu’il vous faut, heureusement. Vous allez laisser tomber un temps vos 43 propositions et lire un peu autre chose. Ça s’appelle À la ligne. Feuillets d’usine, ça vient de sortir à La Table Ronde. L’auteur s’appelle Joseph Ponthus, il raconte son histoire. Celle d’un gars qui a fait des études littéraires, a commencé à travailler dans le social puis a tout quitté pour suivre celle qu’il aime, en Bretagne. Et, parce qu’il faut bien bosser, il se retrouve à l’usine, ouvrier intérimaire. Et c’est cela qu’il raconte, la réalité de la vie dans une usine de poissons (crevettes, bulots…) ou dans un abattoir. Pour rapporter un peu de sous :
Les sous à aller gagner racler pelleter avec les bras
le dos les reins les dents serrées les yeux cernés et
éclatés les mains désormais caleuses et rêches la
tête qui doit tenir la volonté bordel
Et c’est la vie à l’usine, la réalité vraie de celles et ceux qui y travaillent :
Les crevettes les bulots les crevettes
les cartons les autres cartons encore ces foutues
crevettes attendre que le chef te donne ta pause
reprendre les crevettes les bulots les crevettes les
crevettes
– C’est ça la réalité ? [mine désappointée]
– Ça et bosser. Tout en se rappelant les mots, ceux des auteurs aimés, qui aident à tenir :
« Ah Dieu ! Que la guerre est jolie »
Qu’il écrivait le Guillaume
Du fond de sa tranchée
Nettoyeur de tranchée
Nettoyeur d’abattoir
C’est presque tout pareil
Je me fais l’effet d’être à la guerre
Les lambeaux les morceaux l’équipement qu’il faut
Avoir le sang
Le sang le sang le sang
Là j’approche
Je ne suis plus au porc mais au bœuf
Et presque en première ligne
Ou pire
Au cœur des lignes ennemies
Au local « co-déchets »
Juste un demi-étage en dessous de la tuerie
– Un challenge proactif hors zone de confort ? [mine intéressée]
– Si vous voulez. Un passage par la réalité crue de l’usine, qui change tout :
L’usine bouleverse mon corps
Mes certitudes
Ce que je croyais savoir du travail et du repos
De la joie
De l’humanité
Je n’apprends rien
Mais je me bats
Contre la cadence le temps la douleur
Contre moi-même
En fait j’apprends
– Voilà. Il faut faudra en lire quelques pages chaque jour au lever et au coucher, absorber ainsi peu à peu et au quotidien les mots hachés de Joseph Pontus. Vous apprendrez, vous découvrirez, vous irez un peu à l’usine, patauger dans son quotidien ingrat, et vous y apprendrez qu’ils sont nombreux, ici, sur terre, à rêver d’autre chose que de se voir coller à 16 ans un numéro Siret dans le dos. Car, face à votre l’homo entrepreunarius,
Il y a surtout
Tous ces matins du monde
Où chacun dans sa nuit
Rêve
À un monde sans usine
À un matin sans nuit
Nathalie Peyrebonne
Ordonnances littéraires
Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine. La Table Ronde, 2019





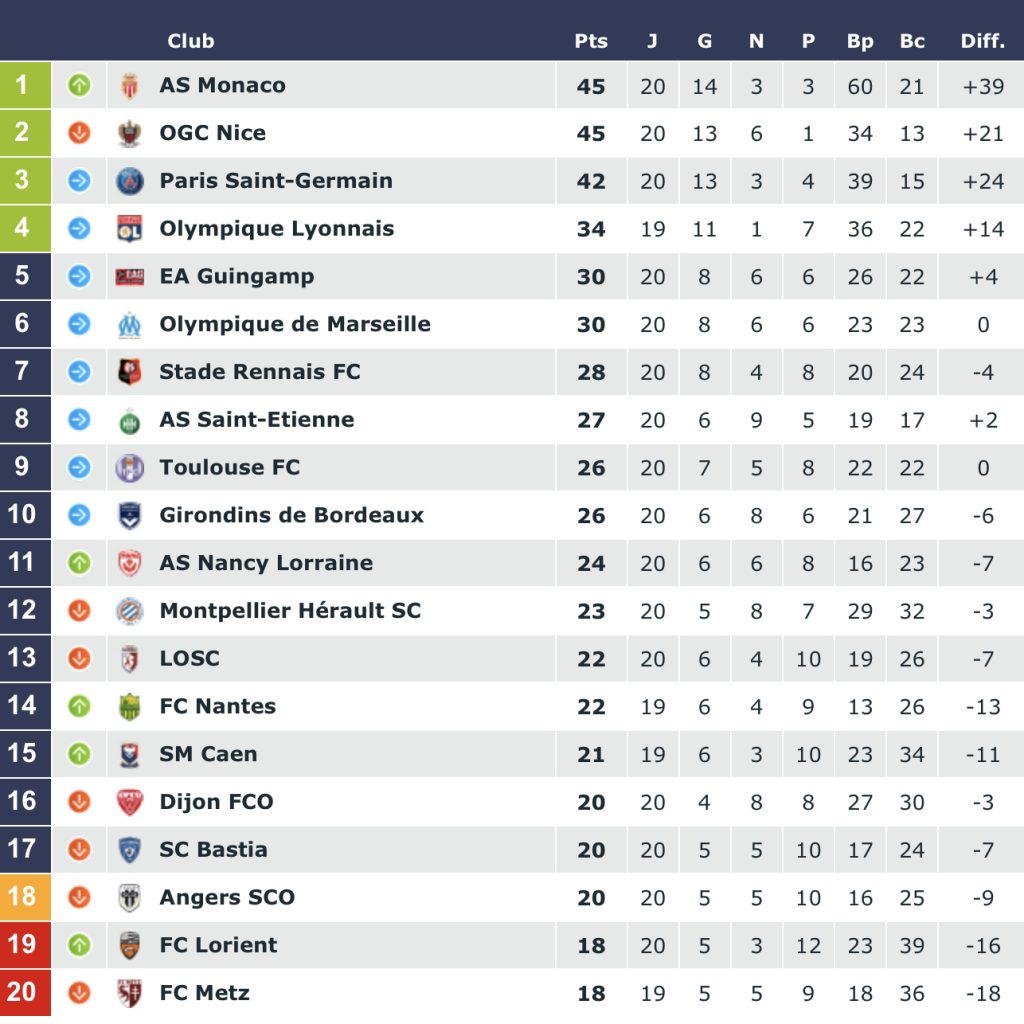
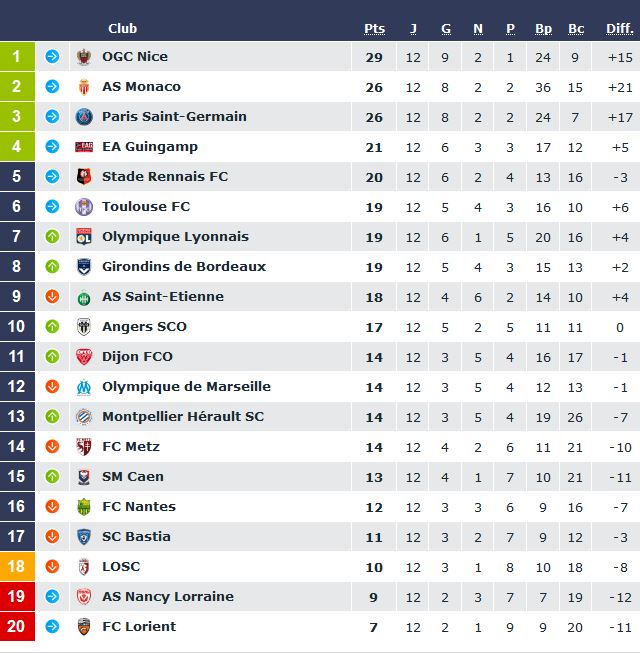


0 commentaires