Frédérique Tirmont est comédienne. Si l’on peut souvent la voir au théâtre, au cinéma ou à la télévision, on peut l’entendre bien plus encore. Elle est en effet la voix française de Meryl Streep et d’Emma Thompson, entre autres. Elle nous parle de son métier d’actrice de doublage, qui en dit également long sur certains enjeux de la traduction.
Qu’est-ce qu’un acteur ou une actrice de doublage ?
C’est d’abord un acteur, qui joue la comédie comme il ou elle le ferait sur scène ou sur un plateau de cinéma, mais en se projetant dans un code de jeu qui n’est pas le sien, qui est celui du comédien ou de la comédienne que l’on voit à l’écran. Il faut respecter ce jeu tout en utilisant ses propres émotions, que l’on va chercher à l’intérieur de soi pour jouer ce que l’on voit à l’image, le but étant d’être le plus proche de ce que le comédien ou la comédienne a fait. C’est un métier d’ombre, qui auparavant était dénigré par la profession, nous n’étions d’ailleurs pas considérés comme des acteurs. Il a fallu une grève, en 1995, pour que nous soit reconnu le statut d’artiste-interprète. C’est un métier très ludique, qui se pratique dans un univers chaleureux, mais une chose est sûre : on ne peut pas être acteur de doublage sans être comédien. C’est le même métier, sauf que le support est différent. Évidemment, sur scène ou à l’écran, l’acteur a un corps en mouvement, alors qu’un comédien de doublage reste derrière une barre, ses mouvements sont limités ; mais le corps étant un moteur d’expression au même titre que le son de la voix, dans le doublage il faut aller puiser très profond à l’intérieur de soi la violence ou l’émotion que l’on voit à l’image.
Quand j’étais élève au Conservatoire, en 1971, j’avais un professeur extrêmement directif en classe d’ensemble : Monsieur Jean Meyer. Il était à l’époque directeur du théâtre des Célestins, à Lyon, avait auparavant été sociétaire de la Comédie-Française, également directeur artistique du centre d’art dramatique de la rue Blanche où j’avais suivi une année de cours avant d’entrer au Conservatoire. Un matin, nous arrivons au Conservatoire où nous devions présenter une tragédie, Bérénice, dans notre magnifique théâtre doté d’une acoustique de rêve puisque l’actuel Conservatoire d’art dramatique était auparavant Conservatoire de musique. Je jouais le rôle de Bérénice. Il était neuf heures du matin, nous nous retrouvons tous dans le foyer et là, on nous annonce qu’il n’y a pas de lumière… Qu’à cela ne tienne, nous dit Jean Meyer, vous allez dire le texte. Et nous avons fait ce qu’on appelle une italienne ; pas une allemande, où l’on dit le texte debout, où l’on prend place, mais une italienne : au bout du premier vers, il nous a interrompus pour préciser qu’il voulait que nous jouions assis. Au bout de deux heures, nous sommes sortis de là en nage, épuisés. Le doublage, c’est la même chose : on en sort épuisé. C’est épuisant de concentration. Et c’est aussi épuisant visuellement, parce que l’on travaille du matin au soir dans l’obscurité.
En quoi consiste « techniquement » un doublage ?
Il y a toute une gymnastique qui consiste à jongler entre l’image et la bande rythmo, c’est-à-dire la bande placée au bas de l’écran, sur laquelle le texte défile. Mais ce que l’on cherche, c’est le regard. La vérité de ce qui est joué, c’est le regard. Le sens est dans l’œil. Si on est dans l’œil de la comédienne, si la voix reflète l’œil, c’est que l’on est juste, c’est que l’on est dans le sentiment. Et parfois, bizarrement, même quand le texte n’est pas impeccablement synchrone, si on est dans le sentiment et dans le regard, tout le monde n’y voit que du feu, personne ne regarde la bouche. Quand on regarde les mouvements de bouche, on sait que ça ne va pas. Et puis il y a toujours une part de montage et de mixage dans le travail de doublage, c’est un vrai travail d’équipe : le directeur de plateau, qui est un directeur d’acteurs, travaille avec l’ingénieur du son, dont le rôle est primordial.
S’agissant de doublage, qu’est-ce qu’une bonne ou une mauvaise traduction ?
Une bonne traduction nous permet de jouer ce que nous voyons, elle est en phase avec l’action qui est jouée. Un bon traducteur, c’est quelqu’un qui est au plus proche du sens, du rythme et du sentiment. Encore faut-il que l’on accorde aux traducteurs suffisamment de temps pour ce travail délicat. Car les traducteurs sont à mes yeux de vrais auteurs. Par exemple, j’ai doublé plusieurs Shakespeare réalisés par Kenneth Branagh – puisque je double Emma Thompson, qui a joué dans plusieurs de ses films – et je me souviens d’une traductrice, Jacqueline Cohen, dont le texte aurait pu être joué tel quel sur une scène de théâtre. Et puis, quand il s’agit d’un doublage de cinéma, tout un travail de vérification a été réalisé en amont par des gens qui connaissent bien le métier. On peut toujours modifier tel ou tel détail au moment de l’enregistrement, si jamais quelque chose nous gêne pour jouer mais, si tout a été correctement vérifié avant, ce n’est en principe pas nécessaire. Il peut arriver qu’une traduction, sous prétexte de synchronisme, s’avère être le contresens de ce qui est en train de se jouer à l’image. Alors l’acteur, forcément, parle faux, il cesse de jouer la comédie pour partir en quête d’un sens qui ne lui a pas été donné. La traduction doit être au service du sens, elle doit permettre une liberté de jeu, sans que le texte soit un souci pour le comédien. Mon grand confort est justement de ne pas avoir à m’occuper du texte : il faut que ce dernier soit un support de jeu et non une contrainte.
Le texte est-il transmis en amont aux comédiens qui vont doubler le film, afin qu’ils puissent en prendre connaissance avant ?
Non, jamais. Quand ce sont de grandes productions, des projections privées en V.O. sont organisées par les sociétés de production. Mais le plus souvent, on découvre le film le premier jour de travail. Et on a accès aux scènes dans le désordre, comme sur un tournage. Le directeur de plateau, en revanche, dispose du texte. C’est lui qui nous expose l’histoire, qui nous présente le personnage que l’on va doubler. Ce que l’on voit à l’image est notre support : on découvre une situation à l’écran et on la reproduit. Et on s’y reprend autant de fois que nécessaire pour que le résultat soit parfait… à condition que le planning le permette.
Vous doublez exclusivement des films en anglais ?
Essentiellement mais pas exclusivement. D’ailleurs, mon premier doublage était un film en allemand : Le Mariage de Maria Braun, de Fassbinder. J’y doublais Hanna Schygulla. Je n’avais jamais fait de doublage de ma vie. Je parlais un peu allemand, je l’avais étudié en première langue au lycée, mais ce fut un pur hasard. J’avais trente ans à l’époque, je ne cherchais pas à faire du doublage. Peu de temps avant, j’avais joué dans La Fugue [1] au Théâtre de la Porte Saint-Martin, une comédie musicale dans laquelle je chantais, je dansais, je jouais la comédie et, à un moment donné, je réalisais un strip-tease à l’envers : je portais une guêpière, un chapeau, une voilette, des gants noirs… et je devais me rhabiller, enfiler une robe 1900 splendide conçue par Jeanne Wakhevitch. C’est le chorégraphe Matt Mattox qui avait réglé ce ballet. Et, un an plus tard, je reçois un coup de fil de Gérard Cohen, qui avait un studio d’enregistrement de doublage rue Marcadet et qui me demande si le doublage est un métier qui m’intéresse. Pourquoi moi ? Parce qu’il m’avait vue dans La Fugue un an plus tôt et il trouvait que je ressemblais à l’héroïne du film qu’il allait me proposer.  À l’époque, j’étais toute mince avec des joues rondes et de longs cheveux roux. Quand j’ai vu l’affiche du Mariage de Maria Braun, j’ai compris : la guêpière, le chapeau, les souliers, la coiffure, le visage… la ressemblance était frappante. « Vous avez sûrement la même émission vocale », a-t-il ajouté avant de me proposer de faire un essai. J’ai accepté, ça a marché. Évidemment, tout ne se résume pas au fait que je lui ressemblais et que j’avais la même voix. J’ai appris le métier mais, au fond, la technique ne m’a jamais bridée, ne m’a jamais empêchée de prendre plaisir à jouer.
À l’époque, j’étais toute mince avec des joues rondes et de longs cheveux roux. Quand j’ai vu l’affiche du Mariage de Maria Braun, j’ai compris : la guêpière, le chapeau, les souliers, la coiffure, le visage… la ressemblance était frappante. « Vous avez sûrement la même émission vocale », a-t-il ajouté avant de me proposer de faire un essai. J’ai accepté, ça a marché. Évidemment, tout ne se résume pas au fait que je lui ressemblais et que j’avais la même voix. J’ai appris le métier mais, au fond, la technique ne m’a jamais bridée, ne m’a jamais empêchée de prendre plaisir à jouer.
Des tas de comédiens excellents ont du mal à faire du doublage. Et puis il y a aussi de vrais virtuoses. Je me souviens de Roger Carel, de Gérard Hernandez, de Jacques Balutin et d’autres encore… Certains se permettaient de modifier le texte, d’improviser, de créer des personnages. C’était du jonglage, brillantissime.
L’art de doubler a-t-il changé ?
La façon de faire du doublage n’était pas la même il y a soixante ans. Il suffit de voir les westerns de l’époque (dont les doublages étaient réalisés à la SPS, la Société parisienne de sonorisation, rue Leredde, dans le 13e arrondissement de Paris) pour s’en rendre compte. Et puis il y avait beaucoup moins d’acteurs qui pratiquaient le doublage, donc on entendait souvent les mêmes voix, parfois très reconnaissables : Raymond Loyer (la voix de John Wayne), Jacqueline Porel, Martine Sarcey, etc. La technique aussi a changé. Quand j’ai commencé, à l’époque du Mariage de Maria Braun, chez Gérard Cohen, tout n’était pas informatisé comme aujourd’hui : chaque boucle (c’est-à-dire chaque bout de séquence) était insérée dans le projecteur et on enregistrait boucle après boucle. C’était un travail très artisanal. Aujourd’hui, tout est dématérialisé, les ingénieurs du son travaillent sur ordinateur… Ça a modifié le rythme du travail, certes, mais c’est toujours le même métier. Si évolution il y a eu, elle va de pair aussi avec l’évolution des acteurs, de leur code de jeu. Au fond, ce que l’on cherche quand on joue, c’est toujours la même chose : être vrai. Quand on fait du doublage, ce que l’on veut entendre dans l’oreille, c’est la vérité du sentiment. C’est la raison pour laquelle j’aime ce métier : s’il y a une part de création, d’appropriation de ce que l’on est en train de faire, elle réside dans cette quête de vérité. De justesse. Si Meryl Streep est une actrice extraordinaire, c’est parce qu’elle respire, elle prend le temps, elle ne joue pas, elle est.
Y a-t-il des comédiennes que vous avez davantage plaisir à doubler que d’autres ?
Je prête ma voix de manière régulière à certaines comédiennes, alors j’ai fini par bien connaître leur code de jeu. Cela crée non pas une facilité, car les situations jouées sont toujours différentes, mais une proximité. Emma Thompson et Meryl Streep ont deux codes de jeu totalement différents, et l’on doit se fondre dans ce jeu. La voix se modifie, se module inconsciemment. L’oreille nous conduit à chercher la couleur et le rythme de ce que l’on entend. Les souffles, les respirations, les bruits de bouche… Il m’arrive régulièrement d’être reconnue comme la voix de Meryl Streep. Ce n’est pas qu’une satisfaction personnelle, c’est simplement sidérant. La voix accompagne l’inconscient des gens. Elle est un instrument magique.
Frédérique Tirmont
Propos recueillis par Christilla Vasserot




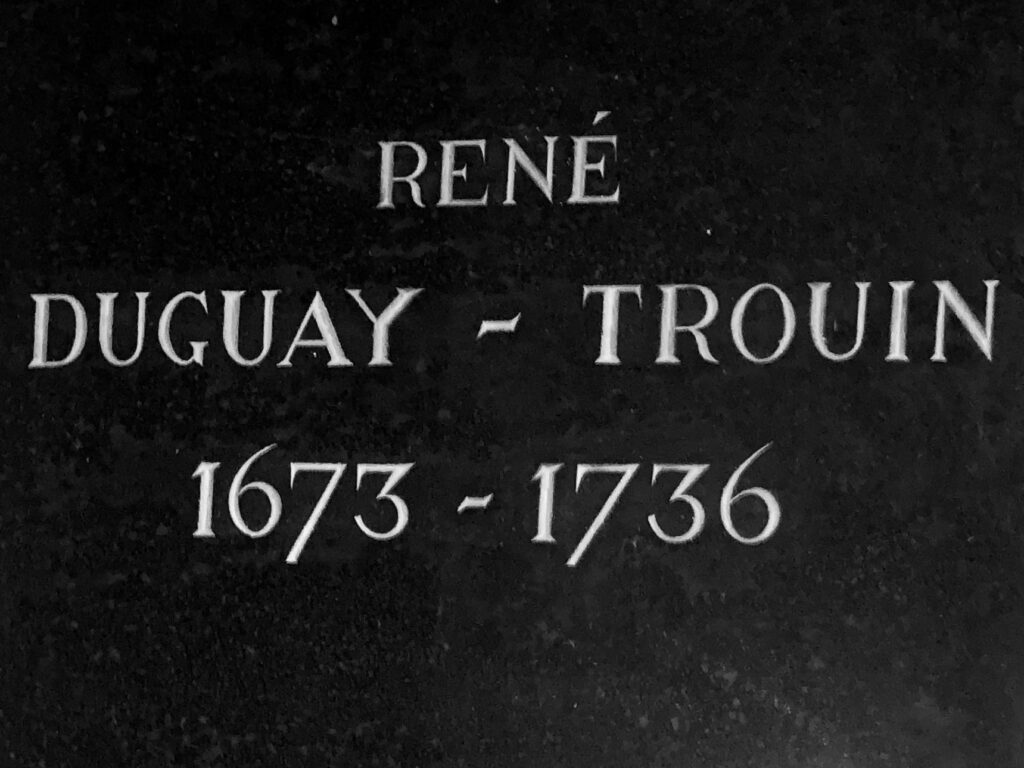




0 commentaires