 Angoulême, festival de la bande dessinée. Au loin, le clocher. À ses pieds, les maisons et les ruelles, toujours un peu de guingois, grises en ces journées pluvieuses. Au premier plan, brisant la perspective de sa banane démesurée, Lucien le rocker, dit Lulu, la statue géante du personnage de Frank Margerin. Négligemment vautré, baskets rouges, jean bleu horizon et blouson de cuir noir, posé là comme une décalcomanie sur le paysage du quotidien, il signe l’entrée du visiteur dans le monde de la fantaisie. Le ton est donné.
Angoulême, festival de la bande dessinée. Au loin, le clocher. À ses pieds, les maisons et les ruelles, toujours un peu de guingois, grises en ces journées pluvieuses. Au premier plan, brisant la perspective de sa banane démesurée, Lucien le rocker, dit Lulu, la statue géante du personnage de Frank Margerin. Négligemment vautré, baskets rouges, jean bleu horizon et blouson de cuir noir, posé là comme une décalcomanie sur le paysage du quotidien, il signe l’entrée du visiteur dans le monde de la fantaisie. Le ton est donné.
À l’intérieur des bâtiments et des grandes tentes blanches où se succèdent expositions, master classes, signatures et rencontres : le public, les créateurs, les éditeurs. Petits chapeaux de hipster, barbes de trentenaires et look d’artistes, ils passent sans vous regarder, connectés à tout sauf à vous : ce sont les jeunes générations d’auteurs ou de dessinateurs. D’autres soignent leurs dédicaces, donnent des accolades, on les croirait croqués en noir et blanc, à l’ancienne : ce sont les auteurs aguerris, grisonnants et chaleureux. Mais surtout, partout, déambulant : des quinquas, des familles, des ados, des grands pères et des originaux. J’aime beaucoup les originaux. Y’a pas de copie. Un original (une planche) coûte une blinde. Mais un(e) original(e) qui se promène, poings dans les poches et perruque bleu ciel, c’est gratuit. Voilà, suivons cette originale-là. Elle ne va rien acheter et sa tête est dans les nuages. Un peu Rimbaud, un peu Magritte, ce sera un bon guide.
La voici qui se fraye un chemin, enjambe un groupe de jeunes lecteurs qui laissent traîner leurs sacs et leurs pieds dans le passage. Car, si on y prête attention, il y a, à Angoulême, ceux qui circulent et ceux qui sont assis. Pas sur des bancs, des chaises ou quoi que ce soit de civilisé : non, au sol, par terre, à la bonne franquette.
Qui sont-ils, ceux que la BD a terrassés ou hypnotisés de la sorte ? Eh bien, il y a les enfants, et il y a les vieux. Pas les personnes âgées, les vieux, parce qu’on est jeune, et après on est vieux, c’est simple.
Les vieux s’asseyent parce qu’ils sont un peu fatigués d’avoir piétiné entre les stands, alors, ils se posent là, sur la moquette, sur le béton, ce qu’on ne fait jamais dans la vie ordinaire : « Circulez, y’a rien à voir ! » Mais là, ils le font, et ils en prennent plein la vue.
Les enfants, eux, en tailleur ou allongés sur le ventre, sont plongés, absorbés jusqu’à la moelle, dans la lecture d’un album. Autour d’eux, au-dessus d’eux : l’imaginaire. En majesté, en liberté. Une magnifique excroissance du cerveau, des nerfs, du corps.
Ici, des affiches géantes où se déploient des villes fantastiques et verdâtres dont les contours flottent et se déforment : on les croirait tout droit sorties de l’esprit des trois adolescents qui, à terre, lisent. De la science fiction en apesanteur.
Plus loin, Nestor Burma, pipe au bec, parigot en diable, côtoie des pin-up, des pépés, des pétroleuses, des guerrières et des sauvageonnes sanglées de cuir (ultra moulant) échappées, en désordre, du polar, de l’heroic fantasy, des années 40, des jeux vidéos, des comic books américains : du fantasme à l’état pur.
Là, des couvertures d’album, et des premiers plans de héros ou de anti-héros sont exposés dans des projections lumineuses : un kaléidoscope bigarré où l’on trouve la ligne claire des personnages des ouvrages de jeunesse et des trognes à la Raspoutine, la mièvrerie des héroïnes à crinoline ou à jupette, et la souffrance d’une géante allongée qui se souvient, et, pêle-mêle, de l’aventure et de l’introspection, des héros qui chevauchent, qui volent, ou qui, comme Corto Maltese, nous toisent de leur air de pirate.
Et aussi, ces mini Moi qui, hauts comme trois pommes, traversent le festival comme ils traversent l’histoire. Ils sont parfois, tout simplement, l’écho d’une mémoire individuelle et de souvenirs d’enfance, c’est le garçonnet de Riad Sattouf (L’Arabe du futur) ou la fillette de Catherine Meurisse (Les Grands Espaces). D’autres fois, ils n’ont d’enfantin que le trait. Ces petits personnages,avatars de l’auteur, comme protégé par le dessin et sa naïveté voulue, permettent de tenir à distance les traumatismes intimes et collectifs que sont les guerres, les attentats (Catherine Meurisse, La Légereté), ou bien, sur le registre humoristique, ils nous livrent la vision un peu décalée, souvent féminine et féministe, des mésaventures et absurdités du quotidien.
Sur cette galerie de personnages, colorée et fabuleuse, plane l’ombre tutélaire de Batman, qui veille sur Gotham City et fête à Angoulême ses 80 ans d’existence.

Que choisir ? On ne peut tout voir. Cette année, le Grand Prix a été décerné à la mangaka Rumiko Takahashi. Une femme auteur, une autrice donc, après le tollé soulevé en 2016, où aucune n’avait été retenue dans la sélection officielle, un genre très lu mais peu primé, le manga : voilà qui semble intéressant, novateur, moderne !
Mais notre originale a ceci d’extraordinaire qu’elle remonte le courant, comme les saumons : elle boude l’espace manga et nous entraîne à sa suite voir des expositions qui, toutes deux, célèbrent un parcours : celui du super héros chauve souris, et celui du dessinateur italien Milo Manara, dont le deuxième tome du Caravage est sorti depuis peu, et à qui est consacrée une rétrospective, pour ses 50 ans de carrière.
 À vrai dire, ça la gène un peu aux entournures, l’originale, qu’on ait mis à l’honneur ces deux figures. Parce que Batman, tout de même, c’est la toute puissance du mâle américain. Manara, de son côté, est connu pour ses dessins de femmes en pâmoison, croupe à l’air et lèvres entrouvertes. Alors, justement, comme ça la dérange, ça la démange, elle va y voir de plus près.
À vrai dire, ça la gène un peu aux entournures, l’originale, qu’on ait mis à l’honneur ces deux figures. Parce que Batman, tout de même, c’est la toute puissance du mâle américain. Manara, de son côté, est connu pour ses dessins de femmes en pâmoison, croupe à l’air et lèvres entrouvertes. Alors, justement, comme ça la dérange, ça la démange, elle va y voir de plus près.
Chez Manara d’abord, quelque chose accroche son attention : alors que tout le parcours est ouvert, invitant le visiteur à passer d’une période à l’autre de la production du Maestro, une petite pièce, vraiment réduite, au centre, est fermée – mais si peu – par un rideau de fils de soie rouges. Une pancarte, à l’entrée, met en garde les animateurs et les parents, responsables du jeune public. Scènes choquantes.
 À l’intérieur, les planches les plus ouvertement érotiques, celles qui ont fait le succès des album Le Déclic (ou comment contrôler ou plutôt libérer par l’intermédiaire d’une télécommande les pulsions sexuelles de l’héroïne) et Le Parfum de l’invisible (ou que fait un homme qui découvre le sexe et qui, de surcroît, possède un philtre d’invisibilité, quand il croise de pulpeuses créatures ?). Voyeurisme ? Femme objet ? C’est la mise en scène, finalement, qui permet de sortir du cliché. Dans quoi pénètre-t-on en effet quand on pousse les fils soyeux du petit habitacle ? dans une maison close ? dans un peep show ? ou plutôt dans l’idée qu’on en a, dans un espace purement imaginaire, qui donne corps à la représentation qu’on se fait du sexe : c’est rouge, c’est petit (le sexe féminin, évidemment), et c’est interdit. Le plus merveilleux dans l’exposition : on y entre, et le seul élément gênant, choquant et déplacé, c’est cette pancarte…
À l’intérieur, les planches les plus ouvertement érotiques, celles qui ont fait le succès des album Le Déclic (ou comment contrôler ou plutôt libérer par l’intermédiaire d’une télécommande les pulsions sexuelles de l’héroïne) et Le Parfum de l’invisible (ou que fait un homme qui découvre le sexe et qui, de surcroît, possède un philtre d’invisibilité, quand il croise de pulpeuses créatures ?). Voyeurisme ? Femme objet ? C’est la mise en scène, finalement, qui permet de sortir du cliché. Dans quoi pénètre-t-on en effet quand on pousse les fils soyeux du petit habitacle ? dans une maison close ? dans un peep show ? ou plutôt dans l’idée qu’on en a, dans un espace purement imaginaire, qui donne corps à la représentation qu’on se fait du sexe : c’est rouge, c’est petit (le sexe féminin, évidemment), et c’est interdit. Le plus merveilleux dans l’exposition : on y entre, et le seul élément gênant, choquant et déplacé, c’est cette pancarte…

Alors, on cogite, parce que tout ça, ça émoustille aussi les neurones, et on se dit que c’est le contraire absolu des attributs (tout aussi imaginaires) du sexe masculin : là où l’un est interdit l’autre s’impose, là où le premier est petit le second se doit d’être énorme, mais…et pour la couleur ? Certainement pas le rouge. Reste blanc ou noir. Alors là, on sort de la guerre des sexes et on rentre dans les luttes raciales. Courons chercher la réponse chez Batman.
Même impression, c’est là toute la magie, d’entrer dans la caverne de nos désirs et de nos peurs, dans une sorte de conte initiatique, urbain et déjanté, que les illustrateurs et scénaristes qui, depuis 1939, se sont succédés pour donner vie au mythe Batman n’ont cessé d’enrichir et de modifier. Tout un espace est consacré à l’Arkham Asylum, où, dans l’univers Batman, sont enfermés les psychopathes, tous ces super méchants qui mettent le héros à l’épreuve.

Au sol, en grandes lettres jaunes, comme s’il s’agissait d’une scène de crime : DANGER Do not cross the line. Ne pas franchir la ligne.
 Évidemment, et une nouvelle fois, on cross the line. Dans une cage vitrée, à l’isolement, le Joker, cheveux verts et sourire de dément, nous pointe du doigt. Bienvenus dans votre propre folie !
Évidemment, et une nouvelle fois, on cross the line. Dans une cage vitrée, à l’isolement, le Joker, cheveux verts et sourire de dément, nous pointe du doigt. Bienvenus dans votre propre folie !
Dans la Batcave reconstituée, nous sommes tout à la fois dans le cerveau (tableau de bord, ordinateurs, écrans) et dans les tripes du héros. Ses superpouvoirs à lui, c’est sa volonté, et son corps ultra musclé, forcément et démesurément musclé. D’ailleurs, le voici qui surgit de l’ombre : immense, dressé, raide comme… la justice. Et noir.

On ressort de ces expositions comme d’un voyage dans son propre inconscient, rabiboché avec des expressions qui peuvent, de loin, sembler peu subtiles, mais qui, dans son langage à lui, sont les plus viscérales.
Ce festival et ses installations, la BD et ses projections font figure d’immense coming out : de façon débridée, zigzagante, voici le Mal, le Bien, le Sexe, la Peur, la Folie, sortis, tout costumés, de nos cerveaux…
 L’originale termine son parcours en allant écouter Milo Manara. Dans l’amphithéâtre de l’espace Franquin, il est assis, sur une estrade, devant un écran géant. Lui, 73 ans, tout petit. Derrière, projetée sur l’écran, une sélection de croquis, de cases, de planches, pour illustrer son propos. Et ces dessins forment comme une gigantesque bulle de pensée, où s’étalent les images qu’il a dans la tête. On se rend compte alors qu’il a réussi son coup, le bougre : dès qu’apparaît une femme, et, quand on est sorti, l’effet se prolonge, l’œil, le corps se souviennent, et le véritable Déclic se fait : on l’érotise, on passe dans l’imaginaire. C’est un va-et-vient sans fin, en direct : on voit, on imagine, on circule d’une dimension à l’autre sans heurts et sans ligne rouge. Manara explique que sa collaboration avec Fellini est née de quelques planches qu’il avait dessinées lors d’un hommage au cinéaste, et que ce dernier avait été séduit par l’univers onirique et sensuel qui s’y déployait, mais aussi par les mots Senza fine, Sans fin, apposés dans la dernière case. Fellini, lui aussi, refusait de mettre le mot Fin.
L’originale termine son parcours en allant écouter Milo Manara. Dans l’amphithéâtre de l’espace Franquin, il est assis, sur une estrade, devant un écran géant. Lui, 73 ans, tout petit. Derrière, projetée sur l’écran, une sélection de croquis, de cases, de planches, pour illustrer son propos. Et ces dessins forment comme une gigantesque bulle de pensée, où s’étalent les images qu’il a dans la tête. On se rend compte alors qu’il a réussi son coup, le bougre : dès qu’apparaît une femme, et, quand on est sorti, l’effet se prolonge, l’œil, le corps se souviennent, et le véritable Déclic se fait : on l’érotise, on passe dans l’imaginaire. C’est un va-et-vient sans fin, en direct : on voit, on imagine, on circule d’une dimension à l’autre sans heurts et sans ligne rouge. Manara explique que sa collaboration avec Fellini est née de quelques planches qu’il avait dessinées lors d’un hommage au cinéaste, et que ce dernier avait été séduit par l’univers onirique et sensuel qui s’y déployait, mais aussi par les mots Senza fine, Sans fin, apposés dans la dernière case. Fellini, lui aussi, refusait de mettre le mot Fin.
Le Festival International de la Bande Dessinée, c’est ça : circuler quatre jours durant à travers les excroissances de notre imaginaire, sans pancarte et sans interdit. CROSS THE LINE.
Et quand je pense qu’il y en a qui veulent construire des murs…
Jacqueline Phocas Sabbah
Bande dessinée
46e festival de la bande dessinée d’Angoulême, 24-26 janvier 2019






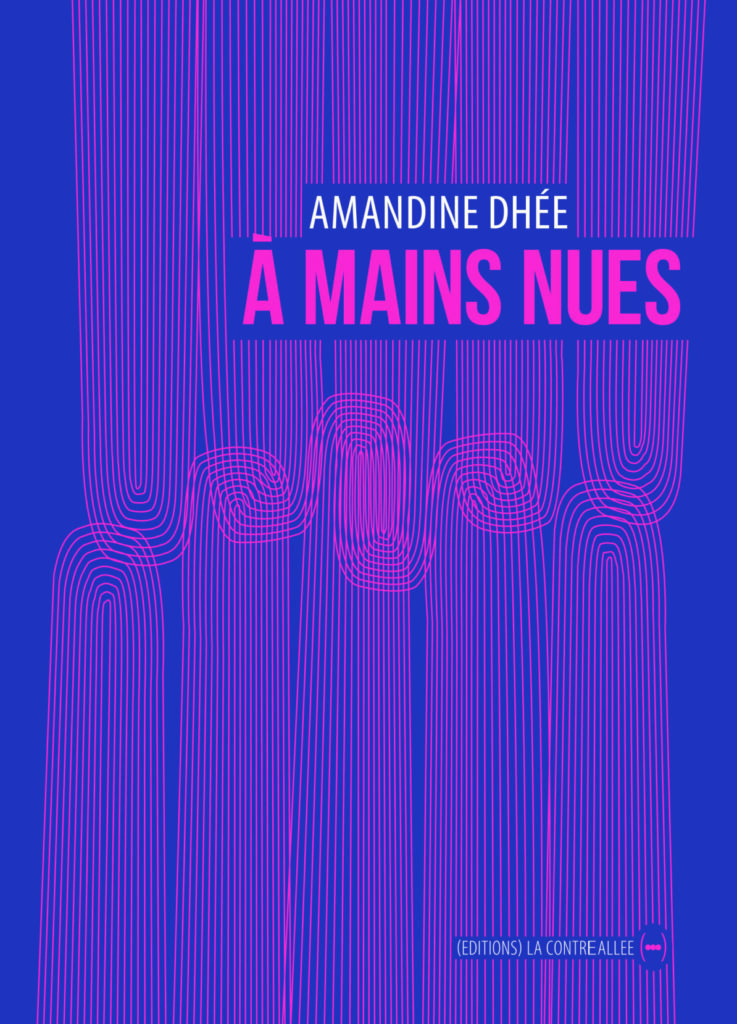
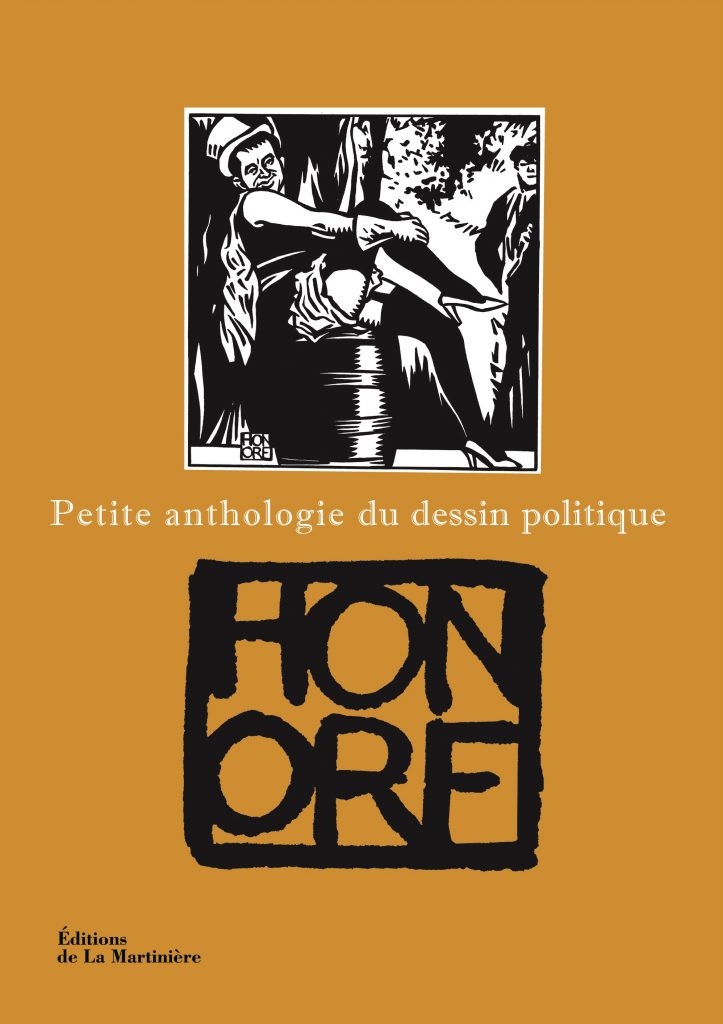

0 commentaires