Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
J’écrivais dans « Ritournelle », une de mes précédentes chroniques, qu’il s’agissait de savoir « comment occuper le présent » et non de jouer les Cassandre en prédisant des lendemains sombres puisque personne ne possède le don de prophétie. Cependant, occuper le présent ne signifie pas s’agiter en tous sens, hurler à tous vents ou détruire. Or il semble que ce soit précisément ce que beaucoup de nos contemporains entendent faire ces temps derniers. Les hommes sont-ils devenus fous ?
Il est aujourd’hui à la mode d’être contre. Quel que soit le sujet, il est de bon ton de prendre position, parfois violemment, en rejetant aussi bien les idées, les choses que les personnes. Ainsi avais-je entendu, il y a quelque temps déjà, une chanteuse en vogue déclarer qu’elle était contre le Sida. Une autre fois, une écrivaine de renom se disait contre la guerre. Elle insistait de plus sur le caractère courageux de son engagement. Les Gilets jaunes sont contre le gouvernement, contre Macron, contre le capitalisme et accessoirement contre les banques qu’ils brûlent et contre le Fouquet’s qu’ils saccagent. Pour leur part, les Anglais sont contre l’Europe : « they want to leave » ou plutôt « they don’t want to remain ». Appelons cela le Brexit. D’autres encore sont contre le réchauffement climatique. At last but not least, certains sont contre la souffrance animale.
Mais si beaucoup savent vaguement ce qu’ils ne veulent pas, peu connaissent ce qu’ils désirent. L’exemple de nos amis anglais est sur ce point éloquent. Après s’être violemment opposés à l’Europe lors de la campagne du Brexit, ils multiplient maintenant les atermoiements. Ils désirent nous quitter sans toutefois nous abandonner complètement. Ils voudraient l’Europe sans l’Europe. Et il est vrai qu’un tel souhait a peu de chances d’aboutir. Il en va un peu de même pour nos Gilets jaunes qui rejettent le capitalisme sans toutefois condamner la propriété privée, pourtant au fondement du système libéral. De même, ils rejettent la politique d’Emmanuel Macron et désirent une autre République mais sont incapables de s’organiser afin de présenter une liste aux prochaines élections. Ils sont d’ailleurs également contre l’idée de la représentation. Si l’un deux se propose de parler au nom des autres, il se trouve aussitôt désavoué quand il n’est pas tout bonnement injurié. Ils sont ainsi d’accord pour être tous contre celle ou celui qui ose soutenir la moindre idée.
Ce constat qui se répète un peu partout dans le monde laisse penser que nous sommes bel et bien devenus fous. Il ne s’agit pas évidemment de ces folies qu’on enferme mais d’un délire beaucoup plus commun et surtout plus répandu. C’est un délire qui s’organise autour d’un non répété de façon quelque peu névrotique et qui ressemble au mécanisme de la dénégation décrit par Freud : le sujet se défend contre son désir en répétant qu’il n’est pas le sien. Il gagne par ce procédé retors la possibilité de parler sans cesse de ce qui lui tient le plus à cœur tout en le niant. Nos Brexiters semblent bien être dans ce cas-là. Ils ne cessent de vilipender l’Europe (la presse anglaise ne parle quasiment plus que de cette affaire, reléguant le reste des actualités au rang du superflu) et réclament en même temps un nouveau délai à l’Union européenne afin de préciser les modalités du leave. Les Gilets jaunes partis en guerre contre l’État se plaignent du déclin des services publics. Ceux qui sont contre la guerre sont parfois les premiers à réclamer à l’État français d’intervenir par la force et de toute urgence pour résoudre une crise humanitaire dans un pays lointain. La contradiction ne gêne jamais les fous.
Ce délire renvoie également à cette capacité proprement extraordinaire qu’ont de très nombreuses personnes à nier ce qui existe. Ainsi la critique du capitalisme, très en vogue, devrait conduire en toute logique à un renforcement de l’électorat du PCF. Les gens devraient s’attaquer aux racines du mal : la propriété privée, le droit bourgeois et les libertés individuelles qu’il garantit comme la liberté de manifester par exemple ou le droit de vote ou encore la simple liberté d’expression. On voit bien que nous sommes loin du compte quand nous regardons d’un peu près les revendications nombreuses des Gilets jaunes, qui vont très souvent dans le sens d’un renforcement du pouvoir de l’État (entendu au sens d’un État bourgeois). Quant à ceux qui militent contre la souffrance animale, ils n’entendent pas évidemment parler des maux que nous infligeons à un tas d’espèces comme les insectes, les araignées et autres créatures charmantes que Dieu a bien voulu nous octroyer et que nous écrasons sans y penser davantage. Il est bien entendu que je ne désire en rien voir un mammifère, un oiseau ou un poisson souffrir gratuitement. Mais je ne vois pas comment militer contre la souffrance animale étant donné que la nature ne s’est jamais privée de causer les plus grands maux à ce qu’elle engendre chaque jour avec une générosité et un luxe déconcertants. La souffrance fait hélas partie de l’existence, animale ou humaine. On peut bien sûr militer contre l’existence : ce sera plus efficace.
Dans un fragment célèbre des Pensées, Pascal écrit que « les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n’être pas fou » (fragment n°412). Mais pourquoi les hommes sont-ils « nécessairement fous » ? En philosophie, la nécessité n’est pas rien : elle renvoie à l’essence d’une chose, ou à sa nature pour m’exprimer de façon plus commune. Les hommes seraient condamnés à la folie, taillés pour la folie. Ce serait leur mode d’être primordial et donc inévitable. C’est qu’en effet l’existence est insupportable à qui se sert de sa seule raison. La lucidité apparaît chez Pascal comme un luxe que nous n’avons pas les moyens de nous offrir parce que nous allons mourir et que nous ne pouvons pas l’accepter. Il faut donc un peu de folie pour supporter l’insupportable, un peu de folie, c’est-à-dire une bonne dose d’illusions. Celles-ci se trouvent aussi bien dans la religion (ce que bien évidemment un penseur chrétien comme Pascal ne pouvait envisager) que dans un certain type de militantisme, c’est-à-dire dans les différentes formes de refus de ce qui nous est donné. Et ce que refusent les hommes, depuis toujours semble-t-il, c’est qu’ils vont mourir. Le non répété par le névrosé ou le contre tout en vogue ces temps-ci ne sont peut-être qu’une même façon qu’ont nos contemporains de refuser leur destin. Autrefois, les gens croyaient en Dieu afin de penser qu’ils seraient sauvés, aujourd’hui ils brûlent ce qu’ils trouvent à portée de main. Les modalités de ces croyances ne sont pas les mêmes (quoique la religion puisse se montrer également très destructrice) mais elles relèvent du même symptôme : ce qui existe est inacceptable parce que je suis voué à disparaître. Alors autant détruire ce monde. Nietzsche parlait à ce propos de nihilisme. C’est donc leur incapacité à accepter la vie qui rendrait les hommes « nécessairement fous ».
Mais, ajoute Pascal de façon paradoxale, « ce serait être fou par un autre tour de folie de n’être pas fou ». Pour ce penseur, il n’existe donc aucun remède à la folie ordinaire des hommes. Celui qui prétendrait « n’être pas fou », c’est-à-dire le sage, serait peut-être encore plus fou que le commun des mortels. « Qui veut faire l’ange fait la bête » écrit encore Pascal (Pensées, fragment n°678). Nous ne pouvons en effet échapper à notre condition. Le moine qui se retire dans sa thébaïde vit comme une brute au milieu des bêtes. L’homme qui affirme avoir renoncé à tous les faux plaisirs, entendez les plaisirs de la chair, n’est qu’un pauvre névrosé incapable d’assumer sa sexualité. Celui enfin qui prétend aimer l’humanité ne voit pas le miséreux qui lui tend la main afin d’obtenir quelques sous. L’immensité de son sentiment le rend aveugle aux détails qui font le monde.
Que nous soyons tous fous, je crois qu’il n’y a guère de doute là-dessus. Mais il y a pourtant folie et folie. L’une est joyeuse, l’autre est triste. L’une prend la vie à bras-le-corps en oubliant que celle-ci n’est que passagère et que le ver est déjà dans le fruit comme nous le rappellent ces natures mortes du XVIIe siècle qui montrent une pomme ou une poire pourrissant au milieu d’une corbeille de fruits juteux et resplendissant de couleurs ; l’autre folie refuse la vie parce que sa pensée est une méditation de la mort et non de la vie, pour paraphraser Spinoza. Enfin les fous joyeux aiment la vie, les autres la détestent. Je ne crois pas cependant que les premiers soient plus sages que les seconds : ils sont seulement plus heureux. Ce sont de « doux dingues », comme on le dit parfois en français. Car il faut une sacrée dose de folie pour être heureux. Les autres en revanche semblent voués à un malheur éternel : rien ne leur plaît, ils se plaignent sans cesse, enfin ils sont contre.
Gilles Pétel
La branloire pérenne


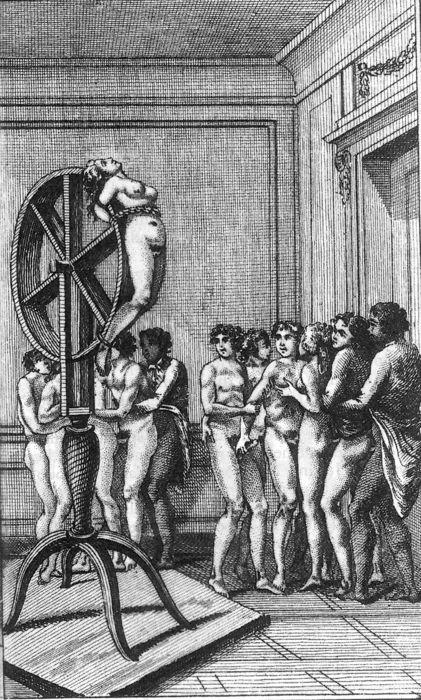







0 commentaires