Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
Depuis plusieurs années, peut-être depuis le tournant des années 1980, les citoyens sont de plus en plus considérés comme pleinement responsables de leurs actes. Alors qu’auparavant la justice prenait souvent en compte les circonstances atténuantes comme la force des passions ou le poids du milieu social, nous avons aujourd’hui tendance à considérer que les coupables le sont entièrement. C’est ainsi par exemple que Nicolas Sarkozy a permis d’incarcérer les mineurs à partir de 13 ans.
Mais que signifie au juste être responsable ? Sur quoi se fonde la responsabilité ? Les êtres humains sont-ils vraiment des êtres responsables ?
Le mot vient du latin respondeo : je réponds. Être responsable, c’est pouvoir répondre de ses actes. Cette étymologie nous apprend d’abord que la responsabilité est par principe adressée à quelqu’un. Je suis responsable devant les autres, je suis responsable de mes actes parce que je vis en société. Le sauvage, s’il en a jamais existé un, ne peut en ce sens être tenu pour responsable de quoique ce soit puisqu’il ne peut répondre à personne : il est seul. L’étymologie nous apprend ensuite que seul un être doué de parole peut être considéré comme responsable. Celui qui n’est pas capable d’articuler un mot ne peut répondre de rien. C’est en ce sens qu’il n’existe pas de responsabilité animale : avant même de se poser la question de savoir si les animaux ont une conscience, le fait qu’ils ne parlent pas nous interdit de les juger ou simplement d’attendre d’eux qu’ils reconnaissent leurs torts ou leurs crimes. Un chien qui mort un enfant ne peut rien nous dire de ce qu’il a fait.
Mais que signifie répondre de ses actes sinon se reconnaître comme leur auteur : les actes commis sont bien mes actes. Ce n’est ni un autre ni une puissance armée ou occulte qui est à l’origine du crime mais bien moi. Dans Les Choéphores d’Eschyle, Oreste ne peut être tenu pour responsable du meurtre de sa mère Clytemnestre parce qu’il n’a pas agi de son plein gré mais poussé par une divinité, Apollon, comme Oreste ne cesse de le rappeler lui-même afin d’ôter à son matricide son caractère scandaleux. Il en va de même pour Œdipe victime de son destin : les héros grecs ne sont pas des héros responsables mais les objets d’une vengeance qui les dépasse.
Enfin répondre de ses actes, c’est être capable de les justifier. La justification est cependant une notion ambiguë. Au sens propre, elle renvoie à une exigence de justice. Me justifier, c’est pouvoir indiquer les raisons qui m’ont conduit à commettre tel ou tel acte. Si ces raisons sont bonnes, mon action est justifiée. Par exemple un médecin peut justifier avoir menti à un malade atteint d’un cancer en phase terminale en invoquant sa volonté de ne pas rajouter une souffrance psychique à une souffrance morale : il considère comme inutile d’apprendre au malade qu’il ne lui reste que quelques jours à vivre. Il va de soi qu’une pareille justification n’a rien d’une évidence. Mais il arrive aussi que nous ne soyons pas capables de justifier ce que nous avons fait. Nous ne savons pas nous-même pourquoi nous avons agi ainsi. Lorsque l’affaire est bénigne, personne ne s’en soucie. Mais si le cas est sérieux (offense, délit ou crime), nous nous entendons dire que notre acte est injustifiable – et nous n’en sommes pourtant pas moins tenus pour responsables de ce que nous avons fait. On voit sur cette dernière remarque que si être responsable signifie originellement être capable de répondre, la notion s’est en fait considérablement élargie dans son usage puisqu’un être qui ne trouve rien à dire de ses actes n’en demeure pas moins responsable : il en est bel et bien l’auteur.
C’est donc du côté de la notion d’auteur qu’il faut chercher le fondement de la responsabilité. Or cette notion, tout comme celle de justification, est extrêmement problématique parce qu’elle renvoie à plusieurs idées elles-mêmes confuses, comme la conscience de soi, la volonté, l’identité et la causalité. L’auteur d’un acte non seulement se reconnaît dans ce qu’il a fait (c’est bien moi qui ai fait cela), mais affirme aussi l’avoir fait volontairement, c’est-à-dire librement, et en toute conscience. Il est en somme la cause de son acte, de la même manière que nous disons de la tempête qu’elle est la cause d’un sinistre (arbre arraché, toiture envolée, pierre qui tombe d’un toit) en oubliant que si l’arbre a été arraché, c’est qu’il était âgé, si la toiture s’est envolé, c’est qu’elle était mal posée, etc. Enfin l’auteur d’un acte doit être capable de se reconnaître « comme une seule et même personne » (Kant : Anthropologie du point de vue pragmatique), c’est-à-dire comme un être identique à lui-même à travers le temps : si j’ai volé un sac il y a plusieurs mois, je ne peux pas me disculper en invoquant les changements qui me sont survenus et qui m’interdiraient de me reconnaître en celui que j’ai été et que je ne suis plus. Je ne peux par exemple invoquer une folie amoureuse et déclarer avoir volé parce que j’étais, à ce moment-là, prêt à tout pour payer à celle que j’aimais un joli bouquet de fleurs. L’identité de la personne dans le temps est une des conditions de la responsabilité.
Cet ensemble de notions qui forment le concept d’auteur résiste mal à l’analyse. En effet sommes-nous jamais pleinement conscients de nous-mêmes ? Lorsque nous affirmons vouloir, n’est-ce pas plutôt désirer qu’il faudrait dire ? Possédons-nous réellement un libre arbitre ? Enfin notre identité est-elle une évidence ?
Des philosophes comme Spinoza, Hume ou encore Nietzsche ont tous sévèrement critiqué ces idées qu’ils tiennent pour de simples illusions. Notre conscience n’est qu’une « perception inadéquate », c’est-à-dire incomplète, remarque Spinoza qui réduit ainsi la conscience à une forme d’ignorance. Notre identité ne repose sur aucune perception précise, affirme Hume dans le Traité de la nature humaine (quand je dis « moi », qu’est-ce que je mets au juste sous ce mot ?). Enfin la volonté n’est ni une ni transparente, répète Nietzsche dans Par delà le bien et le mal, mais l’expression d’un jeu de forces complexes que j’ignore. Le « Je » lui-même n’est rien d’autre qu’une construction grammaticale.
Ces critiques fort connues ont pour résultat de remettre en cause la possibilité d’une action responsable pour faire de cette idée une simple fiction. Nous continuons pourtant à nous considérer comme tous responsables et même de plus en plus comme je le notais au début de cette chronique. C’est ainsi qu’il arrive ces derniers temps qu’un tribunal condamne à une peine de prison une personne pourtant atteinte de troubles mentaux. Mais comment expliquer un pareil entêtement ou plutôt un tel déni ? Comment expliquer que nous ne nous soyons pas encore débarrassés de cette vieillerie conceptuelle comme de toutes les idées qu’elle traîne dans son sillage ?
Sans doute parce qu’il n’y a ni morale ni justice sans responsabilité. Si « Je est un autre » (Rimbaud), je ne peux plus répondre de moi, ni de mes pensées ni de mes actes. Je ne peux donc être jugé et encore moins condamné. Mais ce qui serait alors la parfaite justice, reconnaître que les hommes ne savent pas ce qu’ils font, à l’instar des animaux dont nous sommes sans doute bien plus proches que nous ne le voudrions, serait en même temps une complète injustice puisque nous ne pourrions plus distinguer l’innocent du criminel. Or il faut que quelqu’un « paye ». La responsabilité peut alors être comprise comme une fiction nécessaire à la vie en société. Nous n’avons inventé le libre arbitre, la volonté, l’identité du moi et tant d’autres notions morales que pour fonder une justice, c’est-à-dire pour prévenir les troubles capables de désorganiser le corps social. Il faut que les hommes se « sentent » responsables de ce qu’ils font pour qu’ils évitent de laisser libre cours aux forces qui les animent. La notion de responsabilité possède ainsi essentiellement un but répressif – tout comme notre justice qui s’occupe de sanctionner les crimes et les délits davantage que de redistribuer les richesses.
La tendance de nos sociétés à responsabiliser de plus en plus les individus, tendance bien perceptible dans la judiciarisation de la vie privée, renvoie ainsi en dernière analyse au caractère de plus en plus policier de nos démocraties. Rappeler ce qui me paraît être une évidence doit enfin nous inciter à un peu plus de prudence dans nos jugements et de clémence dans nos sanctions. « Frères humains qui après nous vivez /
N’ayez les cœurs contre nous endurcis », disait François Villon.
Gilles Pétel
La branloire pérenne



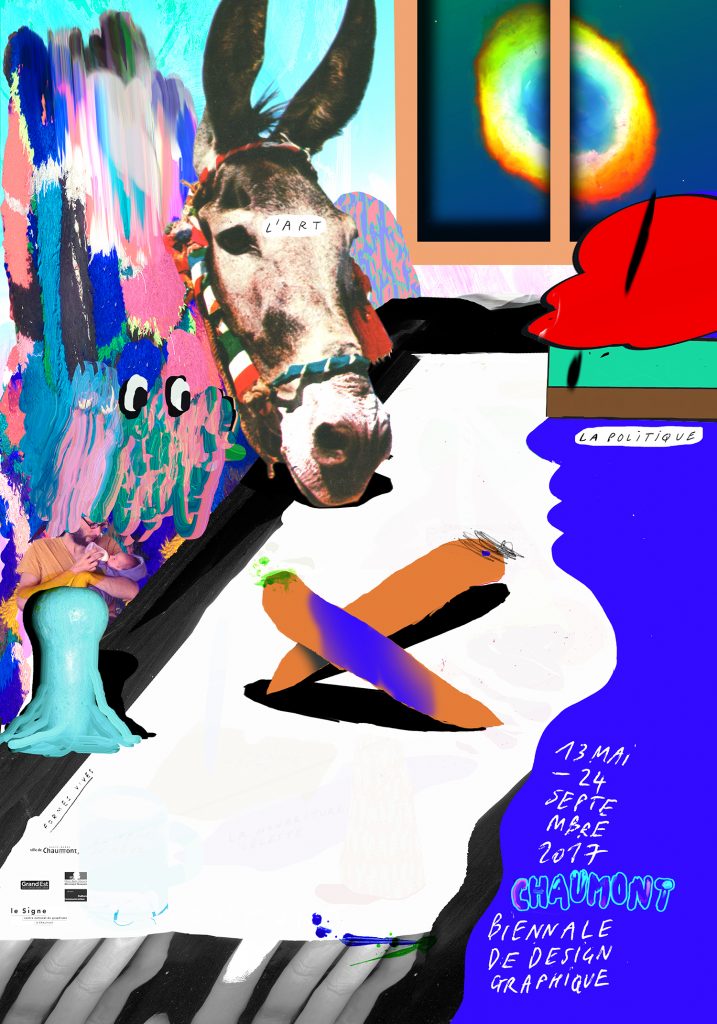
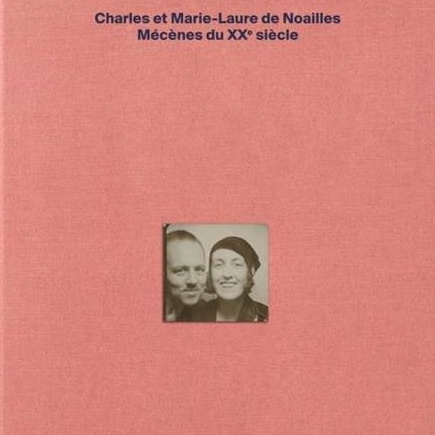



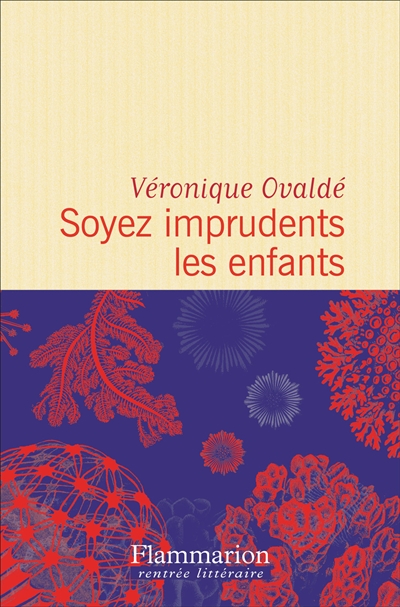

0 commentaires