Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
En ce début d’année où la coutume veut que nous nous souhaitions une bonne et heureuse année, il n’est peut-être pas inutile de s’interroger sur la nature du bonheur.
La question est rebattue, d’autant plus qu’elle est populaire.
Je me contenterai, en guise d’amuse-bouche, de rappeler deux définitions diamétralement opposées du bonheur, celle d’Aristote tout d’abord qui voit dans le bonheur « une activité de l’âme en accord avec la vertu » (Éthique à Nicomaque, livre I, traduction Jules Tricot), celle de Kant ensuite qui constate, sans doute avec un peu d’amertume, que le bonheur n’est qu’un « idéal de l’imagination » (Fondements de la métaphysique des mœurs, traduction Victor Delbos).
Ni Aristote ni Kant, malgré leurs divergences, ne nous parlent cependant. Hume et les philosophes de la tradition libérale (Stuart Mill entre autres) semblent plus proches de nos préoccupations et de nos idées. Hume remarque en effet que je peux tout à fait être heureux si j’ai chez moi un bon repas servi en une agréable compagnie alors qu’à l’autre bout de la ville un incendie fait rage. Le bonheur, notre bonheur, est individualiste : « Il n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon doigt » affirme Hume dans le Traité de la nature humaine (traduction française d’André Leroy). En somme, nous pouvons être heureux alors que d’autres souffrent.
Aujourd’hui la question du bonheur apparaît indissociable de celle de l’individualisme. Cette dernière notion est cependant aussi confuse que la précédente.
L’individualisme est d’abord un mot avant d’être une idée, un mot qu’on utilise à tort et à travers, tantôt pour déplorer les effets néfastes de nos sociétés individualistes, tantôt pour louer les mérites de l’individualisme dans la perspective de la méritocratie. Le mythe du self made man est celui d’un individu surpuissant pour ne pas dire tout-puissant. L’individu fait Dieu en somme. Et heureux bien sûr, comme peut l’être la divinité à qui rien ne manque.
Nos chaînes de télévision, en ces temps de fête, savent à la fois vanter les joies de ceux qui ont réussi (multipliant les images de foie gras et de crustacés) et déplorer notre incapacité à nous préoccuper du sort de ceux qui sont sans abri (avec cette fois-ci de nombreux reportages auprès des plus démunis).
Dans les deux cas cependant, le mot, avec ses charges opposées, fait écran à la compréhension du problème.
Personne en effet ne remet en cause le caractère individualiste de nos sociétés qui est, pour le dire rapidement, un véritable poncif. Je remarque que les esprits de droite comme de gauche l’utilisent sans rechigner. Les premiers pour le défendre (quoique assez mollement, conscients qu’un excès d’individualisme ruinerait leur goût d’un certain ordre), les seconds pour le vilipender : l’individualisme est petit bourgeois. Mais les deux partis s’accordent sur le fait qu’il existe.
Et s’il ne s’agissait précisément que d’une illusion ? Un regard même rapide sur l’état de nos sociétés post-industrielles doit suffire à nous convaincre que nous vivons dans des sociétés de masse qui n’ont en réalité rien d’individualiste. Ce constat n’est pas neuf. On le trouve déjà dans La Condition de l’homme moderne de Hannah Arendt.
La question est alors de savoir pourquoi « nous » continuons à faire de l’individualisme le trait dominant de notre époque ?
Il y a sans doute d’abord une raison juridique. Nos droits sont ceux de l’individu (ou de la personne humaine, mais c’est dans les individus que celle-ci s’incarne matériellement). La plupart des pays occidentaux refusent de reconnaître un droit communautaire. Il faut donc bien, dans cette perspective, que l’individu ait quelque consistance puisqu’il est au fondement de notre entreprise juridique.
Il y a ensuite une raison idéologique. L’individualisme renvoie, la plupart du temps, à la société de consommation et au fait que les êtres ne sont plus guidés que par leurs seuls désirs. Nous vivons pour jouir. C’est en ce sens que nos sociétés sont qualifiées d’hédonistes, voire d’épicuriennes (bien que ce que nos contemporains attribuent à ce philosophe n’ait en réalité rien à voir avec ce qu’il a écrit). L’individu est ainsi pensé comme un être de désirs, plus ou moins dépourvu de cervelle, prêt à tout pour se satisfaire au plus vite, comme l’indique avec justesse le titre du livre de Morgan Sportès consacré à l’affaire Fofana : Tout, tout de suite (Fayard, 2011).
Présenté sous cet angle, l’individualisme serait déjà peu reluisant s’il ne renvoyait de plus à une illusion. Ces individus dont le moi nous paraît démesuré sont en réalité très peu individualisés puisqu’ils désirent tous peu ou prou les mêmes choses. Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard décrit le caractère mimétique du désir : « le désir est désir du désir de l’autre ». Chez ce philosophe, le désir s’apparente à l’envie, à la jalousie ou à l’admiration lorsque celui que nous cherchons à imiter se situe trop loin de nous pour que nous puissions envier ce qu’il possède.
On voit à travers ces quelques remarques qu’accabler l’individualisme de tous les maux ou de tous les bienfaits de notre société est surprenant. Nous manquerions plutôt d’un manque d’individualités que d’un excès d’individualisme.
Mais qu’est-ce qu’un individu ? Cette notion est ancienne. On la trouve chez Platon, chez Aristote, chez Montaigne qui déclare qu’il est impossible de trouver deux œufs parfaitement semblables, chez Leibniz enfin avec son fameux principe des indiscernables. L’individu pour ces deux derniers penseurs est ce qui définit le réel. En ce sens une société ne peut être que composée d’individus distincts. Mais être un individu et posséder une individualité ne sont pas deux choses identiques comme l’atteste l’analyse de René Girard. Les sociologues ont montré de leur côté que l’individu (comprenez l’individualité) se construit : elle n’est pas un fait premier ou naturel. Or il semble que l’économie de nos sociétés s’emploie précisément à déconstruire les individualités pour ramener tous les individus à un standard acceptable (les marxistes parleraient ici d’aliénation) et rentable.
Mais je reviens à mon sujet. Qu’est-ce que le bonheur ? Existe-t-il ? Beaucoup en doutent. Les Français – mais il serait surprenant que nous soyons les seuls – souffrent d’un mal-être, dit-on. Ils se plaignent, rien ne les satisfait vraiment, quoiqu’ils consomment beaucoup ou pas assez pour certains. Mais comment pourrait-il en aller autrement si leurs désirs sont empruntés ? L’une des conséquences de la thèse de René Girard est le caractère insatiable de nos désirs. Je ne peux en effet jamais posséder le désir de l’autre. Quand j’obtiens par chance le bien que l’autre désirait avant moi, ce bien perd aussitôt tout son attrait puisqu’il est désormais dépourvu de la qualité qui le rendait enviable. Il n’est plus l’objet d’un désir mystérieux, quasi divin, mais un objet tangible, tristement matériel que la flamme de mon désir échoue à ranimer.
L’uniformisation de nos sociétés rend le désir impuissant et les hommes malheureux. Notre hédonisme semble n’être que la façade d’une demeure vide. Le reproche trop souvent adressé à nos concitoyens de ne penser qu’à eux apparaît comique au regard des remarques précédentes puisque les hommes la plupart du temps pensent à tout autre chose qu’à eux-mêmes. C’est moins leur moi qu’ils engraissent que les caisses des entreprises censées leur apporter « tout l’or du monde », un peu de sable en vérité.
Mais ne peut-on faire autrement ? Le bonheur n’est-il qu’une illusion ? La question est aussi vieille que la philosophie. Platon dans La République reprochait déjà aux hommes de ne poursuivre que des biens illusoires, des vanités. Mais le malheur ne se trouve pas tant dans ces objets sans consistance que dans le désir lui-même. Tant que celui-ci est emprunté ou mimétique, il ne peut être qu’une source de souffrance sans fin. Or c’est précisément la société qui impose aux hommes des désirs qui ne sont pas les leurs. René Girard a sans doute tort d’attribuer à la nature du désir ce qui n’est qu’un produit de l’histoire et d’un certain type d’économie.
Il faut enfin distinguer ce qui relève du désir de ce qui n’est qu’un simple caprice, qu’une envie passagère. Dans L’Éthique, Spinoza propose cette définition surprenante du désir comme « effort par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son être » (livre III, proposition 9, traduction Charles Appuhn). La notion d’effort semble en effet jurer avec celle du désir que nous nous représentons d’ordinaire comme dépourvu de peine. Quoi de plus facile, pense-t-on, que de se laisser aller à ses désirs ? L’expression commune « suivre ses désirs » renvoie à une passivité du désir qui a longtemps fait de celui-ci une maladie. C’est pourtant cet effort qui fait toute la singularité du désir lorsqu’il est nôtre. Il est toujours facile de suivre les désirs des autres (ou, comme le dit René Girard, de désirer ce que désirent les autres), il est revanche difficile non seulement de savoir ce que nous désirons vraiment et plus encore de chercher à « persévérer » dans ce désir qui rencontre dans sa marche les désirs des autres dressés contre lui comme autant d’obstacles. Ainsi des enfants qui apprennent tôt ou tard que les désirs, les espoirs que leurs parents ont fatalement placés en eux ne sont précisément pas les leurs. Mais comment savoir qu’un désir est bien nôtre ? Ne s’agit-il pas d’une nouvelle illusion ? Le critère est en réalité assez simple et se trouve dans l’effort que nous sommes prêts à dépenser pour réaliser notre principal désir qui est celui de vivre. Le reste, ce ne sont en effet que des bagatelles, sans doute agréables, mais souvent sans épaisseur.
Égoïsme suprême, dira-t-on ? Mais il n’y a « rien de plus utile à l’homme que l’homme » (É thique, IV, proposition XVIII, scolie). Nous ne pouvons nous épanouir qu’en nous associant à d’autres individus. Le caprice et l’envie au contraire nous dressent les uns contre les autres.
Le bonheur est donc bien une affaire personnelle. Aucun autre ne peut faire mon bonheur à ma place et je ne possède pas davantage le pouvoir de rendre les autres heureux. Cela n’implique pas toutefois que le bonheur ne soit pas en même temps une question politique. Il existe en effet des régimes, comme le despotisme ou la théocratie, qui interdisent aux individus de s’affirmer.
Gilles Pétel
La branloire pérenne







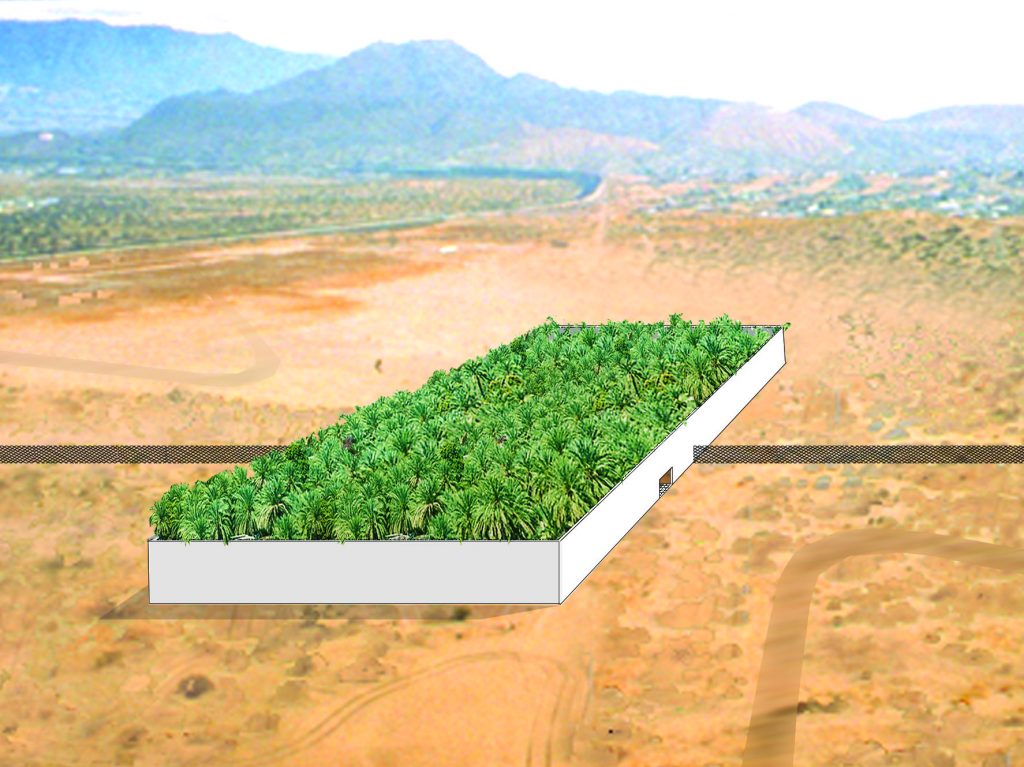

0 commentaires