Tout aura commencé comme dans un roman de Modiano. Un jour de 2010, Joséphine S. trouve dans sa boîte aux lettres un portefeuille en cuir brun appartenant à un certain Amer M. L’homme est un Algérien kabyle arrivé en France en 1954, ancien ouvrier du BTP. Des soucis de santé. Des soucis d’argent. Et une histoire, d’amour ou d’amitié, avec une certaine Colette M – pianiste à Radio-France, selon sa carte de visite. Amer a serré dans son portefeuille trois mots de Colette. Le premier dit : « Cher Amar (sic), ne pouvant plus aller au 104, étant malade, infection plus rayons c’est difficile à supporter (la suite est difficile à déchiffrer) ». Le deuxième : « le téléphone fixe ne marche toujours pas, répondeur avec voix de femme… un petit coup de fil me ferait plaisir ». Le troisième : « étant très inquiète de ne plus vous voir au bois, j’espère que votre santé est bonne. Si j’ai fait quelque chose de déplaisant, soyez aimable de me le dire. C’est sans le vouloir. Rendez-vous sur notre cher banc. »
Que faire de ce matériau ? Chercher à à retrouver Amer et Colette ? C’est délicat, le dernier mot semble indiquer une rupture, en tout cas un éloignement. De quel droit raviver des blessures ? Et puis, seules les traces font rêver. Or, les traces, les strates, c’est ce qui intéresse Joséphine Serre, comédienne, autrice et metteure en scène qui a fait des études d’archéologie. Dans sa précédente pièce, Data Mossoul, elle faisait se percuter le big data et la bibliothèque constituée par le roi assyrien Assurbanipal. Elle interrogeait les supports du savoir, de l’archivage, posait la question de la propriété des données, de leur potentielle obsolescence.
Le moteur d’écriture d’Amer M., ce sera l’hypothèse. Et si Amer avait été membre du FLN ? et s’il consultait des voyantes ? et s’il fredonnait Les mots bleus ? Plus tard : et si Colette était pied-noire ? et si elle avait été porteuse de valises pour le FLN ? et si elle trimballait dans les poches de sa robe deux grenades défensives ? et si Amer et Colette étaient tombés amoureux l’un de l’autre ? Ils se seraient rencontrés chez le docteur Ducloux, rue de la Lancette. Non, plutôt dans une rue d’Alger. Ou dans un piano-bar, rue des Orteaux, à Paris.
La pièce s’ouvre sur un crépitement d’interrogations – et par un interrogatoire (Amer est passé à la question par des soldats français). Sur le mur noir du fond glissent, s’empilent, se trouent des couches de photos et films super 8 – Paris, Nanterre, Marseille et Alger. Toute une cartographie mentale (créée par le plasticien et comédien Guillaume Compiano) qui mêle la palissade, le bâtiment, le bidonville. Amer, dos au public, badigeonne ces images de peinture blanche, au rouleau, à la grosse broche, comme s’il voulait les fixer. Elles se fixent en effet, ou plutôt, elles s’éclairent, comme par un effet d’encre sympathique. Par quel prodige ? Le blanc fait ressortir l’image vidéo ; quelques points de luminosité en plus, depuis le projecteur, et le tour est joué : belle trouvaille de Pauline Guyonnet (création lumière).
Très vite, des propos de l’historien Benjamin Stora apportent un nécessaire éclairage : l’Algérie n’était pas une colonie comme le Maroc et la Tunisie, c’était « une terre de fantasmes » ; la Troisième République avait rêvé d’en faire une colonie de peuplement – en attribuant notamment cent mille hectares aux Alsaciens-Lorrains qui opteraient pour la nationalité française (encore quelques-uns que les Boches n’auraient pas) ; la déclaration de Mitterrand en 1954, « l’Algérie, c’est la France », vient de là. « Je n’avais rien compris de tout. Aucune conscience des enjeux, ni de leur échelle, ni du poids de cette histoire dans notre présent », commente Joséphine sur le plateau. On avoue une égale ignorance. Comme l’autrice, on n’a rien appris de tout ça au lycée.
Voici Joséphine à Marseille, en partance pour Alger, puis le village natal d’Amer. Le fil de l’enquête commence à se tresser à de nombreux autres fils, lieux, époques (de 1954 à 2014). « Dramaturgie du kaléisdoscope », disait l’autrice à propos de Data Mossoul. On ne s’y perd pas (ou juste ce qu’il faut pour rêver, flotter, remplir les blancs), car c’est finement et fermement tissé.
Après l’entracte, voici le contrechamp, le second volet, Colette B. Ici, plus d’affolement narratif, on est en pays connu. L’écriture se déploie sur de vastes plages lyriques. Serait-ce parce que Joséphine Serre a trouvé son personnage d’élection, une musicienne ? Ou que prend corps l’histoire d’un amour rêvé entre Colette et Amer ? Ou encore que le motif de l’enfance perdue, déplorée, circule d’un personnage à l’autre ? On entend des choses qui déplairont aux ricaneurs, comme : « Je vous aime à la place de l’Histoire, à la place de la vérité. » Ou bien : « Nous nous aimions depuis d’autres que toi, d’autres que moi. C’était nous déjà. » Joséphine Serre trouve une sorte de haute langue claire, sa langue de poète : « je suis seulement souveraine à ma vie, et que cela vienne de vous est aussi évident que l’eau de l’oued par laquelle vivent en bas les eucalyptus et les figuiers. » Aussitôt, parce qu’elle sait se tenir : « Pardon de parler en termes folkloriques. » [1]
Toujours l’équilibrisme. Dans Amer M., entre verbatim documentaire et canevas d’improvisation, rapport d’historien et poème homérique. Dans Colette B., entre lyrisme et humour bouffon, presque potache. Quand Amer s’enquiert de la sante de Colette, ça donne : « Vous avez un cancer ? – Non, pas avant trois semaines. – Voilà. Abdullah. Vous un cancer du colon ! ». Quand Colette essaye de joindre Amer : « Pour parler au Christ, faites le 1. À Madeleine, faites le 2. Pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, faites le 3. (…) Le secrétariat est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, sauf les dimanches. Vous pouvez laisser un message sur ce répondeur. Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez mourir. ». Quand Amer écrase une mouche, il en prononce l’éloge funèbre : « Morte pour la France » – « à moins qu’elle se tienne coïte », corrigerait Beckett.
Tout commencerait par une explosion et finirait par un concordat rigolard ? Mais non, ce serait absurde. L’humour (déjà foutraque dans Data Mossoul : « Il assure, Banipal ») est ce qui permet de faire passer le tragique. Joséphine Serre trouve le juste dosage, à la différence d’une Alexandra Badea, qui défriche les mêmes terres (les pans oubliés de l’Histoire de France) mais dont l’imperturbable sérieux plombe sérieusement (voir son triptyque Points de non-retour, présenté à La Colline en janvier). L’humour autorise aussi des flambées de vibrante colère politique. Colère d’Amer, personnage malgré lui : « Qu’est-ce que vous faites dans mon portefeuille ? Vous vous sentez légitimes ? Vous avez de la famille qui a participé à la guerre d’Algérie ? » Colère contre les capitalistes et colonialistes, ces « gens bien » qui « marchandisent tout », « étouffant toute opposition sous le masque du “terrorisme “, des “radicaux”, comme on agitait en d’autres temps la figure du rouge, comme on agitait autrefois la figure de l’Arabe ». Colère, tournée vers soi, de la pied-noire Colette : « Je ne pourrai racheter ma vie ni mon enfance passées là-bas. Ça ne sera jamais suffisant. Je ferai toujours partie du camp des oppresseurs, des occupants, des colons. » L’historien dira : c’est plus compliqué. Le psy : la haine de soi ne mène à rien de bon. Mais ces charges sont portées comme dans un seul souffle par l’excellente Camille Durand-Tovar.
Poilade, élégie, brûlot, tragédie et même… pastiche de théâtre sartrien (« je crois en la liberté de choisir à partir des contingences », assure Amer à un délégué FLN) – Joséphine Serre aboute des tons et des matériaux hétéroclites, avec un culot qui rappelle celui de sa complice Elisa Granat (qui jouait dans Data Mossoul) dans son King Lear Syndrom, au TGP. La comparaison s’arrête là. Elsa Granat est punk (« Putain, sire, venez-en au fait ! »). Il y a chez Joséphine Serre, malgré ses coups de poing et ses coups de gueule, une délicatesse qu’on entend dans une petite valse entêtante, To vals tou gamou, qui traverse Colette B. Cette valse, Eleni Karaindrou l’a composée pour le film L’Apiculteur, et oui, on peut penser à Angelopoulos en regardant ce piano qui s’éloigne en courbe très lente vers le fond du plateau. A Max Ophuls aussi, pour la ganse, la boucle et l’élégance – plateaux tournants et praticables mobiles.
Comme le fond n’est jamais loin de la forme, quand les passions s’apaisent un peu, on entend de la douceur et de la douleur mêlées, une fatigue. « On a passé une vie pour rien ». « Il se peut que j’aie passé toute une vie à disparaître ». Tchekhov ? Non, Amer.
JB Corteggiani





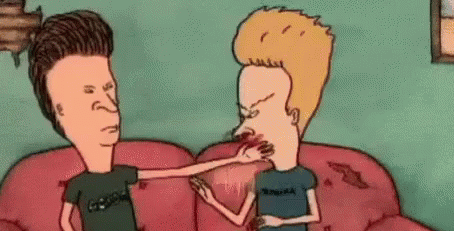




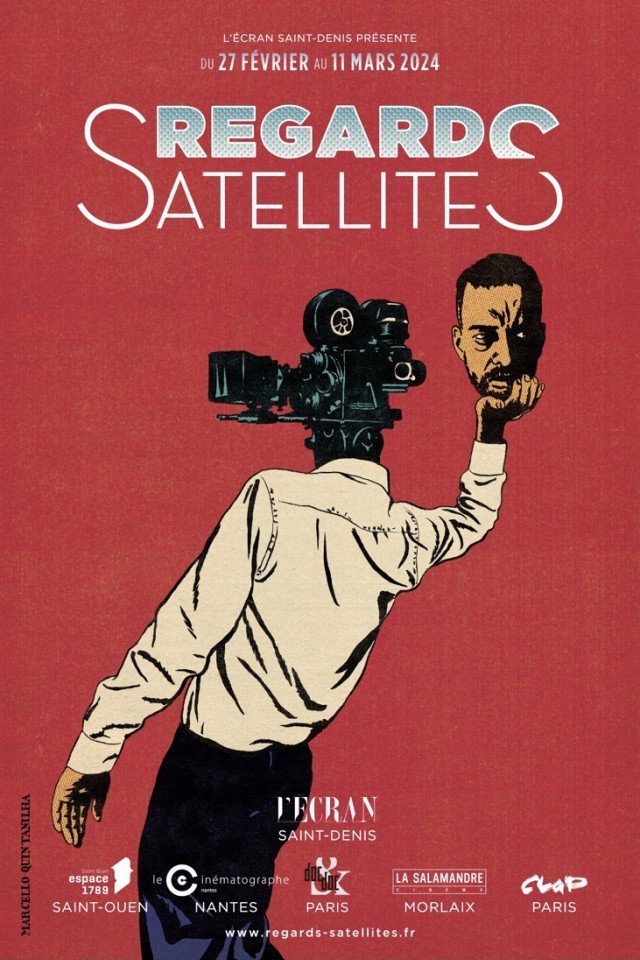


0 commentaires