J’ai l’insigne honneur de faire partie d’une confrérie secrète et néanmoins joyeuse (dont il est, bien évidemment, hors de question que je révèle le nom ici) qui a pour habitude, voire pour principe, de se réunir virtuellement un nombre assez peu calculable de fois quotidiennes afin de deviser en désordre de l’état footballistique des choses, qu’il pleuve, vente, que l’heure soit grave ou ordinaire, que l’Euro galvanise les foules ou que Lyon reçoive Guingamp.
Nous pleurons rarement, contrairement à Thiago Silva ; nous rions souvent, pas comme Manuel Neuer ; nous nous engueulons volontiers, chiffonniers tels qu’il y en eut jadis (et peut-être encore parfois ?) dans le vestiaire bipartite catalano-castillan abusivement rassemblé sous le nom d’“équipe d’Espagne” ; nous nous réconcilions sur le dos de Cristiano Ronaldo ou de Manuel Valls ; nous déplorons l’usage de telle tactique, ou de tel homme à la place de tel autre ; nous y composons des sélections toujours bien plus convaincantes que celles choisies par les entraîneurs attitrés ; nous y proposons des expérimentations formelles inouïes – par exemple une équipe exclusivement composée d’arrières gauche – ; nous y échangeons les souvenirs émus qui tissent nos nostalgies, surtout celles d’époques que nous n’avons pas connues ; nous y vérifions surtout, jour après jour, qu’il est un geste moral (comme on dit geste technique) qui fait partie du bagage indispensable du commentateur assidu, ou de l’amateur obtus, ou du supporter éclairé, appelez-le comme vous voudrez : je veux bien sûr parler de la mauvaise foi.
Mais l’homme (ou la femme, car il y a des consœurs dans notre confrérie) de bonne volonté peut parfois être pris entre deux feux de mauvaise foi – une sorte de double bind où la foi qui prime n’est plus la mauvaise mais la pire. Ainsi, quand, sur une passe du génial et grandissime Iniesta, que j’ai la chance de voir évoluer à peu près cinquante fois par saison puisque je regarde, tant que possible, tous les matchs du Barça (car pour ma part, plus que tout effet d’identification, de ceux qui créent les supporters, c’est le foot que j’apprécie, je veux dire le jeu ; et qui aime ce jeu mesure la chance qu’il a d’être le contemporain du chef-d’œuvre collectif qu’est le club de Barcelone depuis plus d’une dizaine d’années [1] : nous ne reverrons peut-être jamais cela, autant en profiter), quand, donc, sur une passe d’Iniesta à la 70ème minute, le petit meneur de jeu de la Roja, David Silva, s’étale de tout son long dans la surface croate, victime d’une poussette incertaine, ma réaction [2] est de me réjouir de cette décision arbitrale, pourtant, à l’évidence, particulièrement sévère. C’est un pénalty qui récompense la passe d’Iniesta, et plus largement l’existence d’Iniesta dans ce monde, et la mauvaise foi en moi refuse de voir que les défenseurs croates, qui font par ailleurs un excellent match, n’ont pas mérité ça.
Toutefois, quand Sergio Ramos, l’un des bouchers habituels du Real Madrid, un type à qui ma mauvaise foi barcelonophile supprimerait volontiers sa licence, ou l’enverrait jouer dans le championnat indien [3], se saisit du ballon et le pose sur le point de pénalty, alors la mauvaise foi remet un tour de vis, si je puis dire : soudain, la réparation obtenue par le Catalan devient le fruit d’une injustice flagrante, et le seul espoir qu’il reste pour que la morale soit sauve est que Ramos manque son tir au but. La pire foi en appelle alors à une justice immanente, qui veut que, puisque la faute était infime, voire absente, et en tout cas n’aurait jamais dû aboutir à une sanction aussi extrême (oui, la mauvaise foi est férue d’hyperboles), le score en reste inchangé. Ce qui, évidemment, se produit.
Ramos tire mal, en force mais à mi-hauteur, vaguement dans l’axe du but ; le poing ferme de Subasic fait obstacle au ballon, et rétablit le bon droit. D’où vient que, souvent, les pénaltys les plus litigieux, les plus généreusement accordés, sont aussi ceux que les tireurs ratent ou que les gardiens arrêtent – subtilité qui a son intérêt, car si certaines frappes sont objectivement manquées, molles, imprécises, voire pas cadrées du tout, d’autres sont tout à fait viables mais échouent par la faute (ou par la grâce, selon le camp dans lequel on se situe) d’un gardien de but inspiré ? La justice immanente existe. Dût-elle n’exister que dans le sport, et uniquement lors de rares épiphanies, elle existe. Je l’ai rencontrée. Je l’ai vue à l’œuvre : c’est elle qui a porté les mains de Ramos à ses tempes pour se prendre la tête, ornée d’ailleurs d’une coiffure ridicule, penaud, dépité, tel qu’en lui-même enfin la justice le fige.
Peut-être, ferai-je remarquer aux membres de ma confrérie secrète aussi bien qu’à l’aimable lecteur, que nous verrons bientôt surgir d’autres manifestations de cette justice immanente. Peut-être, par exemple, aimerait-on penser, qu’un joueur moqué, mal aimé, en partie injustement, lavera ces affronts répétés par un seul et ultime exploit, aussi décisif qu’inattendu. Peut-être, mettons, que Patrice Evra, en finale de l’Euro, crucifiera l’excellent Courtois, le gardien de but belge, ou de nouveau le Croate Subasic, d’un plat du pied à la 88ème minute. Mais la mauvaise foi a ses limites.
Mathieu Larnaudie
[1] Chance qui n’est pas sans présager quelques désarrois à venir, ainsi que l’a un jour très justement formulé, dans un de ces cris du cœur dont il est coutumier, l’ancien attaquant argentin de Toulouse Omar da Fonseca, commentateur pour la télévision franco-qatarie, et qui, après avoir fait un long éloge de Lionel Messi, prononça au fil de son commentaire, avec son formidable accent, le nom d’Iniesta, qu’il ne put qu’accompagner de cette question quasi métaphysique (et qui, soudain, faisait basculer son admiration enthousiaste dans une sorte de désespoir prospectif) : “Et lui aussi… Mais ces joueurs… Comment on va faire quand ils vont arrêter ?”
[2] Je précise que je n’ai rien contre la Croatie, bien au contraire, et que le milieu de terrain Modric-Rakitic est à mon humble avis à peu près ce qui se fait de mieux en Europe.
[3] Ou à la limite au Mexique avec Gignac, et qu’on n’en parle plus.
Mathieu Larnaudie est éditeur aux éditions Inculte, essayiste et l’auteur, notamment, de Strangulation (Gallimard, 2008), et aux éditions Actes Sud : Les Effondrés (2010), Acharnement (2012) et Notre désir est sans remède (2015).
[print_link]




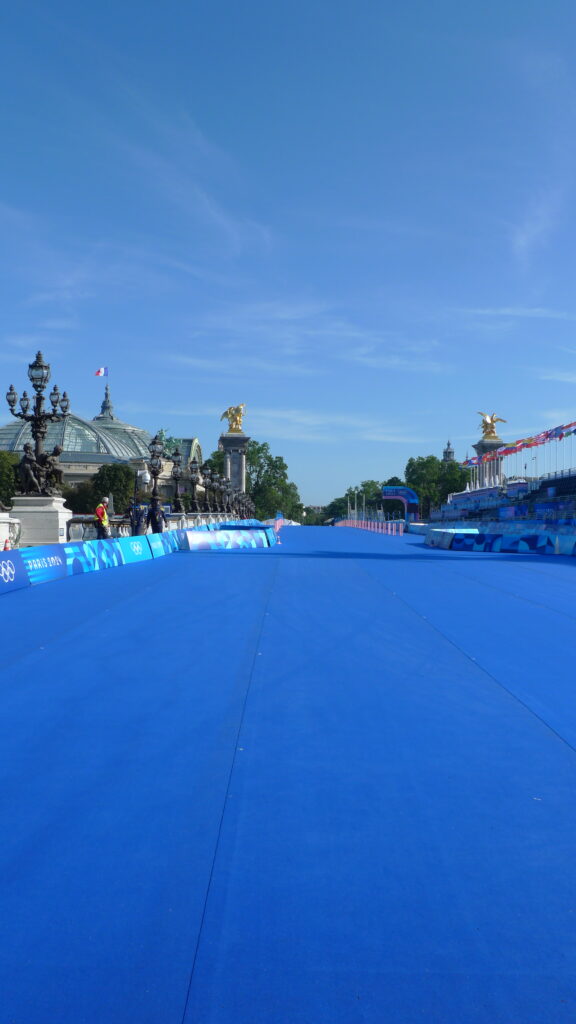
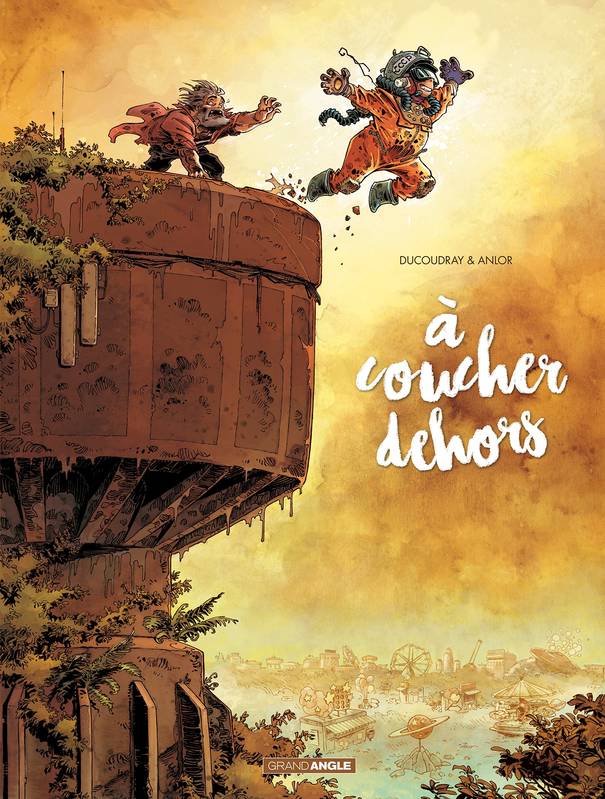



0 commentaires