Les femmes ont toujours lutté contre le patriarcat, contre les violences qui leur sont faites par des hommes dans leur vie quotidienne en raison de leur genre. Mais souvent à bas bruit, dans l’espace privé, souvent dans l’isolement avec un sentiment de culpabilité. Le mouvement international #MeToo a rendu visibles ces violences sexistes et sexuelles. Dépasser la peur, rejeter la honte, dénoncer ses agresseurs en puisant dans la parole collective la force de brandir son propre récit, constituent une avancée majeure. Pourtant en France, on compte encore à plus d’une centaine de féminicides chaque année, trois viols ont lieu toutes les heures, près de deux cent mille femmes sont victimes de crimes et délits sexistes tous les ans. Parmi la riche diversité des publications féministes, trois ouvrages parus récemment traitent d’une manière au d’une autre la question de l’auto-défense : Pour l’auto-défense féministe de Mathilde Blézat, Princesa de Fernanda Farias de Albuquerque et Maurizio Iannelli, Feu! Abécédaire des féminismes présents, opus collectif coordonné par Elsa Dorlin.
 « Les femmes se sont toujours défendues, seules ou en groupe, face aux hommes qui les violentaient », rappelle Mathilde Blézat, militante féministe, journaliste et autrice, membre notamment de la revue Z. Mais L’auto-défense féministe a une histoire fluctuante qui commence au début du XXe siècle parallèlement au suffragisme, s’éclipse, revient à partir des années 1970, se développe actuellement malgré le maigre soutien des pouvoirs publics. Pour l’auto-défense féministe montre l’intérêt de ces pratiques corporelles dans la prévention des violences fondées sur le genre.
« Les femmes se sont toujours défendues, seules ou en groupe, face aux hommes qui les violentaient », rappelle Mathilde Blézat, militante féministe, journaliste et autrice, membre notamment de la revue Z. Mais L’auto-défense féministe a une histoire fluctuante qui commence au début du XXe siècle parallèlement au suffragisme, s’éclipse, revient à partir des années 1970, se développe actuellement malgré le maigre soutien des pouvoirs publics. Pour l’auto-défense féministe montre l’intérêt de ces pratiques corporelles dans la prévention des violences fondées sur le genre.
À rebours de l’éducation genrée que toute femme reçoit, lui inculquant « la peur du viol » et « l’interdit absolu de la violence des femmes », les stages d’auto-défense féministe font découvrir à chacune que son corps est une arme, qu’il est possible de s’émanciper en changeant son rapport au corps. L’auto-défense féministe n’est pas de la self-defense : quand la défense personnelle se fonde sur des principes virilistes et des scenarios d’attaques imaginaires, l’auto-défense féministe part des situations réelles de violence vécues par les femmes agressées et prouve qu’il n’est pas obligatoire d’être jeune et en pleine santé pour utiliser efficacement les techniques de défense.
La parole partagée et l’écoute collective permettent de mettre au jour les mécanisme de domination invisibilisés par la société et la culture patriarcales. Se rendre apte à repérer et interpréter les situations c’est contrer le phénomène de sidération qui paralyse les victimes : « En mettant en évidence l’importance d’écouter ses alertes internes pour repérer ses limites et les poser le plus tôt possible, l’auto-défense féministe a pour objectif d’empêcher que des situations de violence ne s’installent et n’empirent. » Les enfants et les très jeunes filles sont particulièrement exposées aux violences sexuelles, il faut donc commencer tôt à pratiquer l’auto-défense féministe : la posture, le regard, le « cri de puissance », l’effet de surprise suffisent bien souvent à arrêter une situation d’agression. Les personnes handicapées, racisées, trans, aussi très ciblée, peuvent bénéficier de stages en non-mixité dont Mathilde Blézat nuance les avantages sur la mixité choisie.
Les témoignages recueillis par l’autrice indiquent que ces stages pourtant brefs (un ou deux week-end) ont des conséquences à long terme. Sortir de la culpabilité, se sentir puissante, rompre l’isolement, se reconstruire, diminuer les agressions et leurs impacts, autant d’apports positifs ressentis par les stagiaires qui pour certaines deviennent à leur tour animatrices. Angélique par exemple, en situation de handicap intellectuel, est formée par l’association Garance (Bruxelles) à donner des « ateliers-sécurité » au cours desquels les participantes échangent des stratégies de prévention : « On réfléchit ensemble à notre manière à nous de dire non. […] Ça m’a donné envie de prendre soin de moi fort, fort, et des ressources pour ne pas paniquer, pour ne plus me laisser faire. »
Mathilde Blézat expose la diversité des méthodes, compare des pratiques en France, au Québec, en Belgique, décrit la situation professionnelle trop souvent précaire des animatrices et donne des pistes pour que que l’auto-défense féministe se pérennise grâce au soutien des institutions notamment au niveau européen. Le livre se termine par une liste des associations d’autodéfense féministe et des ressources bibliographiques précieuses.
 La vie de Fernanda, née en 1963 dans le corps du garçon Fernando, est une vie de lutte. Brésilienne, d’une famille pauvre du Nordeste, elle fait partie des femmes transgenres venue sauver leur peau des violences policières et rêvant de fortune vite gagnée sur les trottoirs d’Europe dans les années 1980. Son surnom Princesa, est aussi le titre donné par Maurizio Iannelli au manuscrit autobiographique de Fernanda Farías de Albuquerque écrit à Rome, en détention. Première traduction en français d’un livre paru en italien il y a trente ans, Princesa est le récit fulgurant, traversé de violences surmontées avec honneur et fierté, d’une femme trans dont le corps et la ville sont les terrains des multiples combats qu’elle mène depuis l’enfance.
La vie de Fernanda, née en 1963 dans le corps du garçon Fernando, est une vie de lutte. Brésilienne, d’une famille pauvre du Nordeste, elle fait partie des femmes transgenres venue sauver leur peau des violences policières et rêvant de fortune vite gagnée sur les trottoirs d’Europe dans les années 1980. Son surnom Princesa, est aussi le titre donné par Maurizio Iannelli au manuscrit autobiographique de Fernanda Farías de Albuquerque écrit à Rome, en détention. Première traduction en français d’un livre paru en italien il y a trente ans, Princesa est le récit fulgurant, traversé de violences surmontées avec honneur et fierté, d’une femme trans dont le corps et la ville sont les terrains des multiples combats qu’elle mène depuis l’enfance.
Assignée par l’apparence et l’état civil à un genre qui n’est pas le sien, l’enfant comprend très jeune aux insultes et aux coups qu’elle reçoit que quelque chose ne convient pas aux autres dans sa certitude d’être une fille : « hommefemme, veado », lui crient les camarades de jeux dont certains se transforment sans scrupules en violeurs. Sa mère Cícera, qui élève seule ses enfants, veut faire de « son fils » un militaire, le menace de l’enfer sans rien pouvoir changer à l’évidence : « Deux demi-noix de coco furent mes premiers seins. Cícera me surprit devant le grand miroir et vlan, une raclée. » Commence dès sept ans une existence marquée par une violence continue que Fernanda expose sans une plainte, et par le besoin jamais vraiment comblé d’être reconnue et aimée par sa mère pour ce qu’elle est : sa fille. Déscolarisée, manipulée par les hommes pour qui le brouillage des genres vaut libre autorisation à utiliser le corps de Fernando pour satisfaire leur « vice », Fernanda quitte son village pour la ville où, habillée en étudiante, elle arpente les trottoirs le soir : « ça se voit, je suis un travesti. » Ce qui se voit, ce qui est caché, ce qu’il faut paraître malgré ce qu’on est, les faux-semblants et mensonges des sociétés bourgeoises hétéronormées, les hommes qui se servent des bichas brésiliennes avant de retrouver la petite famille, sont les tensions autour desquelles s’organise ou se désorganise la vie de Fernanda. Elle travaille sur son corps, douloureusement, pour le modeler au silicone sur celui d’une star mais toutes ces souffrances ne suffisent pas pour être acceptée. « Princesa, reste cachée. Ne te fais pas voir en cuisine par les clients. Cache-moi ces nichons, habille-toi correctement : il y a des gens qui déjeunent. Il y a le sida, les pédés et les transsexuels font peur », lui lance le patron du restaurant où elle cuisine et où elle a reçu son surnom. Début des années 1980 : les premiers morts du sida sont de jeunes hommes homosexuels.
Contrôlée et violentée par la police brésilienne qui tue les trans dans la rue, Fernanda décide de partir pour l’Europe, et son récit devient celui d’une migration. On plonge dans le milieu trans des quartiers de Milan et de Rome il y a quarante ans, entre protecteur-maris trop aimés, copaines de travail et de galères, disputes homériques, drogue, VIH, ruses pour échapper aux contrôles et à l’expulsion, vols et viols, ribambelle de clients pour qui Fernanda exprime parfois une sincère empathie. On est tenu tout au long par la franchise et la générosité des propos, l’absence de laideur malgré la laideur, par la beauté du regard sur une réalité terrible dans un contexte où la transidentité n’est pas acceptée. Un soir à Milan, les filles entendent soudain une rumeur : les habitants du quartier déboulent, exaspérés par le trafic nocturne des trans prostituées, la drogue, les seringues abandonnées : « J’eus peur mais je ne me sentis pas perdue. Ici, en Europe, on ne tue pas dans la rue. Mais ce soir-là, s’il y avait une confrontation, ça n’allait pas se résumer à des coups de poings et des coups de bâton. Les veados, quand ils sont acculés, ne sont pas des tendres. Ils viennent de loin, d’un corps d’homme et de villes immenses et affamées. Beaucoup savent se servir d’un couteau. »
Publiée sous une belle couverture de Carlos López Chirivella, cette version française de Princesa, soigneusement établie par une équipe de traductrices passionnées, est à la fois un plaisir et une claque. La langue de Fernanda Farías de Albuquerque, revisitée par le travail de Mauricio Ignelli se révèle superbe, brillante, foisonnante. L’autobiographie est complétée par des annexes qui racontent l’histoire étonnante de l’écriture du texte, une interview de Fernanda et des documents iconographiques démontrant, s’il le fallait, que la vie de l’autrice trans raconte bien plus qu’un trajet individuel, le destin d’une génération meurtrie.
 Ouvrage collectif coordonné par Elsa Dorlin, Feu ! Abécédaire des féminismes présents, se veut une « histoire populaire des féminismes ». Dans un contexte de « repolitisation inédite des violences, inégalités et discriminations sexistes, qui désormais sont publiquement, massivement nommées, dénoncées, comme relevant d’un système patriarcal contemporain », Feu ! rend compte de l’effervescence des féminismes de ces vingt dernières années.
Ouvrage collectif coordonné par Elsa Dorlin, Feu ! Abécédaire des féminismes présents, se veut une « histoire populaire des féminismes ». Dans un contexte de « repolitisation inédite des violences, inégalités et discriminations sexistes, qui désormais sont publiquement, massivement nommées, dénoncées, comme relevant d’un système patriarcal contemporain », Feu ! rend compte de l’effervescence des féminismes de ces vingt dernières années.
De « Abolitionnisme pénal » à « Zines féministes », ce sont soixante-trois textes engagés, écrits par des militantes ou des activistes se fondant sur leurs expériences de luttes. Les autrices disent « je », « nous » et ne se contentent pas d’établir des constats pertinents mais lancent des pistes enthousiasmantes pour l’avenir. ChacunE tracera ses chemins à travers la densité de cet abécédaire dont toutes les entrées sont une invite à la lecture. Pour moi, le premier trajet a commencé par « Cancer », puis « Feu ! », « Ménopausées », « Mères », « Mères solidaires », « Luttes romani, combats féministes ». De multiples autres parcours m’attendent dans un livre qui restera longtemps à portée de main, mais je voudrais ici revenir sur ces deux textes forts que sont « Mères » par Fatima Ouassak et « Mères solidaires » par Geneviève Bernanos.
Les mères, en tant que telles, « ne sont pas un sujet politique. Elles n’existent nulle part comme force politique structurée. » Fatima Ouassak écrit dans une langue que j’aime parce qu’elle bouscule, se sert de l’ironie pour dénoncer la réclusion du sujet « mère » à l’intérieur domestique et au corps sacrificiel : « Il ne s’agit évidemment pas de se sacrifier pour ses enfants en menant avec d’autres une lutte révolutionnaire. Le seul sacrifice qui est attendu des mères est celui qui va dans le sens du maintien de l’ordre. » C’est particulièrement ce qui est exigé des mères non-blanches, des mères des enfants des quartiers, des immigrées que stigmatise le discours raciste les accusant d’être laxiste et démissionnaire. En mettant au jour ce scandale : « les mères sont le parent pauvre du féminisme », Fatima Ouassak dévoile la présence de représentations patriarcales au sein même du féminisme blanc, bourgeois qui rejette la maternité pensée comme réactionnaire et en opposant le soin des enfants à l’analyse intellectuelle seule valorisée. Les bourgeoises blanches délèguent la garde de leurs enfants à d’autres femmes souvent racisées tandis que les mères des classes ouvrières occupées par leurs enfants se trouvent exclues des combats féministes. Leurs luttes sont invisibilisées, sauf quand elle se mobilisent sur des sujets légitimés par les dominantEs, contre l’islamisme par exemple.
Les mères luttent pour leurs enfants face aux inégalités, aux processus de relégation des enfants des quartiers vers des destins scolaires moins estimés et peu émancipateurs mais aussi face à la police et à la justice. Geneviève Bernanos, raconte le basculement de sa vie de mère quand ses deux fils sont interpellés et inculpés : « Jamais je n’aurais imaginé, qu’ayant inculqué à mes fils des valeurs de solidarité, de fraternité, de liberté d’expression, d’engagement dans les luttes de la société, ils puissent aller en prison pour leurs idées. » Il s’agit de constituer un collectif de mères qui se mobilisent pour et avec les enfants sur lesquelLEs s’abat la répression parce qu’iels s’engagent dans des luttes contre les fascismes, contre les écocides, dans la dénonciation des violences notamment policières et des injustices, pour l’accueil des personnes migrantes. « C’est ainsi que notre combat est de porter notre parole de mère, notre lumière sur la parole de nos filles et fils, trop souvent négligée, déformée ou caricaturée, criminalisée. » Cette lutte des mères inclut le combat anticarcéral. Puisque les femmes sont majoritaires aux parloirs des prisons, assument les conséquences financières, matérielles, affectives, psychiques, supportent la violence de l’enfermement des enfermés, elles « sont les premières à pouvoir construire des solidarités entre elles, pour gagner leur autonomie et leur émancipation en tant que femmes tant dans l’enceinte de la prison (…) que dans leur vie quotidienne du « dehors » ». Fatima Ouassak et Geneviève Bernanos montrent l’une comme l’autre que le « féminisme révolutionnaire » ne se construira pas sans les mères.
Juliette Keating
Pour l’autodéfense féministe, de Mathilde Blézat. Éditions de la dernière lettre (2022)
Princesa, de Fernanda Farias de Albuquerque et Maurizio Iannelli. Traduit de l’italien par Anna Proto Pisani, Armelle Girinon, Virginie Culoma-Sauva, Judith Obert, Simona Elena Bonelli. Éditions Héliotropisme (2021)
Feu ! Abécédaire des féminismes présents, coordonné par Elsa Dorlin. Éditions Libertalia (2021)








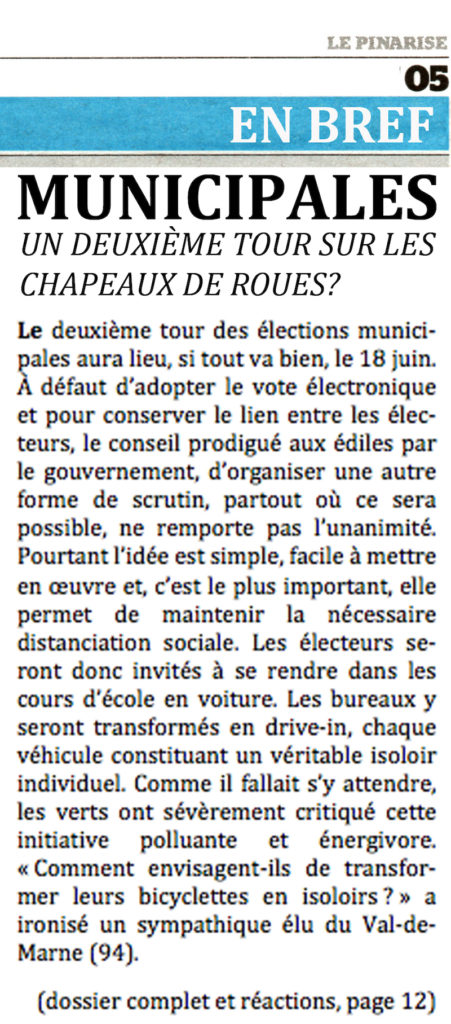
0 commentaires