“Footbologies” : les mythes et les représentations propres à un championnat de football analysés journée après journée de Ligue 1.
Alors qu’il suscite chaque jour des tombereaux de discours souvent redondants et vains, le football se prête mal au récit littéraire. D’excellents romans ont pris pour sujet le supportariat ou le hooliganisme (Carton jaune de Nick Hornby ou Football factory de John King), d’autres les biographies réelles ou fictives de joueurs ou d’entraîneurs (Rouge ou mort de David Peace –pourquoi tous ces auteurs sont-ils anglais ?), tandis que le monde interlope des agents et du dopage, des intérêts mafieux et de la corruption a fait les délices du roman noir : traitement périphérique où le football n’est que prétexte à des récits de vie exemplaires et des discours sociétaux. Mais si l’on met de côté la chronique sportive (dont Mario Vargas Llosa – pas le plus progressiste des prix Nobel de littérature, et qui vient de critiquer sévèrement celui attribué à Bob Dylan – a dit qu’il fallait la considérer comme un genre littéraire, ce pour quoi des Osvaldo Soriano et des Juan Villoro – pourquoi tous ces auteurs sont-ils latino-américains ? – ne l’avaient pas attendu…), le match en lui-même a rarement fait l’objet d’un traitement romanesque. Pourquoi un tel phénomène planétaire – et dont on a suggéré qu’il avait désormais plus de réalité dans le langage que sur les terrains– résiste-t-il ainsi au fait littéraire ?
Une première explication pourrait tenir à la nature non verbale du football : un match, ce sont quatre-vingt-dix minutes de discours minimaux et de pures sensations, sentiments, intuitions. Les mots de l’arbitre inaudibles dans le brouhaha, les consignes hurlées par l’entraîneur auxquelles personne ne prête attention, quelques cris plus éructés qu’articulés pour attirer la passe d’un coéquipier et une insulte ici ou là : pas de quoi construire des dialogues. Ce ne sont même pas vingt-deux monologues intérieurs qui cohabitent, au sens où le verbal – et donc le verbalisable – est la portion congrue dans l’esprit de qui joue : le temps d’un match, l’esprit se vide, rien n’existe que le ballon et son mouvement, le joueur est vierge, sans passé ni mémoire, pure intelligence spatiale, inspiration. Comment décrit-on un réflexe ? Le football – le sport en général – se joue en-deçà de la conscience, là où la littérature peine à faire ressentir et ne peut que décrire, gloser, développer dans le temps linéaire ce qui relève de l’immédiat : règne infini de la pause littéraire, le récit de match annule la spécificité instantanée de l’instinctif. En construisant un flux de pensée nourri par l’extérieur au match – les souvenirs des joueurs, leurs problèmes familiaux, tout ce qui structure habituellement un personnage – l’auteur passe à côté de la nature même de l’acte sportif isolé du réel : comme le ballon, le match se dégonfle si on l’ouvre pour voir à l’intérieur.
Alors, centrer le discours sur les faits ? Le récit de football serait-il nécessairement behaviouriste ? Soit, mais seule une ambition mimétique justifierait l’entreprise, un désir expérimental d’exhaustivité, une “tentative d’épuisement” à la Perec. Or, la tâche est herculéenne de décrire intégralement ce huis-clos à vingt-cinq personnages (en comptant les arbitres) : quatre-vingt-dix minutes de match, ce sont des milliers de mouvements et de gestes d’apparence anodins dont il n’est pas possible de dire (encore moins de prédire) lesquels sont importants. Effet papillon : un déplacement de quelques centimètres à un coin de terrain peut permettre un but à l’autre bout, plusieurs minutes plus tard. Un petit pas pour le joueur, un grand pas pour l’équipe. Toute sélection –malheureusement inévitable : le mimétisme est une illusion– pêcherait par arbitraire, nuirait à l’enchaînement des faits, échouerait à faire comprendre le pourquoi et le comment. Le récit de football est victime de l’illusion mimétique…
D’autant que l’attrait – autre qu’expérimental – de ces mouvements le plus souvent imperceptibles s’avèrera relatif pour le lecteur, hanté par la sensation que rien ne se passe. Comme Barbey d’Aurevilly le dit du bonheur, on ne décrit pas plus le football que la circulation du sang dans les veines, sauf en cas d’accident : une blessure, une bagarre, un but… À part ces exceptions, le récit de football sera nécessairement minimaliste, attentif à de petits riens dont seule l’accumulation fait l’intérêt, et auxquels seul le dénouement donne un sens. Il y a du roman policier dans le récit de football : ces sont les révélations finales du détective – le résultat du match – qui mettent au jour l’importance d’indices passés inaperçus aux yeux du lecteur, de petits détails qui s’avèrent finalement cruciaux. Petits effets, grandes conséquences. Ou parfois pas. Parfois, un match n’a pas de dénouement final. Ou ce dénouement est décevant. Un match nul et vierge. Alors, les mouvements et les gestes n’ont eu aucune importance, aucune conséquence. Une pure gratuité. Le roman est un roman sur rien. Et tel est finalement l’un des rares enjeux du récit de football : tout cela aura-t-il un sens ? Pas tant lequel : les bleus ou les verts, qu’importe ? Ce n’est là qu’un suspense de roman de gare. Mais le sens final ou l’absurdité, voilà un enjeu ! Le soupçon que tout cela pourrait ne servir à rien, la totale vacuité du littéraire, sans rien au bout : le récit du football ne peut être qu’un roman de l’attente.
Alors, après des journées comme celle-ci à l’orée de l’hiver, avec ses dix-huit petits buts, un seul match remporté par plus d’un but d’écart, un Marseille-Caen avec un seul tir cadré de tout le match, on se prend à se dire qu’en Ligue 1, le but est comme Godot, et que les rectangles des terrains ressemblent au désert des Tartares…
Sébastien Rutés
Footbologies
[print_link]




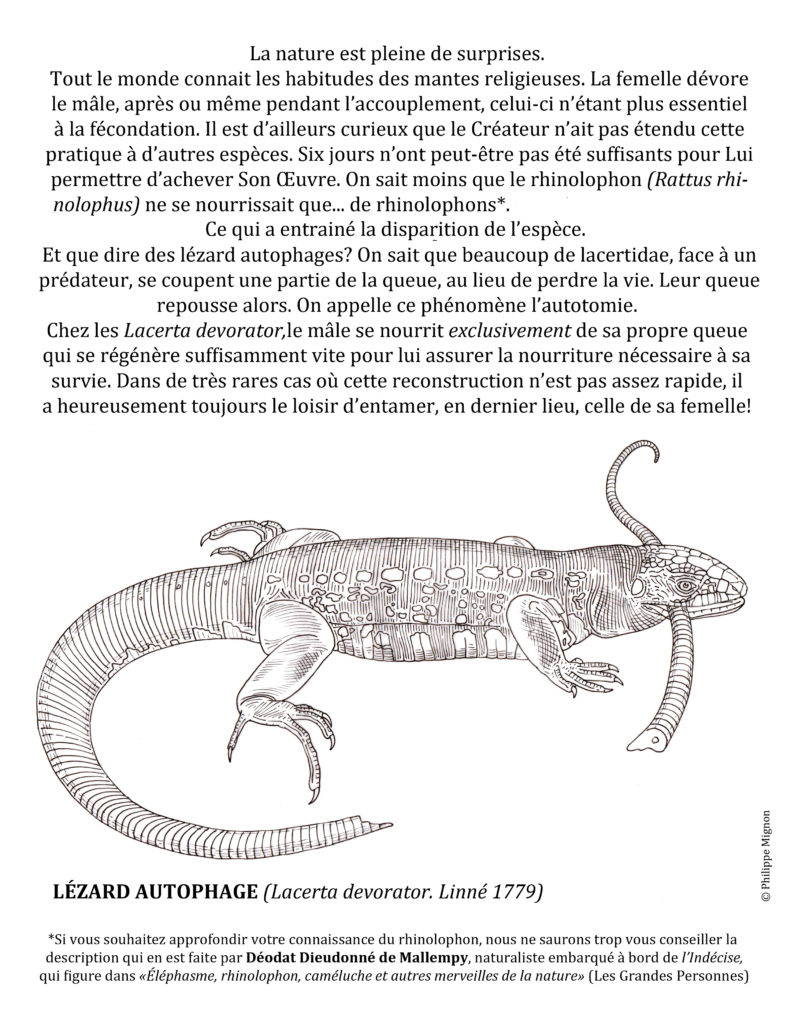


0 commentaires