Quelque chose là-haut : tous les quinze jours, un nouvel épisode d’une histoire simple et terrible. Il y a quelque chose là-haut qui m’obsède. Quelque chose dans le ciel, ou dans ma tête peut-être.
 Le personnel de l’ambassade de France au Ghana a été très accommodant, j’en profite pour le remercier ici. J’ai pu regagner mon petit studio de l’île de la Cité où je suis resté cloîtré deux jours, berçant mon hébétude par le ronronnement des péniches remontant la Seine ; il n’y a pas de musique plus reposante. Ensuite j’ai appelé le journal. J’ai prétendu avoir été gravement malade, hospitalisé dans le coma au Caire. Comme je n’avais plus de papiers sur moi, l’hôpital n’avait pu joindre personne. Voilà, je venais juste de rentrer et il me fallait encore quelques jours de repos avant de revenir à Libé. Vincent Giret s’est étonné de ce que je ne l’ai pas appelé plus tôt ; il m’a dit qu’ils avaient remué ciel et terre depuis trois semaines pour retrouver ma trace, qu’ils avaient fini par me croire mort. Enfin, il s’est inquiété de mon état de santé. Je suis resté vague.
Le personnel de l’ambassade de France au Ghana a été très accommodant, j’en profite pour le remercier ici. J’ai pu regagner mon petit studio de l’île de la Cité où je suis resté cloîtré deux jours, berçant mon hébétude par le ronronnement des péniches remontant la Seine ; il n’y a pas de musique plus reposante. Ensuite j’ai appelé le journal. J’ai prétendu avoir été gravement malade, hospitalisé dans le coma au Caire. Comme je n’avais plus de papiers sur moi, l’hôpital n’avait pu joindre personne. Voilà, je venais juste de rentrer et il me fallait encore quelques jours de repos avant de revenir à Libé. Vincent Giret s’est étonné de ce que je ne l’ai pas appelé plus tôt ; il m’a dit qu’ils avaient remué ciel et terre depuis trois semaines pour retrouver ma trace, qu’ils avaient fini par me croire mort. Enfin, il s’est inquiété de mon état de santé. Je suis resté vague.
Giret ne m’a pas cru, évidemment. Il a dû penser que j’avais eu la trouille en Libye, que j’avais décampé et qu’ensuite j’en avais eu honte. Ou bien que j’étais tombé amoureux d’une consœur croisée là-bas et que nous nous étions barrés pour une longue escapade en laissant derrière nous nos obligations professionnelles (le journal avait déjà connu un tel cas). Avec Giret, nous aurions cette explication plus tard.
Je n’ai pas dit un mot de ce qui m’était arrivé ces dernières semaines, ni au journal, ni à mes proches. Je m’en suis tenu à cette version du coma. C’était pratique, quoique incertain. Il m’a fallu trouver sur Internet le nom d’un hôpital cairote plausible, m’inventer une maladie (crise aiguë de paludisme) et peaufiner quelques détails plus ou moins crédibles pour enrober le tout. Je me suis rendu compte à cette occasion à quel point je manquais d’imagination.
À Takoradi, Ilona et moi avions été recueillis par une famille de pêcheurs extrêmement amicale. Quand ils nous avaient aperçus sur la plage en piteux état, hébétés près de l’annexe échouée, ils étaient venus spontanément nous proposer leur aide. Ils avaient soigné les plaies d’Ilona avec des feuilles d’eucalyptus. Elle qui semblait si impassible jusque-là, parfois même indifférente, avait brutalement sombré dans la dépression.
Moi, au contraire, je commençais à souffler et même à échafauder des plans pour le retour, me demandant quel genre d’histoire j’allais bien pouvoir raconter. Nous avions tué trois hommes, c’était un fait. Nous avions fait disparaître les traces de notre crime, c’en était un autre. Mais seuls Ilona et moi connaissions ces faits, alors … Quoique : à Rolas, Ilona et la bande de tarés n’avaient-ils pas croisé d’autres gens, en dehors de ces photographes gallois qui resteraient éternellement muets ? D’autres personnes avaient-ils été au courant de leur présence sur l’îlot, de leur … entreprise ? Ma compagne de mésaventure n’en savait rien. De toute façon, elle n’avait rien à voir là-dedans ; elle travaillait pour une ONG humanitaire au Nigeria et un soir, Mark l’avait draguée dans un bar de Port Harcourt. Il avait beaucoup de charme, elle s’était laissée embobiner. Les autres avaient grogné quand il avait voulu embarquer sa conquête sur le bateau, mais Myers avait décrété qu’un peu de compagnie féminine ne leur ferait pas de mal. Ilona avait suivi Mark aveuglément. À Rolas, elle avait bien sûr songé à fuir dès la première « expérience », mais elle avait vu tant d’atrocités au Nigeria qu’elle était comme anesthésiée. Le sang qui était versé, c’était toujours celui des autres ; il suffisait de débrancher ses neurones pour passer à travers tout ça.
Et voici qu’à Takoradi elle se réveillait lentement de cette anesthésie, qu’elle se rendait compte qu’elle aurait pu y rester, que d’autres y étaient restés et qu’elle n’était pas étrangère à cet état de fait. Elle voulait sauver des vies, pas en supprimer. Je pense qu’elle serait allée se foutre à l’eau si la mama ghanéenne qui veillait sur elle ne lui avait pas tenu la main en lui chantonnant des ritournelles en anglais et en twi (un dialecte local dans lequel bienvenue se dit akwaaba).
Au bout d’une semaine, nous nous sommes enfin décidés à rejoindre Accra pour prendre contact avec nos ambassades respectives. Ce n’est qu’à l’aéroport, au moment de nous séparer, que nous avons décidé de la conduite à suivre. Nous nous sommes jurés mutuellement de ne parler à personne de ce qui nous était arrivé et de ce que nous avions fait. À personne, jamais.
Juste avant qu’elle ne parte vers sa porte d’embarquement, je lui ai demandé sous le coup d’une impulsion idiote ce que pouvait bien être cette histoire drôle qu’elle avait commencé à raconter à Myers le premier jour où nous nous étions vus, celle dont les premiers mots avaient rendu ce dernier si furieux. Elle m’a regardé avec des yeux ronds. « Quoi ? ». Oui, celle du fou qui …, tu sais. Elle a ramassé son sac, haussé les épaules. « Eh bien, si tu veux vraiment savoir, c’est l’histoire d’un fou qui trouve une échelle et qui … ». Ça va, je la connais, l’ai-je aussitôt interrompu. Je comprenais mieux. C’est un fou qui trouve une échelle, la place contre le mur de l’asile, y grimpe pour regarder à l’extérieur et, apercevant un quidam à l’extérieur, lui lance : « Vous êtes nombreux là-dedans ? ».
Nous nous sommes jurés de ne jamais rien dire à personne, et pourtant je trahis ici ce serment. Je le fais parce que je suis sûr que personne ne me croira, je l’ai déjà dit. Mais je le fais aussi parce qu’à mon retour je n’étais pas au bout de mes surprises, et que ce que j’ai appris depuis lors m’incite à laisser un témoignage qui, tout extravagant qu’il soit, pourrait se révéler utile si, un jour que je souhaite lointain, tout cela devenait soudainement moins incroyable. C’est-à-dire totalement stupéfiant.
Deux gros mois après mon retour à Paris, j’ai reçu au journal un colis enveloppé de papier kraft hâtivement ficelé. Il avait été déposé à l’accueil par une personne que personne n’avait vue. Rachid m’a dit qu’il était au téléphone et que, lorsqu’il s’était retourné, le colis était là, posé sur le comptoir. Il contenait un livre ainsi qu’une grosse liasse de feuillets en anglais. Avant d’en révéler le contenu, je tiens à affirmer ici que moi, Édouard Launet, né le 13 juillet 1957 à Beauvais, suis parfaitement sain d’esprit. Je ne jure pas de dire toute la vérité et rien que la vérité, car où est la vérité là-dedans, mais je jure de dire tout ce que je sais, aussi objectivement qu’une carte de presse le commande.
J’ai sursauté en lisant le premier document. Il était signé de John Myers. C’était une longue note adressée à Mazlan Binti Othman, directrice du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies, à Vienne. Elle était datée du 9 septembre 2010 et son intitulé exact était : Legal and technical issues surrounding space debris and unknown objects. Il s’agissait d’une étude de cas courant sur plus d’une soixantaine de pages. Le problème des déchets spatiaux susceptibles de polluer les orbites commerciales (étages de lanceurs, satellites en fin de vie, fragments divers résultant d’explosion ou de collisions) était assez vite expédié. Plus détaillé était le chapitre concernant une éventuelle découverte d’un objet inconnu en orbite. Inconnu c’est-à-dire non attribuable à quelque pays que ce soit. La probabilité était mince : il y a suffisamment de télescopes et de radars en veille permanente autour du globe pour que les vigies militaires et civiles de l’espace sachent exactement qui procède à des lancements de satellites, et quand, et où — déterminer la fonction de ces engins est parfois plus ardu.
Deux cas étaient approfondis. Le premier, c’était la capture d’un astéroïde par l’orbite terrestre. Guère probable non plus, quoique la Nasa a pensé sérieusement à investir 100 millions de dollars dans une mission consistant à aller chercher un astéroïde dans l’espace pour le mettre en orbite autour de la Lune afin de l’étudier de près. Pourquoi pas autour de la Terre, dans le fond. Le second cas faisait basculer Myers dans la science-fiction, avec à peine moins de talent que le regretté John Brunner. Il s’agissait d’imaginer quelles mesures devraient être prises si un objet totalement inconnu venait se mettre en orbite autour de notre planète, qui ne soit ni un astéroïde ni quelque satellite militaire furtif qui aurait échappé jusque-là à la surveillance. En d’autres termes, simples mais difficiles à concevoir, un objet de provenance … extraterrestre. Myers allait bien au-delà de son rôle de juriste, explorant de multiples pistes : mission d’observation et d’étude de l’engin avec une navette ou en déviant un satellite, expulsion de l’intrus vers une orbite cimetière, récupération et retour sur terre (quoique le terme de retour soit ici impropre), voire destruction pure et simple. L’auteur s’essayait ensuite à analyser les implications juridiques de chacune de ces options, avec l’humour que commandait ce genre d’hypothèses. Quel droit s’appliquait aux êtres et choses venus d’ailleurs ? Quelle était l’autorité compétente ? J’ai en tout cas appris que le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies travaillait activement à la mise au point de protocoles de communication au cas où un contact s’établirait avec une civilisation extraterrestre, le plus probablement par voie hertzienne.
Le deuxième document était le rapport annuel 2009 du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. Y avait été surligné en jaune un long passage d’un chapitre consacré à, je cite, « la réponse internationale aux risques d’impact d’objets géocroiseurs qui nécessiterait une approche et un processus décisionnel multidimensionnels et multidisciplinaires, englobant notamment des aspects techniques, juridiques, humanitaires et institutionnels ». Un objet géocroiseur, c’est un objet (astéroïde ou autre) qui vient se balader du côté de la terre. La « réponse internationale » se déclinait en tirs de missiles et en messages divers, dont aucun ne semblait destiné aux populations menacées.
Le troisième et dernier document était plus court et couvert de tampons indiquant sans ambiguïté un niveau extrêmement élevé de confidentialité. Il émanait d’une certaine Nina M. Armagno, major général directrice des programmes spatiaux dans une administration de Washington à l’intitulé fort curieux (quelque chose comme Études prospectives touchant à la sécurité nationale dans un contexte de crise). J’ai plus ou moins deviné la nature de ce texte avant même de le lire. Armagno y faisait la synthèse d’un rapport transmis par un observatoire militaire de Mauna Kea, à Hawaï ; un nouveau télescope conçu pour la surveillance de l’espace lointain venait, lors de ses premiers essais, de détecter de manière fortuite un objet inconnu d’environ quatre cent mètres de long et de forme grossièrement cylindrique. Il dérivait sur une trajectoire très proche de l’orbite géostationnaire, si bien que les risques de collision avec les autres satellites étaient élevés. Les radars qui avaient été aussitôt pointés dans sa direction n’avaient recueilli qu’un très faible écho, en tout cas bien inférieur à ce qu’il aurait dû être vu la taille de l’objet. Le rapport incluait les données qui permettaient de déterminer sa position à chaque instant. Je n’ai pas été surpris de constater, au terme d’un rapide calcul, que cet objet était à la verticale de Null Island le 13 mai 2011.
Le livre, enfin, était Rendez-vous avec Rama, le roman d’Arthur C. Clarke. Je l’avais lu bien des années auparavant. Et c’était dans ce colis un élément totalement superflu : il n’était plus nécessaire de me mettre les points sur les i.
Édouard Launet
Quelque chose là-haut





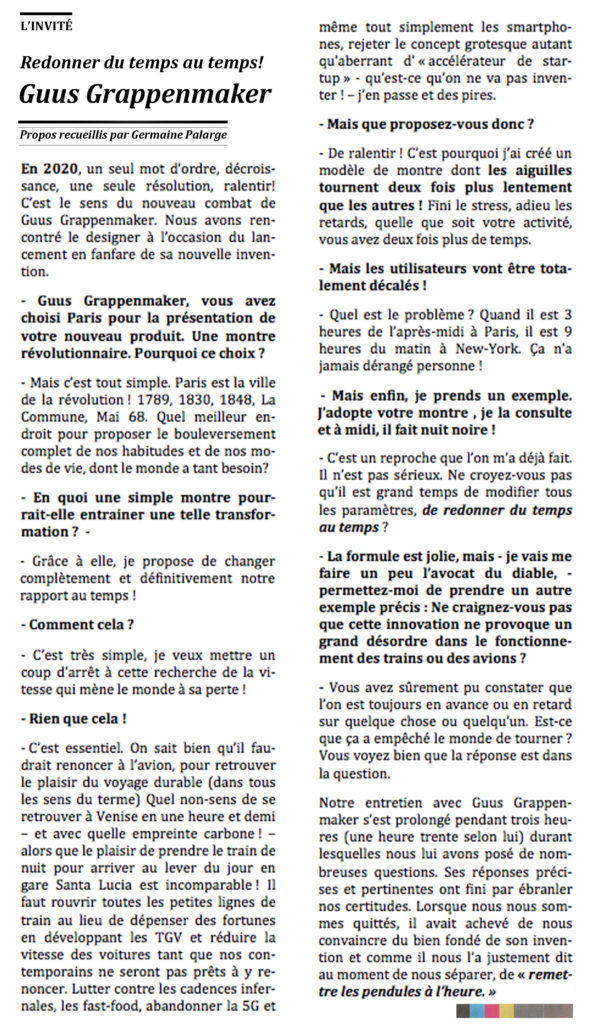



0 commentaires