Elle va mourir, Galia Libertad, mais elle tient à mettre les choses au point : « Vous pourrez être tristes si vous voulez, mais après, pas avant. Je compte sur vous pour ne pas gâcher mes derniers moments. » Et puis elle rit fort, tire sur son cigarillo et dit : « Je les emmerde ».
En attendant, elle (Monique Brun) trône au milieu de la scène, massive, assise dans un lourd fauteuil, sous une branche d’arbre imposante mais qui semble flotter.
Et voici qu’ils arrivent, les enfants et petits-enfants, dans un joyeux bazar. Deuxième génération : Serge, de droite mais sympa quand même, Anisse l’atrabilaire, « né en fronçant les sourcils », Stéphane (« pas Stéphanie ») qui balance à tour de bras des citations féministes (Hubertine Auclert, Engels, Duras) et dit : « Les femmes meurent de ce qu’on leur vole leur vie ». Troisième génération : Pauline l’étudiante en ethnologie qui travaille à son mémoire « Performer la femme sauvage, entre chienne et louve », Léa, médecin, qui la ramène moins, et son copain Arthur, serveur dans un bar à Marseille, qui apporte un peu de légèreté : « Tes amygdales vont faire des castagnettes au fond de ton calbute, mon pote » (à propos d’un cocktail de sa spécialité, le Massilia Mafia).
Sur ces bases, on ne s’attend pas à un remake théâtral d’un film de Claude Sautet. Il y a bien des retrouvailles familiales à la campagne mais dans un film de Sautet, Romy Schneider proposerait aux hommes, avec un charmant sourire, de leur préparer du café, et Yves Montand engagerait une course-poursuite sur une départementale pour claquer le beignet au mâle rival qui a eu le front de le dépasser. Ici, un demi-siècle plus tard, les hommes sont plutôt féministes, mais pas assez pour les femmes – on y reviendra.
Un siècle ne lorgne pas non plus du côté de Festen, le film de Thomas Vinterberg : pas de révélation fracassante, pas de règlement de comptes sanglant. Un secret de famille est dévoilé, cependant : le père d’Anisse-le-bougon, Djibril, n’a pas été jeté dans la Seine en octobre 1961, il est reparti dans son village pour s’y marier, à la fin de son contrat chez Dunlop.
Nous y voici plongés, dans l’Histoire, l’histoire d’un siècle. Un siècle à Montluçon, où Carole Thibaut, autrice et metteur en scène de cette pièce, dirige depuis 2016 le théâtre des Ilets. Cette histoire, les personnages la déroulent en polyphonie : la révolution industrielle tardive de la fin du 19e siècle qui bouleverse un Bourbonnais rural et endormi, les vagues d’immigration massive (Portugais, Italiens, Polonais, Algériens…), l’installation de Dunlop puis des fabriques de textiles, leur fermeture à partir de la fin des années 1970, les occupations d’usines et leur échec, quelques mois après l’installation au pouvoir de la gauche mitterrandienne…
Moins que l’Histoire, le sujet d’Un siècle est la manière dont l’Histoire traverse des personnages, et ce qu’elle leur fait. À Galia Libertad, par exemple, fille d’un anarchiste espagnol et d’une juive polonaise réfugiés en France et assassinés pendant la seconde guerre mondiale. Qui travaillera à l’usine, quoi d’autre, mais refusera de partager le sort de ses copines « écrasées par les naissances, par le mari, par l’esclavage domestique, par l’humiliation d’une vie de bonniche et de pute, le plus souvent à la merci d’un type violent ». Parce qu’elle a « choisi de rester vivante » et a « toujours eu un putain d’instinct de vie » (quand on demande à Carole Thibaut si elle a beaucoup mis d’elle dans le personnage de Galia, elle répond : « Putain oui ! »).
Au mitan de la pièce, Léa et Pauline (troisième génération) passent dans les rangs pour offrir aux spectateurs saint-pourçain et pompe aux grattons. Ce brechtisme-là ne mange pas de pain. L’originalité de la pièce est ailleurs, dans un art consommé des variations d’éclairage sur les personnages (incarnés par une excellente distribution). On pouvait craindre, avec les premières citations lancées par Stéphane-pas-Stéphanie (« Que vous plaignez-vous des classes dirigeantes puisque vous vous comportez à l’égard des femmes exactement comme les classes dirigeantes ? »), suivies par les grognements de Pauline la chienne-louve (« Tu es le type-même de l’homme blanc hétérosexuel occidental de plus de 50 ans de classe sup’ »), un brûlot féministe à coup d’éléments de langage militants. Mais non. Chaque personnage a ses raisons, qui valent bien celles de l’autre. Anisse rembarre Pauline : « Je suis désolé, je n’ai pas ta finesse. Je n’ai pas été à l’université. À ton âge moi je bossais depuis des années en cuisine. Alors tes petites leçons de morale, tu peux te les garder. » Pauline coiffe Serge sur le poteau : « J’aime les cérémonies. L’odeur des bougies, de la pierre froide. Les bancs. Les livres de messe. Les chants […] C’est rassurant. Cela donne l’impression qu’on peut encore être ensemble. – Il y a les manifs pour ça. »
On n’avait pas encore dit que dans cette pièce, les personnages passent leur temps à parler de politique – et c’est souvent drôle. Heureusement, il y aussi de la place pour l’aparté, la confession, l’échange intime. Il y a, en particulier, un bouleversant dialogue chuchoté entre Galia et Pierre. Ils sont dans la pénombre et cherchent à tâtons le souvenir d’un poème de Verlaine. Galia avoue qu’elle perd la mémoire. Alors Pierre : « Je me souviendrai pour deux ». Le poème revient par lambeaux : «Dans le vieux parc solitaire et glacé / Deux formes ont tout à l’heure passé […] / – Te souvient-il de notre extase ancienne ? / – Pourquoi voulez-vous donc qu’il m’en souvienne ? / […] – Ah ! les beaux jours de bonheur indicible / Où nous joignions nos bouches ! – C’est possible. »
JB Corteggiani







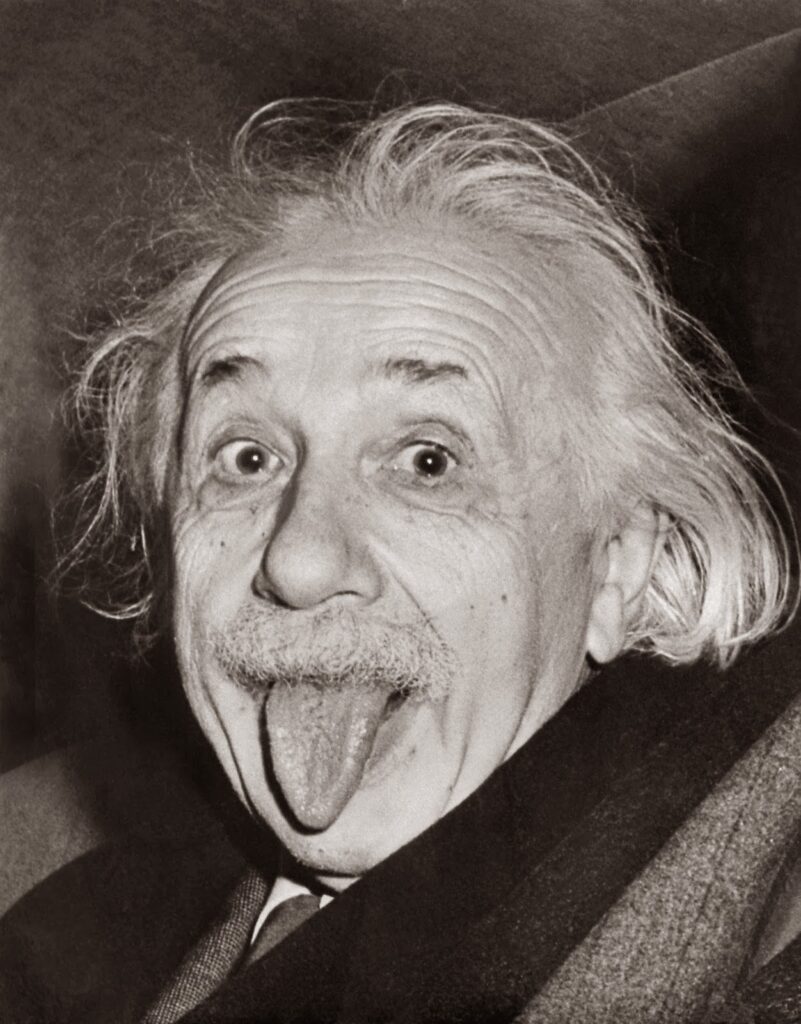



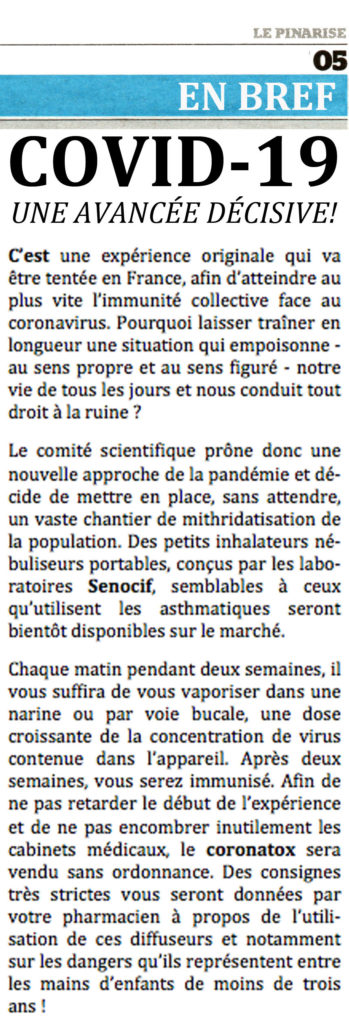
0 commentaires