Dans son dernier roman intitulé Pas de littérature! (Gallimard, La Noire, 2022), Sébastien Rutés met en scène un certain Grégoire Centon, traducteur pour la Série Noire, qui se retrouve embarqué dans une aventure digne des personnages dont il traduit (ou co-traduit, ou retraduit, allez savoir) les tribulations. Il livre ici quelques notes sur la traduction telle qu’il l’a envisagée dans son roman.
.
Dans Portrait du traducteur en escroc de Bernard Hœpffner, l’alter-ego de l’auteur, après avoir enchaîné les métiers les plus divers, finit par adopter « une des rares professions encore ouvertes à n’importe qui, la traduction ». Qu’on soit d’accord ou pas, la phrase fait écho à Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui fait dire à Pierre Gringoire : « Voyant que je n’étais bon à rien, je me fis de mon plein gré poète ». Le traducteur, poète moderne ? Pas pour la meilleure des raisons…
 Je n’ai lu l’essai du traducteur touche-à-tout de Gilbert Sorrentino ou Mark Twain que des mois après la parution de Pas de littérature ! mais force est de constater de Gringoire Centon, mon héros, a tout de l’escroc. Escroc au début du roman parce qu’il usurpe le titre de traducteur en laissant sa femme faire le travail à sa place ; escroc à la fin car devenu authentiquement traducteur, conscient de son statut de passeur clandestin.
Je n’ai lu l’essai du traducteur touche-à-tout de Gilbert Sorrentino ou Mark Twain que des mois après la parution de Pas de littérature ! mais force est de constater de Gringoire Centon, mon héros, a tout de l’escroc. Escroc au début du roman parce qu’il usurpe le titre de traducteur en laissant sa femme faire le travail à sa place ; escroc à la fin car devenu authentiquement traducteur, conscient de son statut de passeur clandestin.
Entre les deux ? La prise de conscience de l’impermanence du monde et qu’il n’est d’autre moyen de survie que l’adaptation : pas seulement des textes mais de soi-même, ce qui n’est peut-être qu’une seule et même chose (après tout, qu’est-ce que l’évolution des espèces sinon une adaptation au goût du jour, une retraduction ?).
La Seconde guerre mondiale a mis le monde en mouvement. Avril 1950, le début du roman, marque le premier anniversaire de l’OTAN, le deuxième du plan Marshall. L’ONU a cinq ans et besoin d’interprètes. Le monde se polarise, la guerre froide s’installe : bienvenue dans l’ère de l’homo traductor (homo traductans ?). Pour le dire avec des accents modernes : désormais, dans un monde multiculturel et interconnecté, nous serons tous des traducteurs.
Homme du passé, Gringoire Centon n’en sait rien. Il croit à l’immuable comme on croit encore au Père Noël. Il croit aux valeurs, il croit à l’absolu, il cherche l’original sous les copies. C’est un classique. Il croit aux identités individuelles et collectives et qu’on est ce qu’on est une bonne fois pour toute. Il n’a pas encore pris conscience de sa condition de centon.
Basses œuvres
Les traductions sont les basses œuvres de la littérature auxquelles cet auteur dans l’âme sacrifie en se bouchant le nez. C’est pourquoi il ne trouve rien à redire aux bidouillages que lui impose la politique éditoriale de la Série Noire (la fameuse « méthode Duhamel » : pas de littérature, pas de psychologie, de l’action, rien que de l’action) : l’escroc qu’il est –il parle mal l’anglais, fait traduire sa femme et se contente de transposer le résultat dans un argot qu’il apprend au jour le jour dans des cafés malfamés– s’accommode parfaitement de pratiquer la traduction comme une escroquerie. Qui a dit : « Je fais un sale métier mais j’ai une excuse, je le fais salement » ?
Il ne sait pas encore que les truands aussi ont un code de l’honneur et que même l’arnaque a ses virtuoses.
Pierre Gringoire, le poète de Notre-Dame de Paris qui rejoint les tire-laine et les faux mendiants de la cour des miracles, l’avait compris, et ce n’est pas pour rien que mon héros est prénommé d’après lui et que mon roman s’ouvre sur cet épigraphe hugolien : « Je ne vois pas pourquoi les poètes ne sont pas rangés parmi les truands ». Gringoire doit à ce précurseur la prémonition de son être transitoire, de son moi-entre-deux.
A coup de bombes, la guerre a fait tomber les murs qu’on avait mis des siècles à bâtir entre les choses et tout peut se découvrir en tout à qui a l’œil exercé à ces métissages. Cette vérité, c’est le Sachem, le truand lettré qui la dévoile à Gringoire Centon. Le Sachem est une porte entre deux mondes : la pègre et le monde des lettres. Lorsqu’il disserte sur la littérature dans son parler de voyou, il est authentiquement interprète et ses métaphores pégriotes tendent des ponts entre des rives opposées :
Le titre de traducteur taille petit, dans votre cas. Il faudrait inventer autre chose. Vous êtes le maquilleur d’autos de l’édition ! Et pas le genre à se contenter de changer les plaques. Tout au chalumeau et au pistolet à peinture !
Il faut du temps à Gringoire pour comprendre qu’il s’agit d’un compliment et que le Sachem adoube le projet de la Série Noire comme on évoque le casse du siècle.
La littérature à l’œuvre
Car là où Gringoire ne voit que des « non adequate type translation », comme disent les Américains, de modernes belles infidèles qui l’émeuvent d’autant moins qu’il ne prise pas ce qu’il traduit –du papier journal suffit à emballer les bas morceaux, dirait son boucher–, le Sachem voit un projet d’envergure dont les traducteurs sont les outils inconscients : il voit la littérature à l’œuvre.
A la question que poserait Michel Lebrun des années plus tard : « La Série Noire aurait-elle connu autant de succès si les traducteurs s’étaient montrés fidèles au texte d’origine ? », il répond évidemment par la négative. « La fidélité, c’est pour les caves. La littérature pratique l’amour libre ! »
Lui qui a vécu toutes les vies dans les mondes incertains de la clandestinité en a tiré deux conclusions : que l’essence de la réalité est le changement et que rien n’est plus à même de donner cette vérité à voir que la littérature, par nature multiple, dialogique et intertextuelle. La polysémie du texte épouse la mutabilité du monde et tous ceux qui participent au flux sont dans le vrai, qu’ils soient traducteurs ou truands. La littérature, c’est comme l’argent : faut que ça circule !
C’est alors que Gringoire prend conscience de ce qu’est la Série Noire de l’époque, à l’insu de tous : un admirable projet de littérature collective auquel participent aussi bien les auteurs américains que l’éditeur qui censure, les traducteurs qui transcrivent dans un argot que personne ne parle et les lecteurs qui commandent qu’on adapte les textes à leur goût. Sans parler des auteurs anglais qui jouent les Américains, des français qui prennent des pseudonymes anglo-saxons, de ceux qui se font passer pour le traducteur, de Boris Vian qui rédige un faux original pour sa prétendue traduction afin d’échapper à la justice : le palais des glaces, un labyrinthe, un jeu de miroirs où rien n’est stable. Par excellence, l’essence mystificatrice de la littérature.
Et le traducteur ? Il n’a pas le fil d’Ariane, personne ne l’a. Il est le minotaure ambivalent qui vit au cœur du labyrinthe et en est lui-même prisonnier. Sans cesse, il arpente les couloirs qui semblent se répéter à l’infini en quête de portes qui donnent toujours sur d’autres portes. C’est sa malédiction et c’est son honneur.
Le monde est en constant mouvement, le traducteur l’accompagne et le facilite. Il en est pour dresser des barrages illusoires et tenter de retenir l’eau entre leurs doigts : le traducteur est le mieux placé pour savoir qu’on ne se baigne jamais dans le même fleuve et, avec Steiner, qu’une langue « représente le modèle le plus juste du principe d’Héraclite ». Alors plusieurs langues…
Orgueilleusement escroc
Voilà comment Gringoire finit par se sentir orgueilleusement escroc : non plus petit arnaqueur à la traduction frelatée mais contrebandier de la littérature dans le grand réseau international qui fait passer clandestinement les frontières aux mots. Dans une direction, il trafique de la langue source dans la langue cible ; au retour, il ramène de la culture de réception vers les textes originaux. Parfois, il fait la mule : aucune idée de ce qu’il transporte, on verra bien à l’arrivée…
Ainsi, comme le voyou, le traducteur accepte de vivre dans un monde sans certitudes, un monde interlope où rien n’est ce qu’il paraît et où il faut se méfier de tout : des gens et des mots, qui avancent masqués. Depuis la rue obscure où rodent l’implicite, la connotation et l’usage, il observe par la fenêtre l’explicite, la dénotation et la règle dans leur confort bourgeois et ne les envie pas. Il abandonne la sécurité des états de fait et des équivalences pour l’équivoque et le double sens, parce qu’il a compris que telle est l’essence des choses et, en tout cas, la grande aventure du sens.
Escroc, maquilleur d’autos, contrebandier, cambrioleur : le traducteur ouvre ce qu’on croit hermétiquement fermé, il crochète les langues et les cultures, il met en circulation. Il n’aime pas plus l’idée d’une œuvre achevée que le braqueur un coffre-fort. Son butin, il le refourgue ailleurs. Il prend, il donne, il fait profiter. Et si l’arnaqueur vous vend la contrefaçon pour l’authentique, miracle de la littérature, le faux finit par devenir vrai : les vieilles traductions maquillées de la Série Noire, on les étudie désormais à l’université
Gringoire rêvait de devenir auteur : mon histoire, mon style, ma sensibilité. Mentalité de petit bourgeois. Rien n’appartient à personne en littérature et tous les actes de création sont à peser avec la même balance truquée. « En littérature règne la reprise individuelle et l’écrivain est un cleptomane, il pique sans même s’en rendre compte » : dixit le Sachem.
Le traducteur qui s’assoit à sa table de travail peut-il rêver meilleur alibi ?




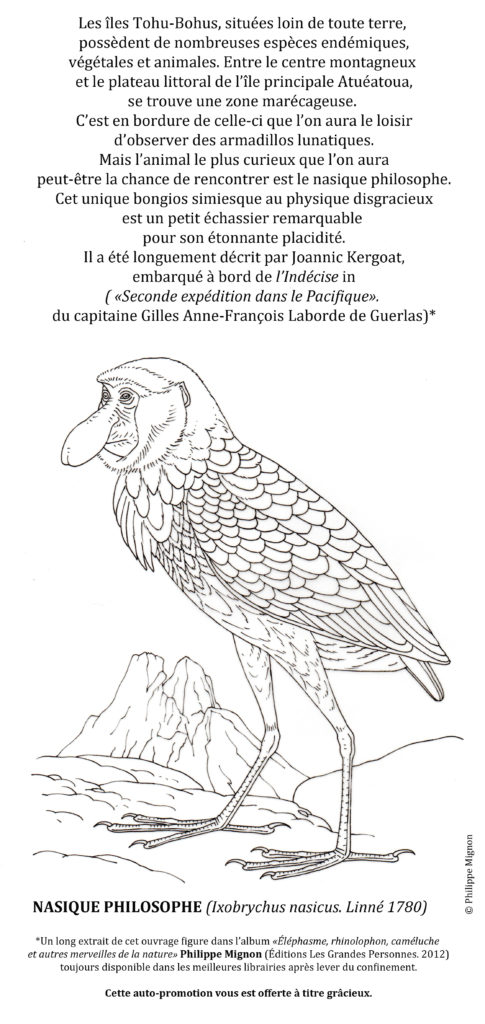
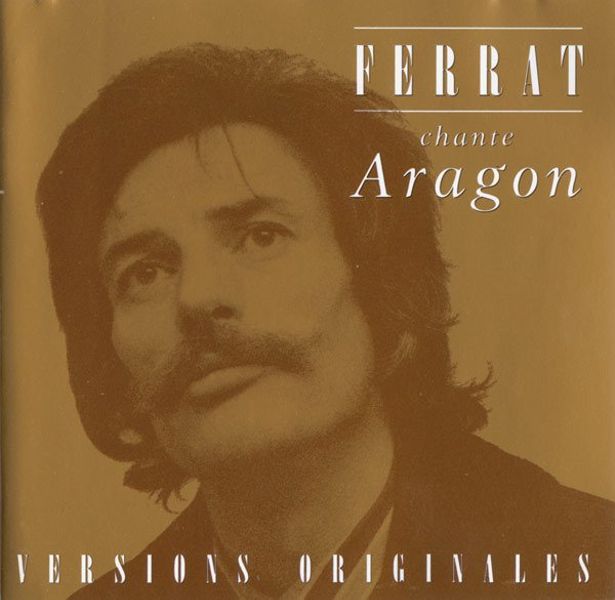
0 commentaires