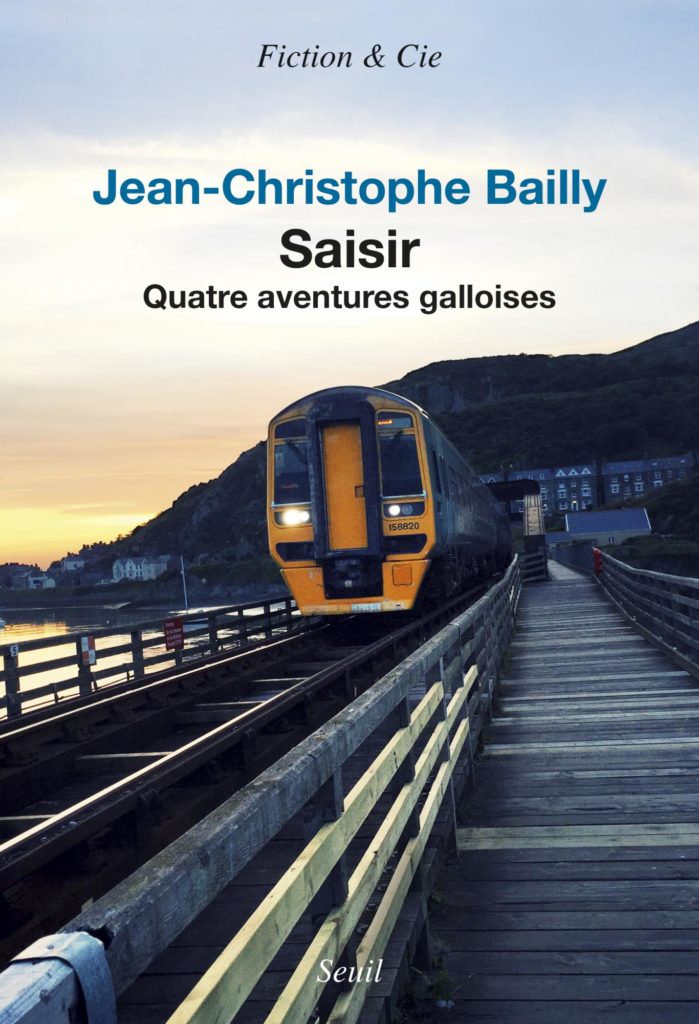 Quatre aventures galloises, plus une. Courant continu de l’écriture et de l’empathie avec des artistes, elle est celle des déplacements intérieurs et tout à fait réels de Jean-Christophe Bailly au pays de Galles, en grande compagnie.
Quatre aventures galloises, plus une. Courant continu de l’écriture et de l’empathie avec des artistes, elle est celle des déplacements intérieurs et tout à fait réels de Jean-Christophe Bailly au pays de Galles, en grande compagnie.
On referme Saisir de Jean-Christophe Bailly, sur cette dernière image qui vient contrarier l’effacement du pays des mineurs gallois, « j’imagine une sorte de procession qui partie de Mumbles remonterait Wind street, conduite par des majorettes roses et un poète ivre ».
Le livre vient de se s’achever sur un minuscule échec, alors que l’écrivain est sur la trace de Ben James, mineur qu’en 1950 Robert Frank photographia. Il cherche donc le cimetière – celui avec cet ange de pierre qu’avait justement saisi Frank alors de passage entre Europe et États-Unis – mais on ne le renseigne même pas. Il est au cœur du pays « évaporé », du « naufrage immobile » entre Swansea et Newport, mines de charbon disparues, maisons de mineurs sans mineurs, lieu « sans emploi et sans attente« , autrefois « avant-garde d’une fierté ouvrière qui a disparu et que les éradicateurs, Margaret Thatcher et les autres, ne supportaient pas ». C’est une disparition, « non seulement les hommes, ce qui après tant d’années est normal, bien sûr, mais aussi ce qui les portait, ce qui les faisait vivre ».
Ainsi s’affirme, en conclusion, ce qui est l’autre fil conducteur des Aventures galloises, hormis « la détente qui vient dans la saisie », thème officiel : un remède à l’effacement. Que l’on retrouve aussi bien chez le peintre Thomas Jones, Dylan Tomas à Swansea bombardée, à travers la recherche de Jacques Austerlitz chez Sebald, que, bien sûr, dans le pays noir disparu. Mais aussi évocation d’amis, ressacs et surgissements qui emmènent de l’éditeur marseillais André Dimanche à Pasolini, pas de name dropping, mais des associations, des glissements. Les mineurs, lit-on, rapportaient cette légende unificatrice : depuis les Asturies jusqu’au pays de Galles, puis franchissant l’Atlantique pour réapparaître en Amérique, existait une même veine de charbon. La veine est là, de chapitre en chapitre.
L’effacement, Thomas Jones a connu. De son vivant comme après sa mort. Il est heureux que ce soit lui qui ouvre le livre. D’entrée, il rompt avec ce que l’on pourrait appeler la thématique géographique, « une faiblesse » selon Bailly (même si l’on prend beaucoup de plaisir aux descriptions de lieux, estuaires, villes, trains et même bruine persistante). Né petit gentilhomme gallois au XVIIIe, il échappe à un destin tout tracé en apprenant la peinture (et en s’éclatant à Londres) et entreprend comme tant d’autres alors, un « tour » qui va le mener à Rome d’abord, à Naples surtout. Il loue sur les hauteurs de Capodimonte et c’est là qu’un jour – plusieurs jours sans doute – il peint à l’huile mais sur des papiers petit format ce qu’il a sous les yeux : un mur un peu lépreux et le ciel au-dessus, tranché.
« Ce n’est pas qu’il ait peint ce qu’on n’avait encore jamais vu, au contraire il a peint ce qu’on voyait tous les jours, mais ce qu’on voyait tous les jours, en fait, on ne le voyait pas vraiment, on ne lui accordait pas d’importance. » L’époque, en effet, était plutôt éprise de paysages pittoresques et avenants, avec bergers essaimés dans le paysage. Ce que Thomas Jones a peint – saisi, donc – ne se retrouvera que bien plus tard, du côté de Manet, et autres. Un bond dans le temps, dans l’idée même de peinture.
Mais Thomas Jones, dont les Mémoires documentent le texte, va s’arracher à l’Italie comme à sa vie de peintre, et se soumettre au destin annoncé, hobereau du pays de Galles, versant non côtier, traîner sa mélancolie (qui même sur un mur napolitain est perceptible), mourir. Pendant un siècle et demi, « dans une maison isolée du Radnorshire » dorment ses œuvres, que lui-même considérait à peine.
Le miracle, c’est que des musées, dont la National Gallery, aient acheté quelques-unes de ses œuvres lorsqu’enfin elles furent révélées par de lointains héritiers, un siècle et demi plus tard. Thomas Jones, toutefois, et son geste de peintre demeurent un peu mystérieux. Et tant mieux, il y de la modestie dans l’approche de Jean-Christophe Bailly, qui outre son écriture traversée de poésie, fait de lui un grand passeur. Il s’agit d’affects « à l’intérieur desquels le discours sur les œuvres cesse de pouvoir l’être de haut, ou de loin ; on n’écrit pas sur la peinture, on est posé devant elle, avec un langage heurté de plein fouet par le mutisme obstiné des formes et des images qu’elle produit ou qu’elle abandonne, et ce que l’on s’efforce de faire, c’est retrouver ce qu’un homme, parfois éloigné dans le temps, a cherché à identifier et à porter à l’évidence en peignant ». C’est toute la puissance de ce livre incertain. On le comprend en découvrant Thomas Jones, par exemple, encore peu connu. Le texte s’accommode de l’ignorance mais ouvre la porte.
Chaque partie, en une sorte de fondu-enchaîné, emmène d’une œuvre l’autre. C’est discret, pas de surlignage, mais il y a glissement, et on arrive à l’éblouissement du livre, son épicentre, Dylan Thomas. Des lieux, Swansea, Laugharne, New-York. « Il veut la matière du monde, il veut qu’avec des mots, malgré eux, elle soit saisie, et que les mots pour ainsi dire, en naissant, se souviennent, emportant avec eux le morceau du monde qui les a engendrés. » « Délire destroy et la dérision tragique, mais ce qui relie les premières cavalcades du mouflet de Cwmdonkin Park à cette ultime implosion d’un corps totalement alcoolisé, c’est la volonté quasi chamanique de rendre compte de l’état normal de l’existence. » La saisie est à double tranchant, le poète meurt à moins de quarante ans.

Au dessus du Corran et à quelques mètres de la maison, le cabanon de Dylan Thomas
En 1994 paraissait un « beau livre » de photographies chic, Maisons d’écrivains. C’était inquiétant, tellement c’était beau, le livre ne portant pas sur les damnés du logement. Parmi ces agencements muséaux se détachait la maison de Dylan Thomas, la Boat-house de Laugharne en bord d’estuaire, et son cabanon un peu reculé, cinq mètres carrés (une grande cabine de plage), que l’on avait arrangé aussi, veston sur la chaise et papiers froissés, mais on comprend que le livre s’attarde en ces lieux, le trail qui mène au pub, le cabanon bleu, en prise avec les textes de Dylan Thomas. C’est là, entre autres, qu’il écrivait en anglais « à partir d’une langue imaginaire » (ou du gallois aussi bien sûr), « ce qu’il lui fallait c’était secouer le langage, réveiller les mots, réveiller leur mémoire, c’était renverser ou évacuer tout l’aspect berceur du poème ».
Ce qui fut fait, entre autres, à travers son texte le plus connu en France, Portrait de l’artiste en jeune chien (traduction française de Francis Dufau-Labeyrie), et surtout, surtout, Under Milk Wood, soit en français Au bois lacté (traduction Jacques Brunius) : œuvre extraordinaire qui intègre les possibilités radiophoniques d’alors, jusqu’à soixante voix qui rêvent et disent la ville endormie. Que l’on peut écouter ci-dessus, en anglais mais peu importe, Richard Burton, enfant du pays de Galles, fait passer : c’est une question de saveur, de rythme, de densité. Dylan Thomas parle d’un Laugharne disparu, mais c’était déjà le cas dans l’immédiat après-guerre. Il redonne vie, « Contre-modèle venant s’opposer, comme tel, aux communautés terrifiées dont son temps commençait à recueillir les récits ».
Après-guerre, fondu-enchaîné avec Sebald, le dernier roman de l’écrivain allemand installé en Angleterre. Soit Jacques Austerlitz, cet homme qui reconstitue, en un puzzle de témoignages, photos, enquête, sa propre vie, et son origine, lui qui fut l’un de ses enfants juifs sauvés de la déportation par l’Angleterre, avec effacement du passé et placement, en pays de Galles intérieur, dans une famille de type austère, le mot est faible. C’est une mise en abyme, Austerlitz lui-même est une investigation, « fonctionnant comme une enquête ricochant d’indice en indice et entremêlant une rumeur continue de fiction ».
Après les mornes paysages de Thomas Jones rentré au pays, Dylan Thomas explosant langue et narration là-bas à Longharne et s’explosant lui-même, Sebald est un défi. Il s’agit d’aller sur les traces d’un imaginaire, même si Sebald emprunte scrupuleusement au réel (maisons, documents). Il faut donc aller voir du côté de Barmouth, sur l’estuaire de la Mawddach, le moment imaginaire de bonheur, le seul dépeint comme tel dans le livre, lorsque le collégien, grâce à un ami, sa maison devant l’horizon, voit s’ouvrir le monde. Il n’y a rien à chercher à Barmouth, peut-être, sauf « le sillage laissé par l’écriture », qui « y est à la fois invisible et omniprésent ». Et cela, pour le lecteur, que du bonheur.
Saisir, quatre aventures galloises de Jean-Christophe Bailly, éditions du Seuil Fiction et Cie.









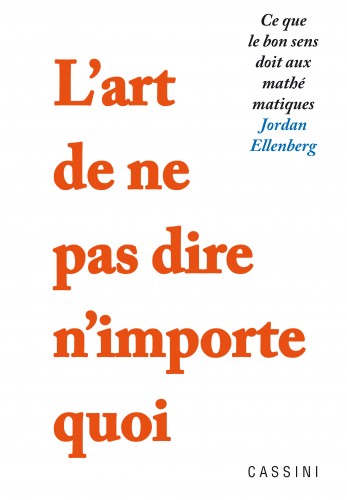
0 commentaires