Machines à voir : un rendez-vous mensuel où les artistes ont recours à la poétique et aux ressources techniques de l’image au format vidéo, version française des Máquinas de visión de la revue Campo de Relámpagos.
Cantar de ciego (1973-1975)
de Helena Lumbreras et Mariano Lisa
Après avoir exercé comme institutrice d’école rurale dans les années cinquante, la cinéaste espagnole Helena Lumbreras (Cuenca, 1935 – Barcelone, 1995), co-fondatrice du collectif Cine de Clase (Cinéma de Classe), étudia à la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, où elle obtint une bourse pour rejoindre le Centro Sperimentale de Cinematografia de Rome, abrité par Cinecittà. Elle y fit la connaissance de plusieurs figures majeures du cinéma italien de l’époque, dont Cesare Zavattini, Pier Paolo Pasolini ou Gillo Pontecorvo.
Ce séjour de travail en Italie fut déterminant dans sa carrière de cinéaste. Elle collabora avec Fellini sur le tournage de Satyricon (1969) et, un an plus tard, Pasolini lui apporta son appui financier pour la réalisation du documentaire El cuarto poder.
España 68 (1968), El cuarto poder (1970), El campo para el hombre (1973-75), O todos o ninguno (1976), A la vuelta del grito (1977)… Le cinéma politique de Helena Lumbreras est anti-franquiste, anti-système et anti-capitaliste. Selon Mariano Lisa, collaborateur et compagnon de Lumbreras, elle a toujours eu du mal à être reconnue, tant dans les cercles militants que dans le milieu du cinéma, en raison de sa double condition de femme et de cinéaste, et du profond machisme régnant au sein même de la gauche et des milieux communistes.
Entre 1973 et 1975 Helena Lumbreras et Mariano Lisa réalisent le moyen-métrage El campo para el hombre. Ce film, tourné dans la clandestinité, s’éloigne nettement des formes discursives associées au narrateur omniscient, caractéristique du genre documentaire militant.
El campo para el hombre est un film qui, partant d’une analyse marxiste, offre au spectateur une vision d’ensemble de la situation de la paysannerie espagnole, appuyée sur deux contextes : le minifundio galicien et le latifundio andalou. Mais le propos s’éloigne des lectures univoques ou réductrices. El campo para el hombre s’adresse directement au paysan qui n’est pas objet d’analyse mais sujet énonçant sa propre histoire.
Ce que nous présentons ici n’est pas la version intégrale de El campo para el hombre mais un court fragment intitulé Cantar de ciego. Qui fonctionne comme unité autonome, comme une œuvre en tant que telle. On pourrait même dire que ce « film à l’intérieur du film » résume et condense toute l’approche mise en œuvre.
La structure qui sous-tend le chant adopte la forme poétique connue comme romance ou chant d’aveugle [1]. Sur cette base narrative et musicale se déploie une série d’œuvres picturales inscrites dans une histoire de l’art et dont se servent les cinéastes pour illustrer l’histoire tragique du paysan et de l’opprimé au long de plusieurs siècles de domination par la noblesse, la couronne et l’église.
On y trouve des références à l’une des principales révoltes paysannes de l’Europe du XVe siècle, connue comme révolte d’Irmandiña, déclenchée par les paysans galiciens, désespérés par leurs conditions d’exploitation et de misère, ainsi qu’aux révoltes des payeses de Catalogne [2] ; il y est également fait allusion à la dévastatrice histoire de la spoliation dans les territoires d’Amérique conquis par et pour la couronne.
Le résultat est un modèle d’efficacité dans l’art politique. Qui repose non seulement sur la connaissance de l’histoire, mais sur l’utilisation de cette même histoire pour agencer les images et les paroles de la chanson populaire de l’aveugle.
Xan Gómez Viñas relève que la fragmentation narrative est due pour une bonne part aux conditions de production. À l’époque, les deux réalisateurs avaient été écartés du secteur de l’enseignement suite à leur participation à des grèves, ils avaient donc dû payer de leur poche les coûts du film avec les modestes ressources fournies par la traduction d’ouvrages et de manuels techniques et par des cours donnés de façon sporadique dans des établissements privés. C’est une des raisons qui explique l’emploi d’une caméra aussi rudimentaire que la Bolex Paillard. Une caméra qui permettait seulement de filmer en extérieur, avec des plans dont la longueur ne pouvait aller au-delà de quinze à vingt secondes. Au lieu de constituer un obstacle, les restrictions matérielles furent pleinement assumées par les réalisateurs qui adaptèrent le langage visuel aux contraintes techniques. Une façon de faire qui rappelle l’un des principes de Jean-Luc Godard quand il affirme : « Si vous n’avez qu’un dollar, faites un film à un dollar » [3].
La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelone a consacré en 2005 une rétrospective au travail de Helena Lumbreras, encore trop peu connu et étudié à ce jour.
María Virginia Jaua*






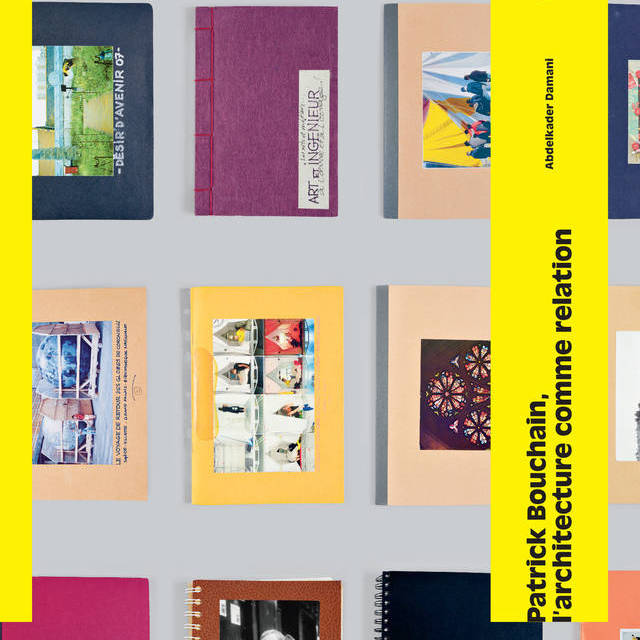

0 commentaires