
Nicola Sabbattini, Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri, 1638
En 1638, Nicola Sabbattini, architecte et scénographe italien, publie un ouvrage intitulé Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri. Y sont décrites les machines les plus sophistiquées, recommandées à qui veut faire advenir, sur une scène de théâtre, des nuées, des grottes, des envols, des fleuves, des villes, des palais et des mers. Sabbattini indique trois mécanismes possibles pour simuler le mouvement de la houle, et transformer le plan solide et assuré de la scène en un fluide mouvant. Et il en retient un, le plus efficace de tous : celui des “bras de mer”, soit un attirail de cylindres torsadés, peints de bleu, qu’on tourne à la manivelle ou qu’actionne un mécanisme à courroie (un exemple de bras de mer est visible dans une scène du Baron de Münchhausen de Terry Gilliam). Quand la machine est en mouvement, les rouleaux bleus semblent soudain la crête de vagues qui s’élèvent et s’abattent, mues par l’étrange énergie des fonds. Très grand siècle.
En 2016, à la galerie Jérôme Pauchant, Dorian Gaudin présente Aging Beauty, une machine qui, on ne peut s’y tromper, est un bras de mer, mais un bras de mer qu’on aurait descendu de la scène, vidé des navires de bois et des monstres de carton qui le parcouraient, décapé afin d’ôter les bleus qui couvraient ses cylindres et les changeait en eaux. Un bras de mer dont les rouages sont exhibés, lents, bruyants, et où la machinerie rendue visible occulte la fantasmagorie, la pulvérise dans ses roulements. Pas d’illusion ici, simplement les oripeaux de celle-ci. Pas de spectacle, mais une exposition, au sens le plus propre du terme. Le spectacle repose sur du caché – pas de spectacle sans coulisses. Rien de tel dans l’exposition, lorsqu’elle est complète : on montre, quitte à trop montrer, on exhibe, quitte à démonter.

Dorian Gaudin, Aging Beauty, 2015. Bois, acier, moteur, peinture, mécanisme et composants éléctriques, 324 x 301 x 96,5 cm. © Dorian Gaudin. Courtesy Nathalie Karg Gallery, New York & Galerie Jérôme Pauchant, Paris. Photo: Romain Darnaud
Aging Beauty tourne, et l’on se penche sur cet étrange machinerie, parfaitement fonctionnelle et pourtant sans usage. Beauté vieillissante et grinçante, pièce, assurément, la plus frappante de l’exposition Rebranding Floes, qui, à la galerie Jérôme Pauchant réunit six artistes, comme autant de manières de faire des mondes. Aux côtés du monde de Dorian Gaudin, les mondes de Hadrien Gérenton et de Matthieu Haberard existent par association de formes, rencontres incongrues où se logent le début d’histoires fantastiques. Brendan Anton Jaks et Robert Janitz, quant à eux, créent des mondes fossiles, où les supports racontent l’histoire d’une matière, déposée, ôtée, aggloméré… Et puis il y a les Phylactères de Justin Meekel, luisants et irisés comme des flaques d’essence, détournements de ces bulles, bandes et entrefilets qui, dans la peinture médiévale ou dans la bande dessinée, délimitent l’espace des mots dans l’image. Mais les phylactères de Meekel renversent le dispositif sur lui-même : là où le phylactère de bande dessinée ménage un espace blanc dans le fond chamarré de la planche, espace de lisibilité où peuvent sereinement s’inscrire les lettres, celui de Meekel existe comme un chatoiement de couleurs sur le fond blanc du mur.

Justin Meekel, Phylactère, 2016. Impression sur film polyester PET, verre feuilleté, 71,2 x 116 x 27 cm, © Justin Meekel. Courtesy Galerie Jérôme Pauchant, Paris. Photo: Romain Darnaud.
Le langage aurait-il disparu ? Ou le phylactère proposerait-il un nouveau type de langage, énoncé par ses luisances et ses irisations ? On s’absorbe dans la contemplation des couleurs, des effets de matière, on plonge dans la douceur appesantie des formes qui semblent prêtes à couler le long du mur et, pour un peu, on se noierait dans cette flaque suspendue… Mais, soudain, un bruit lancinant se rappelle à nous et nous tire de notre léthargie : le roulis des vagues défaites et inlassables de Aging Beauty, la rumeur de ce monde qui ne crée ni histoire ni langage, mais qui les démonte obstinément. Très XXIe siècle.
Nina Leger
Rebranding Floes, jusqu’au 23 juillet à la galerie Jérôme Pauchant, 61 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003, du mardi au samedi, de 11h à 19h.
[print_link]




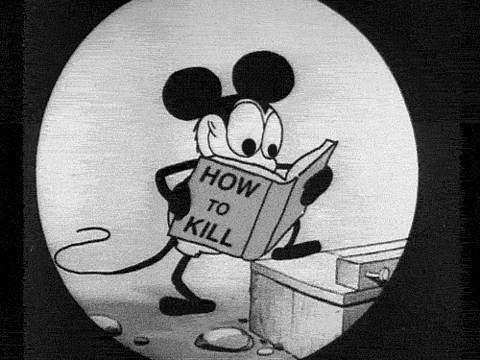


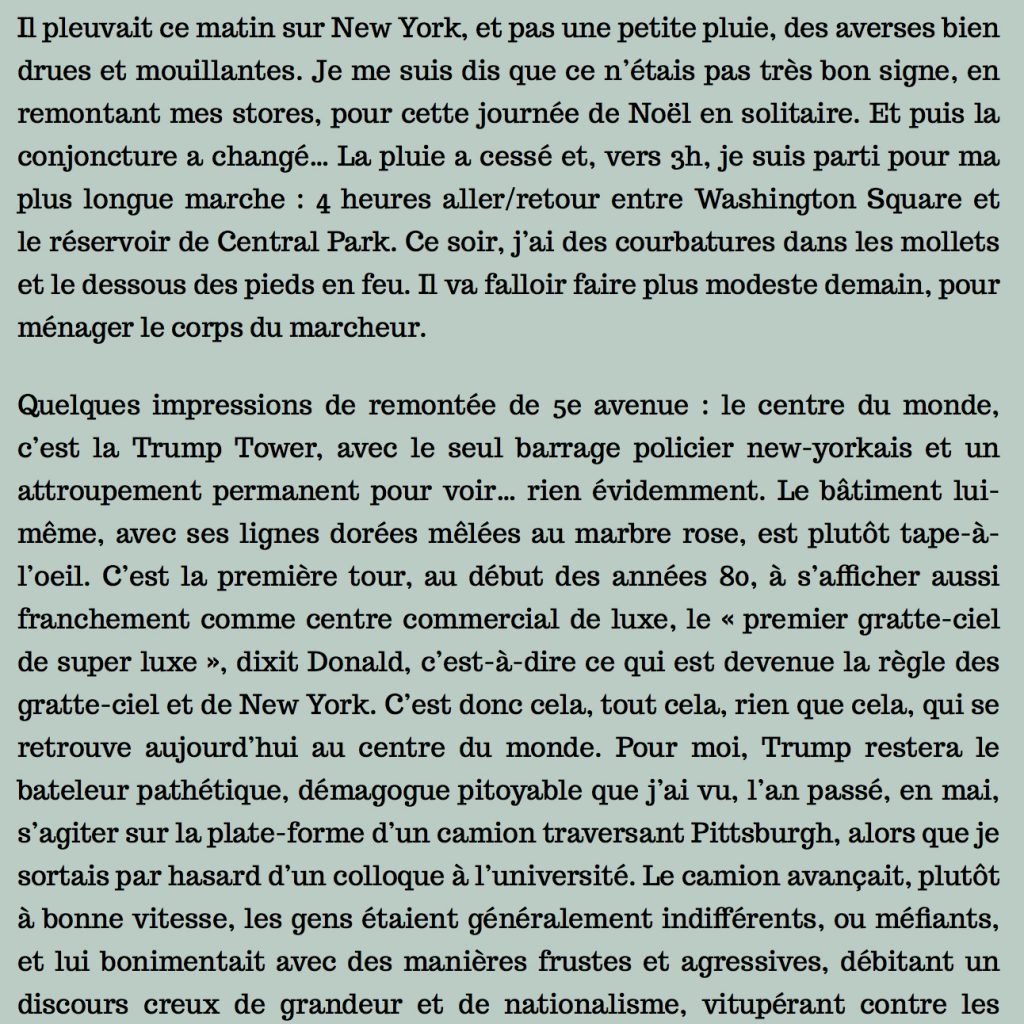
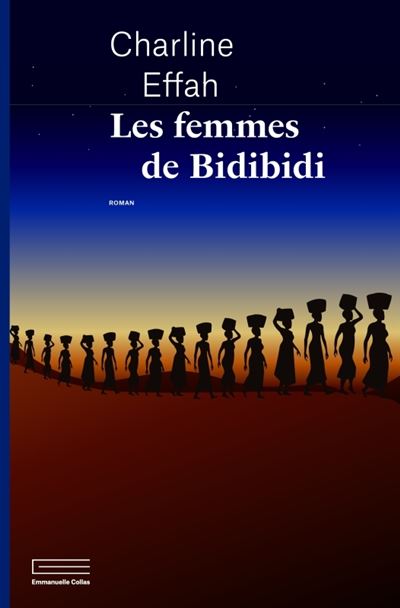
0 commentaires