 À l’heure où applis, sites et autres Tinders font illusion d’optimiser nos chances, reste heureusement une alchimie de l’amour dont nul ne saura décrypter la formule. Ainsi parfois, tout paraît concorder et conspirer au bonheur, mais qu’importe : la fille est jolie, intelligente et drôle, on lui plaît – et pourtant, point d’étincelle qui embrase la poitrine, ni de vague à l’âme quand la marée l’emporte… On s’en voudrait presque, mais rien n’y fait, ne reste qu’à saluer la demoiselle et lui souhaiter bon chemin.
À l’heure où applis, sites et autres Tinders font illusion d’optimiser nos chances, reste heureusement une alchimie de l’amour dont nul ne saura décrypter la formule. Ainsi parfois, tout paraît concorder et conspirer au bonheur, mais qu’importe : la fille est jolie, intelligente et drôle, on lui plaît – et pourtant, point d’étincelle qui embrase la poitrine, ni de vague à l’âme quand la marée l’emporte… On s’en voudrait presque, mais rien n’y fait, ne reste qu’à saluer la demoiselle et lui souhaiter bon chemin.
Il en est ainsi de l’œuvre de Jodie Foster, tant à sa manière de série B, elle paraît avoir tout pour plaire. Trois des plus attachantes stars d’Hollywood, et des plus intéressantes, de celles qui ont le plus bel usage de leur âge, nous font ici de l’œil. Jodie Foster nous revient d’on ne sait où pour passer derrière la caméra, et pour devant y mettre le couple vieux beau so sexy George Clooney / Julia Roberts, en présentateur cynique et réalisatrice efficace de l’émission éponyme – une télé-poubelle où le cash fait le show, entre conseils boursiers et gimmicks putassiers. Money Monster, programme-manifeste de la vulgarité made in America, aussitôt détourné de son trajet, ou plutôt pris en otage par un intrus aussi doué à incarner le looser que Lee Gates/Clooney singe le winner. Dans cet insupportable décor cathodique où le billet vert sert de papier peint aux écrans, surgit le corps étranger d’un jeune prolo, matière hétérogène trahie par sa silhouette et son accent. Le pauvre homme s’est ruiné en misant tout sur IBIS, une société financière survendue par Lee, et elle-même ruinée par un bug de son algorithme de trading haute fréquence…

Jodie Foster au travail avec Jack O’Connell
Dès lors, l’espace d’un live tenu par le faux temps direct du film, trois dramaturgies entremêlées tissent la trame d’un suspense sophistiqué – jusqu’au final où les trois fils se dénouent. À l’intérieur du studio, le huis clos où Lee, gagné du syndrome de Stockholm, tâche de survivre entre les consignes de son ravisseur sur le plateau et celles de sa partenaire en régie… Tout autour, le classique dispositif policier qui se met en place… Dans un troisième cercle, l’enquête express qui s’improvise sur le bug subi par Ibis – mais est-ce vraiment un bug ?
Que Jodie Foster nous ait sorti ses charmes de femme fatale, il ne fait aucun doute : une fable moderne sur la finance prédatrice, l’imagerie terroriste déplacée du terrain du 11 septembre à celui d’un autre trauma collectif (la crise de 2007), la société du spectacle forcée de se mirer bien en face, le tout fourré dans la robe noire échancrée d’un thriller électrique post-moderne. Car dès les premières minutes, la mise en scène se pare de ses plus chatoyants atours contemporains : caméras portées suivant le guide en plan-séquence façon Birdman, montage-kaléidoscope où l’on circule en “haute fréquence” d’un décor du drame, d’un angle de caméra ou d’un statut d’image à l’autre… Mais d’où vient-il alors qu’à peine entamée sa parade, nous n’y croyons déjà plus ?

Lee Gates/George Clooney, pris en otage dans le jeu du direct, entre victimes et coupables
Au mauvais hasard d’une rencontre amoureuse, il est des inconnues qui nous rappellent de trop connues. Non pas tant de ces visages d’anonymes qui nous sont familiers, mais parce qu’on reconnaît là une psyché, une histoire, une pièce qu’on a déjà jouée tantôt… Au-delà même des deux chefs d’œuvre de Sidney Lumet comme ici synthétisés (Un Après-midi de chien, 1975, & Network, 1976), on dévisage vite Money Monster, film-monstre fait des morceaux de tant d’autres. Et autant de clichés où pour le spectateur, la routine tue la séduction : débat négociation/intervention dans le QG des flics, vortex audiovisuel de la trash TV, retournements et rebondissements sans cesse… D’autant que ces beautés vintage, tellement années 90, se révèlent en toc, à défaut d’être rendues crédibles et cohérentes – jusqu’aux révélations finales, si invraisemblables qu’elles en deviennent grotesques.
 Plus grave, à force de premiers degrés improbables et d’ironies faciles, on ne sait plus ce que Jodie nous raconte ; elle devient cette jolie demoiselle ivre en fin de soirée, dont le discours se défait et l’intention nous échappe. Incriminé à l’ouverture, l’algorithme de trading haute fréquence est ensuite comme disculpé. Mais à l’heure où l’intelligence des machines gère l’économie des hommes, ne faudrait-il pas en condamner l’efficience, plutôt que l’échec ? Sans doute le meilleur film consacré à la question, Margin Call jouait d’un faux temps direct autrement plus vertigineux… La nuit même où la crise se déclenche sur l’ordinateur d’une compagnie, le film remontait la chaîne des responsabilités, du simple cadre au big boss, pour en arriver au plus absurde des constats : face aux formules mathématiques, aux valeurs virtuelles et aux opérations infinies où se brasse en bits numériques l’argent de l’univers, personne ne comprend plus rien. Nous avons confié notre monde à des équations qui agissent toutes seules, et dont le langage ou la logique nous reste impénétrable.
Plus grave, à force de premiers degrés improbables et d’ironies faciles, on ne sait plus ce que Jodie nous raconte ; elle devient cette jolie demoiselle ivre en fin de soirée, dont le discours se défait et l’intention nous échappe. Incriminé à l’ouverture, l’algorithme de trading haute fréquence est ensuite comme disculpé. Mais à l’heure où l’intelligence des machines gère l’économie des hommes, ne faudrait-il pas en condamner l’efficience, plutôt que l’échec ? Sans doute le meilleur film consacré à la question, Margin Call jouait d’un faux temps direct autrement plus vertigineux… La nuit même où la crise se déclenche sur l’ordinateur d’une compagnie, le film remontait la chaîne des responsabilités, du simple cadre au big boss, pour en arriver au plus absurde des constats : face aux formules mathématiques, aux valeurs virtuelles et aux opérations infinies où se brasse en bits numériques l’argent de l’univers, personne ne comprend plus rien. Nous avons confié notre monde à des équations qui agissent toutes seules, et dont le langage ou la logique nous reste impénétrable.
Pire encore, alors qu’on pensait voir tout un système mis en accusation, émerge du hors champ une figure de Méchant, comme si le Money Monster n’était pas une superstructure mais un individu, ici un patron manipulateur et corrompu. Un salaud de riche, voilà donc le coupable, digne d’être puni par la SEC – ce gendarme des marchés US que nombre de spécialistes jugent hautement (ir)responsable dans l’affaire des subprimes ! Alors certes, in extremis, le bad guy balance son monologue, il interpelle le public et renvoie chacun à sa faute, mais il est déjà trop tard, on ne l’écoute plus…
Que m’importe ce qu’il advient de Madoff, quand tout ce qui encadre, permet, suscite Madoff se perpétue mieux que jamais ? De cette ruse rhétorique par laquelle se sauve une institution en crise, en faisant passer la perversion de sa règle pour l’accident d’une exception, Roland Barthes avait fait une brève mais lumineuse Mythologie, L’opération Astra : “Insinuer dans l’Ordre le spectacle complaisant de ses servitudes, c’est devenu désormais un moyen paradoxal mais péremptoire de le gonfler. (…) C’est une sorte d’homéopathie : on guérit les doutes contre l’Eglise, contre l’Armée, par le mal même de l’Eglise et de l’Armée. (…) Un peu de mal “avoué” dispense de reconnaître beaucoup de mal caché.”
Sans doute Jodie Foster a-t-elle voulu réaliser son Occupy Wall Street, mais entre elle et nous, s’insinue comme un malaise, un malentendu plutôt, si bien qu’arrivé à l’épilogue, sarcasme noir censé susciter un rire jaune, on ne sait sur quel ton lui dire au revoir. Rendez-vous raté, dommage donc, puisqu’en choisissant de conclure cette tranche de vie – et de mort – sur le cercle vicieux et le mouvement perpétuel du “show must go on”, Jodie Foster reste lucide et finit son numéro de monstre sur la pire des obscénités. La pornographie de notre époque : du haut des gratte-ciel de Manhattan et d’ailleurs, toute une oligarchie de puissants nous a envoyés purger une très longue peine de misère et d’angoisse, à perpétuité pourrait-on croire, mais ces mêmes puissants ne cessent de danser, ils font toujours la fête, la loi et la morale, quand les plus fragiles de leurs victimes tombent et paient pour eux.


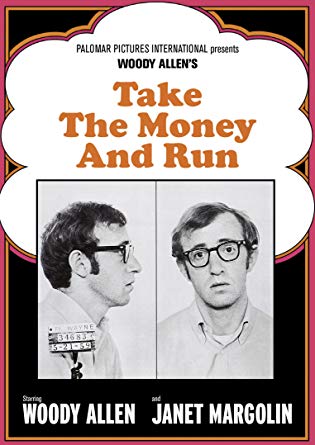






0 commentaires