 La littérature contemporaine a peu de goût pour l’espace – celui des astronautes, des spationautes et des satellites, s’entend – et ce n’est guère étonnant dans le fond : peu de secrets de famille là-haut, pas d’incestes ni de souvenirs d’enfance plus doux, pas même d’histoires d’amour, du moins aucune qui ait été rendue publique (sous réserve d’inventaire). La dernière incursion notable dans l’orbite terrestre est celle que fit Jean Echenoz dans Nous Trois (1992, Minuit) : quelques-uns des personnages du roman embarquaient tout à trac dans une capsule pour quelques jours d’expériences scientifiques en apesanteur, un petit tour en “scooter spatial” et un largage de satellite. C’était à la fois drôle et précis, documentaire et poétique, bref échenozien.
La littérature contemporaine a peu de goût pour l’espace – celui des astronautes, des spationautes et des satellites, s’entend – et ce n’est guère étonnant dans le fond : peu de secrets de famille là-haut, pas d’incestes ni de souvenirs d’enfance plus doux, pas même d’histoires d’amour, du moins aucune qui ait été rendue publique (sous réserve d’inventaire). La dernière incursion notable dans l’orbite terrestre est celle que fit Jean Echenoz dans Nous Trois (1992, Minuit) : quelques-uns des personnages du roman embarquaient tout à trac dans une capsule pour quelques jours d’expériences scientifiques en apesanteur, un petit tour en “scooter spatial” et un largage de satellite. C’était à la fois drôle et précis, documentaire et poétique, bref échenozien.
Nous voici aujourd’hui de retour en orbite grâce à La vie est faite de ces toutes petites choses (2016, POL) de Christine Montalbetti. Il s’agit du récit, presque minute par minute, de la dernière mission de la dernière navette spatiale américaine, Atlantis. C’était en juillet 2011. Tout s’est bien passé, merci. Il reste de cette mission de nombreuses images que l’on dénichera aisément sur Internet, et dans lesquelles l’auteur a puisé abondamment pour construire son ouvrage. Si bien que le lecteur peut – un œil sur le livre, l’autre sur l’écran de son ordinateur – apprécier le travail d’écriture qu’a accompli Montalbetti à partir de faits bruts et réels. Si le résultat est assez peu romanesque, il reste néanmoins très littéraire. Et éminemment séduisant. Comme Echenoz, Christine Montalbetti truffe son texte d’adresses aux lecteurs, de coqs à l’âne et d’humour. Nous avons simultanément le récit, le pourquoi du récit et le comment du récit, avec un “je” omniprésent. Mon tout, envers sensible d’un dossier de presse de la Nasa, est une avalanche des petites choses qui font le quotidien de la vie, en bas comme en haut. Sauf qu’en haut chaque geste, chaque repas, chaque accolade prend un relief différent, compliqués qu’ils sont par l’absence de pesanteur, ainsi que par la grande et dangereuse solitude de l’espace. Nous ne sommes pourtant qu’à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface terrestre.
À peine en avais-je terminé avec la lecture jubilatoire de La vie est faite… que je me replongeais dans Nous Trois, et immédiatement la différence me sautait aux yeux. À côté de Montalbetti, Echenoz c’est presque Balzac, toutes proportions gardées. Il y a chez lui des métaphores, du passé simple, des phrases comme (au moment du lancement) : “Cela paraît un peu long, près de dix minutes broyé par la pression dans tout le tremblement, le grondement des tuyères et le son à fond dans les haut-parleurs, les ordres nasillés par la salle de contrôle sur un ton d’urgence qui vous rend nerveux, serré dans votre couchette sur mesures comme un couvert d’argent dans son étui. […] Voici que l’on vient s’injecter en orbite et le silence revient, la pression décroît puis elle s’évapore, nous parcourons enfin, musique des sphères, le vide cosmique interstellaire.”
Même séquence chez Montalbetti : “La vitesse augmente, tandis qu’il paraît que dehors la densité de l’air diminue, et vers la quarantième seconde on réduit un peu les moteurs, s’il vous plaît, pour adoucir cette phase de vol très inconfortable que l’on appelle couramment le Max Q. C’est aussi, figurez-vous, le nom du groupe à l’intérieur duquel Fergie (commandant de la mission, ndlr) joue de la batterie (et pas plus tard qu’il y a deux mois, le 4 mai, au Johnson Space Center, où, lunettes noires, polo bleu, il tapait consciencieusement sur des fûts rutilants qui attrapaient bien la lumière des projecteurs).”
Chez Montalbetti pas de “couvert d’argent serré dans son étui” ni de poétique “vide cosmique interstellaire” mais un clin d’oeil vers une vidéo que l’on retrouvera aisément sur Youtube, et grâce à laquelle on se rendra compte que le groupe Max Q balance pas mal. Que les fûts de Fergie attrapassent bien la lumière ne nous avait pas immédiatement frappé ; le détail nous aurait d’ailleurs semblé insignifiant. Or non : ce reflet réanimé au moment dramatique du lancement donne à la scène une légèreté, une cocasserie plus échenoziennes que chez Echenoz.
Bien sûr, il ne s’agit pas de signifier ici que le “roman” de Christine est supérieur à celui de Jean. Il s’agit plutôt de mesurer le chemin parcouru ces vingt-cinq dernières années par le genre romanesque et ses lecteurs. Ce quart de siècle nous a semblé passer comme un éclair, sur une Terre immobile. En fait, non. Tout a changé, à commencer par notre regard sur le monde. Dans une époque désormais asséchée de toute illusion, nous sommes assoiffés de littérature du réel.






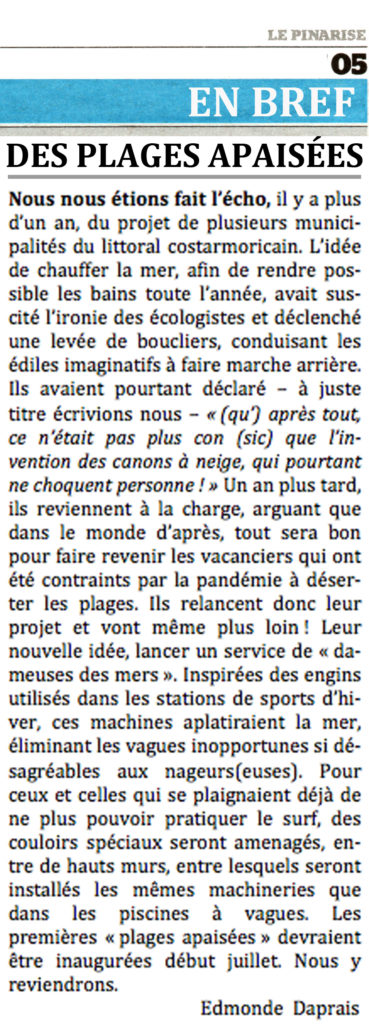


0 commentaires