Quand on ne skate pas, on réduit ces glissades sur une planche à roulettes à des performances dans la ville, bluffantes cinq minutes, ou parfois dérangeantes. Mais on ne réalise pas forcément comment cette relation particulière entre un objet, un corps et un terrain impliquent l’architecture. À la demande de la Villa Noailles, les jeunes architectes Benjamin Lafore et Sébastien Martinez Barat, le paysagiste Damien Roger et la commissaire d’art contemporain Audrey Teichmann ont planché sur les typologies des surfaces propices à cette pratique spontanée au départ. L’évolution de l’objet apparu vers les années 30 comme une simple trottinette démontée, l’invention de figures (tricks) de plus en plus complexes ont déterminé des terrains et des formes en permanente évolution. Toute une histoire reconstituée dans l’exposition “Landskating”, en trois volets. Bien servie par la scénographie de l’agence Peaks et le graphisme d’Antoine+Manuel.
Nos curateurs balisent d’abord un circuit historique de 1960 à 2000. S’appuyant particulièrement sur le magazine mythique SkateBoarder et sur le livre de l’historien Iain Borden (1), ils rappellent que cet art de la glisse s’est d’abord improvisé en Californie, dans les années 60 et 70, dans le sillage du surf. Quand l’océan est trop calme, les pionniers dénichent alors des lieux en béton, ondulants, tenus secrets, et les détournent : les aménagements hydrauliques et leurs pipes pour des rotations à 180°, des réservoirs d’eau, les banks (bords) des écoles, des piscines vides pour la verticalité des murs. Parallèlement à ces lieux trouvés, des skateparks commerciaux sont construits. Comme le célèbre Carlsbad en Californie (1975), succession de vagues en béton projeté.
Si les grands skateparks commerciaux vont péricliter, la ville reste une mine d’explorations rebondissante. Elle est utilisée comme une ligne ininterrompue, de la route au trottoir, du trottoir au banc, du banc au rebord d’une fontaine. La place – comme la Justin Herman Plaza à San Francisco des années 70 – est adoptée. On n’imagine plus à Paris le Trocadéro sans les crépitements de bois et de roulettes. Dans les années 80, apparaît le do it yourself. Le spot Burnside est construit de manière sauvage, sous un pont abandonné de Portland (Oregon), par des particuliers, avec des matériaux de récupération. Il est évolutif, ses modules artisanaux sont mobiles. “Le skatepark devient un double de la ville, comme une critique”, analyse Sébastien Martinez Barat. Jamais figés, ces terrains combinent un vocabulaire de formes, qui se codifie : bowls (bols), run (espace de course), banks (bords), pipes (tuyaux), zone de street, snake run, cradle, tunnels.
Dans un deuxième temps, la présentation de neuf projets contemporains conçus par des architectes ou des designers démontre l’intégration progressive du skatepark dans la ville, il devient un outil de renouvellement urbain ou paysager. Du skatepark d’Olari enserré dans une émergence rocheuse et conçu par le Finlandais Janne Saario au Miyashita Park de l’atelier Bow Wow situé sur un toit terrasse à Tokyo, du square Bayard (studio 1984) de la Roche-sur-Yon à la rue Cladel à Paris (agence Constructo)… ces terrains sont passés de la périphérie des cités au centre. Ils reproduisent des bouts de ville, de paysages, inventent un nouveau mobilier urbain comme le Street Unit mobile pour le saut. Ils sont parfois multi-sports, de plus en plus végétalisés. Ils s’insèrent dans un espace public mieux partagé.

Skatepark rue Léon Cladel, Paris, Agence Constructo & Raphaël Zarka, 2012. Photo Stéphane Ruchaud 2016
Pour compléter toutes ces rampes de glisse, quatre photographes ont parcouru la France pour zoomer sur différents lieux construits. Stéphane Ruchaud a saisi une corolle de béton à Courbevoie. À Annecy, Cyrille Weiner fait découvrir une volée d’escaliers colorés entourées de prairie et d’arbres. Maxime Delvaux s’attarde à Nîmes entre cyprès et courbes taguées. Olivier Amsellem a choisi le parc de Marseille conçu par l’architecte-skater Jean-Pierre Collinet en 1991, véritable légende. Il a fait en sorte que l’énergie du skateur soit continue. Qu’ils soient en béton gris, graffités ou colorés, ces espaces de rampes et bols sont plastiquement intéressants, voire très beaux. Comme le Otro de l’Île de Vassivière, réalisé par l’artiste Koo Jeong A et l’agence l’escaut, une nappe ovoïde creusée de cradle, bowls et tunnel. En plus, il est phosphorescent.
Anne-Marie Fèvre
(1) Iain Borden, Skateboarding, Space and the City : Architecture and the Body, Berg Publishers, Oxford, 2001.
Exposition “Landskating”, Villa Noailles, Hyères (Var), jusqu’au 20 mars. Catalogue Landskating, édition Villa Noailles/Archibooks, 30 euros.
[print_link]










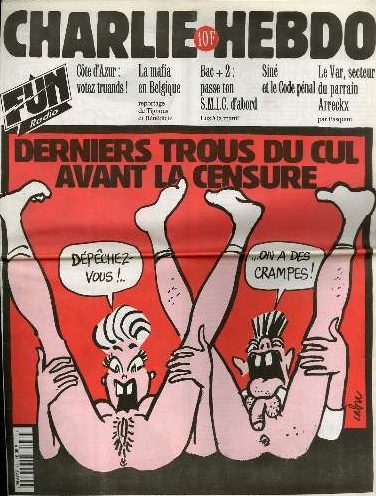
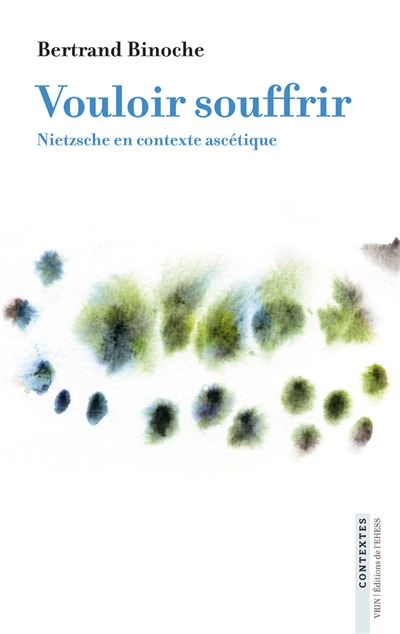
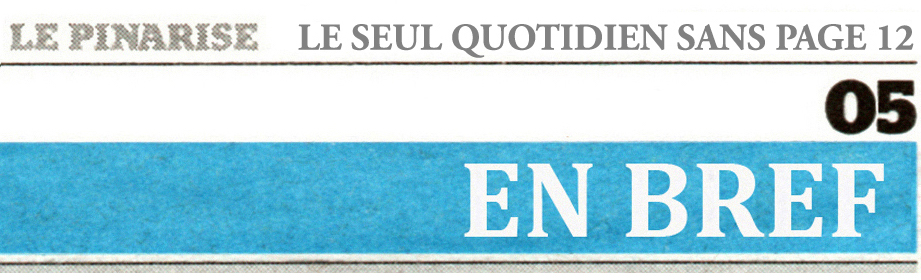



0 commentaires