Résumé des épisodes précédents : Arraché dès sa tendre enfance à sa Taïga orientale native, Tigrovich se cherche, mais il a trouvé. Après avoir laissé l’huître pour l’art circassien, l’amour, la débauche, le voici qui s’est piqué de partir à Paris pour trouver la gloire et surtout un dompteur.
Ce ne fut pas un tigre qui ce matin-là sortit à l’aube du train de nuit, attendu aux alentours de 6h17, dans une gare parisienne nommée d’après une victoire vaguement napoléonienne, mais, tendu comme une panse bourgeoise, haut et large à la fois, massif et résolument encombrant, pesant plus que son poids, à la limite extrême de l’obésité pathologique, entraînant donc dans son mouvement quiconque se piquait d’en diriger la course, énorme, démesuré, phénoménal, un sac, dit de voyage. Le bagage était précédé des roulettes qui en assuraient l’improbable mobilité. Et se trouvait, non pas tant suivi, mais plutôt accompagné dans sa chute du tigre qui, tenant les courroies comme des rênes, tentait d’en retenir l’élan. D’où, prévisible, une cabriole. Peu glorieuse. Mal contrôlée. Sac à terre, tigre dessous et le tout pêle-mêle. Mais quoi ! La chute des plus nobles héros n’est pas chose rare dont l’essentielle fonction est de donner aux conteurs l’occasion de quelque digression, le temps que se relèvent et s’époussettent leurs chus protagonistes. Ainsi en userons-nous, car ce sac de voyage artistique mérite assurément que nous en décrivions plus avant les détours, strates, corridors dérobés, itinéraires contournés et compartiments secrets, sans oublier, plus attendus, les trappes, doubles-fonds, et autres miroirs sans tains. Le sac, donc, n’avait rien, hormis sa taille et sa masse, qui puisse étonner un voyageur naïf ignorant ses détours intérieurs. Mais quiconque, dépassant l’apparence sensible, tentait d’en défaire les courroies, puis les doubles nœuds, ensuite les lanières, finalement les pressions et boucles en assurant l’hermétique fermeture, n’était pas au bout de ses surprises. Une première strate, d’abord, s’imposait au regard, anodine en elle-même et propre à recevoir maillots roses et d’autres couleurs, chemises en soie et lavallières, pantalons bouffants et sarouels, habits de soirées et queues de pie, bref l’ordinaire vestimentaire de l’artiste. Or, comme on jetait les yeux sur les deux côtés de ce fatras, on constatait que les parois environnantes supportaient des étagères qui s’ouvrant se dépliaient sur une hauteur conséquente, bien le tiers d’un chapiteau. Sur les étagères reposaient, classés par tailles et par fonctions, divers accessoires indispensables à l’artiste (quilles de jonglages, violons et trombones, boîtes à poudre et à musique, coffrets à bagues, crayons multicolores et emplâtres variés, bougies et encens divers, miroirs aux bordures incrustées de coquillages et même de quelques huîtres nacrées, baguettes plus ou moins magiques, lapins empaillés, nez rouge et chapeau pointus, sans oublier la bibliothèque indispensable à l’artiste dont on trouvera l’inventaire dans le bien connu numéro de La Gazette du Cirque à cette question tout entier consacré). Supports de ce bataclan, les étagères avaient aussi une autre utilité : des deux plus hautes s’élevaient, symétriquement disposées, deux piliers, bien solides, soutenant une série de poulies et d’agrès téléscopiquement dépliables, commode mécanisme qui, se déployant, offrait à l’artiste en tournée un portique complet propre à quelques exercices de trapèze. Un filet d’ordinaire dissimulé dans les doubles parois du sac se dépliait alors au-dessus du vestiaire bigarré. Ces poulies ingénieusement fonctionnelles autorisaient, après l’effort, la remontée du filet vers les hauteurs du sac, tendant les mailles jusqu’à les rendre plus compactes et transformant le filet en un nonchalant lit suspendu, autrement nommé hamac, propre à accueillir l’artiste épuisé par ses exercices de voyage. Double berceau des chutes de l’acrobate et de son épuisement, ces mailles entre elles tissées n’étaient pas l’accessoire le moins ingénieux de l’ensemble. Ce n’était pas tout. Et même tout cela n’était, pour ainsi dire, que la vision accessible à l’œil du commun, pourvu qu’un artiste en voyage décidât de se livrer publiquement, dans le compartiment d’un train ou sur le pont d’un paquebot, à quelques exercices d’assouplissement. Car sous le vestiaire et du côté des parois, se cachait une série d’ouvertures dissimulées qui, une fois ouvertes par quelque rite transmis d’écuyère en tigre, donnaient accès à diverses galeries de largeurs inégales. En faire le plan exhaustif, nous n’en aurions pas la force, eussions-nous dix bouches, mille doigts et autant de stylographes. Nous dirons seulement que chaque galerie avait sa couleur : le rose menait à un sous-sol où tenaient aisément deux ou trois ballerines et leur magicien ; l’orange à un clapier pour les lapins et autres pigeons toujours bienvenus en ces matières ; le bleu roi, enfin, le préféré de tout artiste, à un nouveau double fond qui, s’ouvrant sur des soieries cramoisies, pouvaient abriter les amours des tigres amoureux, d’autant plus aisément qu’un bar et quelques verres à cocktail suspendus à la paroi incitaient à une coupable langueur. Bien sûr il fallait pour tout cela que le sac se déplie, ce pour quoi il avait été conçu. Mais en ce développement, c’est tout un monde conjointement qui se dissimulait, ville enfouie sous le bagage, car tout geste d’ouverture, tout dépliage additionnel avait pour effet d’enfoncer davantage, en un compartiment secret, situé en quelque lieu entre le trapèze et les roulettes, des denrées et autres produits indispensables à l’art du cirque, soit substances illicites, or et argents d’origine internationale, alcools et marché noirs, poulets volés parfois, paniers à vendre, cartes à arnaques et tout ce que pouvait exiger, selon les circonstances et moments, la survie d’un tigre soucieux de son épanouissement. Enfin, sans que l’on sache pourquoi, Tigrovich avait insisté pour qu’à l’extérieur de sa malle rebondie soit fixé, comble du confort, majestueux, bleu vif, plus grand que nature, compagnon rassurant autant que menaçant, pilastre et pilier à la fois, un superbe et large parapluie. Le parapluie se terminait en une canne crochue et c’est cet appendice qui s’accrochant finalement à la porte du wagon finit d’achever le tigre, enfin relevé et soudainement suspendu au train qu’il tentait de quitter. Le sac résista. Le Tigre aussi, qui en sueur et poussiéreux leva un œil et ne vit rien. Sinon, en ce petit matin frileux qui l’accueillait dans la ville des lumières, une blafarde pancarte annonçant vaguement, dans le gris ferroviaire, l’existence d’un débit de boisson, de ceux que l’on nomme buffets de la gare. S’attelant à son bagage, respirant fort et peinant, le tigre s’y traîna, s’écroulant sur un siège, tremblant de sommeil et de froid, courbatu autant par ses exercices que par l’incertain confort des sièges inclinables qui avaient soutenu son sommeil, nostalgique de ce qu’il quittait, incertain de ce qu’il trouverait, aussi peu lumineux que la pièce où il se trouvait, bref piteux.
Sophie Rabau
Les aventures de Tigrovich
Épisode précédent : « C’est à Paris
qu’il faut aller (méditation d’un tigre) » Épisode suivant :
« Épiphanie d’un dompteur »


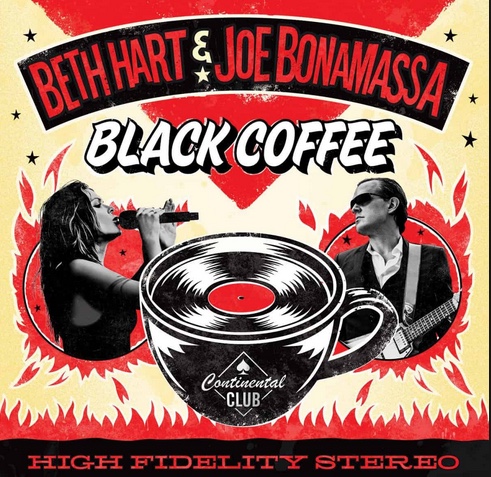
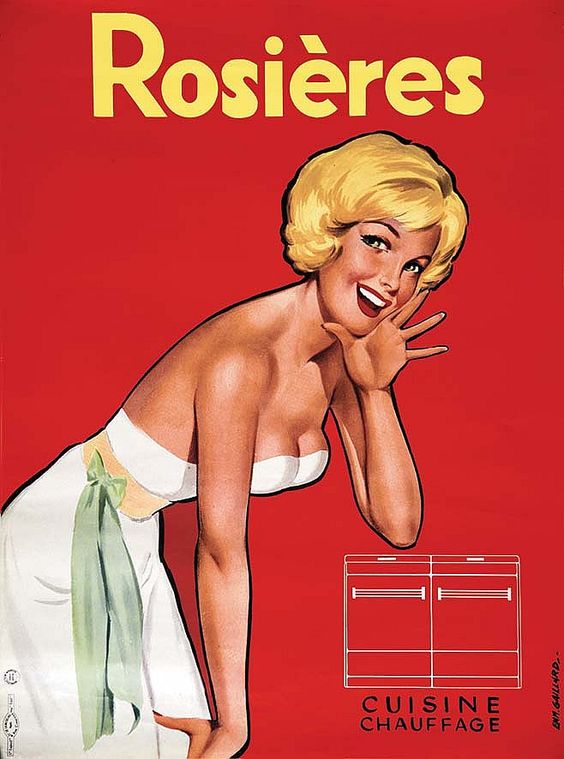




0 commentaires