Machines à voir : un rendez-vous mensuel où les artistes ont recours à la poétique et aux ressources techniques de l’image au format vidéo, version française des Máquinas de visión de la revue Campo de Relámpagos.
Ana Esteve Reig, Don’t Believe in Me (2012)
Ana Esteve Reig (Agres, 1986) travaille habituellement en vidéo et parmi ses centres d’intérêt – elle en parle avec clarté et lucidité – figurent « la fiction, les vedettes du cinéma et de la télévision, la culture populaire, les rituels et la réalité virtuelle, considérés comme des éléments de référence pour tenter de comprendre la position de l’individu à l’intérieur de la société ».
Don’t believe in me fait partie des différents exercices réalisés par l’artiste durant ses années de formation à Kassel. Concrètement, elle l’a réalisé en 2012. Une année qui nous rappelle la terrible crise économique qui, en Espagne, a duré encore plus longtemps qu’ailleurs et qui a fait que de nombreux jeunes comme Ana ont dû aller chercher ailleurs la vie et les opportunités que leur pays ne pouvait leur offrir.
Même si la situation est différente et si les effets de la pandémie qui se sont fait sentir en 2020 ont bouleversé presque tous les équilibres de la vie des gens, il y a dans tout cela quelque chose qui retrouve de la pertinence. Comme un rappel, un air de déjà vu. Aucun élément concret ou palpable, mais une sensation d’éternel retour, comparable au cycle des marées, ou à une répétition à intervalles réguliers de circonstances qui semblent échapper à toute tentative de contrôle, que nous ne savons pas identifier mais qui reviennent toujours.
C’est dans ce contexte d’incertitude qu’a lieu la fête. Un genre de fête, disons.
La célébration à laquelle nous assistons en tant que spectateurs rassemble un groupe de jeunes gens dont nous ne voyons pas les visages, parce que leurs chevelures nous les dissimulent. Ils pourraient être dans leur bar préféré en train de boire, d’écouter des accords de musique un peu « particuliers », comme les personnages. La seule dont nous distinguons vraiment les traits est la serveuse. La seule qui effectue une action, qui a une raison d’être, une occupation, qui remplit une fonction : servir les clients. Bien sûr, il y a aussi l’œil omniscient de la caméra tenue par Ana et qui compose l’ensemble.
Le cadre qui se déplace à travers le local capture au passage les poses statiques d’un groupe de chevelus en train de boire, dans leur monde, mais conscients d’être rassemblés en un même lieu : le bar mutter – mère en allemand ; il s’agit d’une sorte de « portrait de famille » ou de bande désenchantée. Comme dans tout portrait, il y a quelque chose de solennel, mais aussi une bonne dose d’humour. Le film donne une image ironique de ce que pourrait être une fête du Nouvel an, s’il y en avait une. Et c’est en même temps une image rituelle, pleine de tendresse et de dérision.
Ce qui flotte curieusement dans le local faiblement éclairé, c’est l’expression d’un nihilisme annoncé dans le titre et qui nous mène au geste critique de l’artiste, qui d’une certaine manière cherche à mettre en scène l’incrédulité de sa génération et une forme de doute vis à vis d’elle-même et de l’avenir.
María Virginia Jaua
Machines à voir
* La version originale de ce texte a été publiée le 26 décembre 2020 dans la section Máquinas de visión de la revue en ligne Campo de Relámpagos.




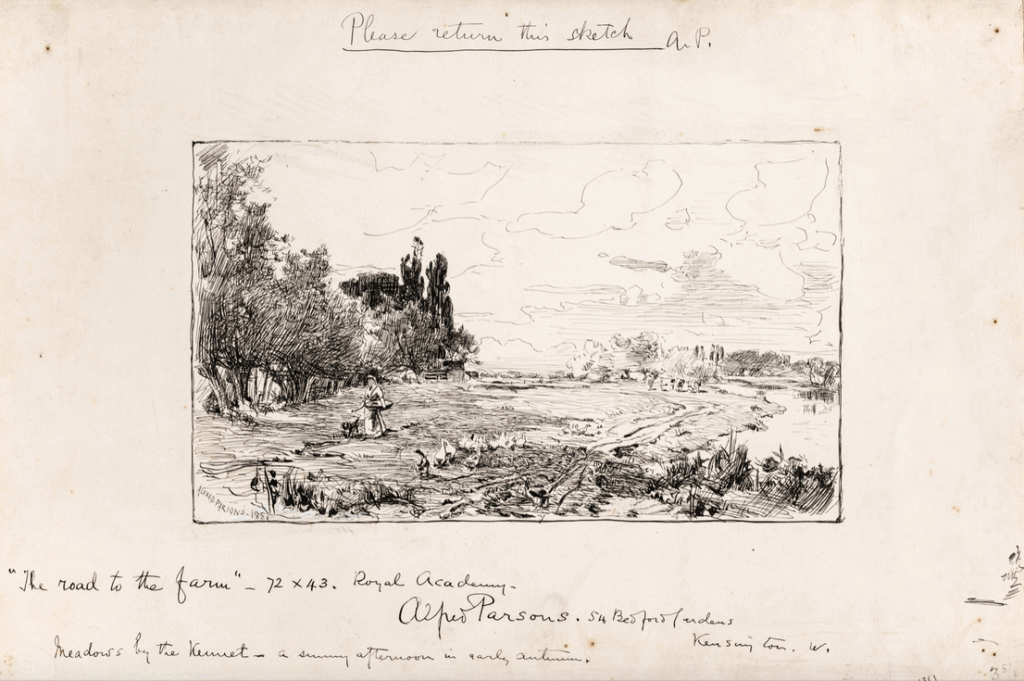




0 commentaires