Quelque chose là-haut : tous les quinze jours, un nouvel épisode d’une histoire simple et terrible. Il y a quelque chose là-haut qui m’obsède. Quelque chose dans le ciel, ou dans ma tête peut-être.
 Ces deux types ne savaient pas ce que je savais, tout comme moi j’ignorais quelles informations ils pouvaient détenir. Cela nous mettait sur un pied d’égalité. L’exercice du journalisme apprend à gérer de ce genre de situations ; on avance ses pions prudemment, sans trop découvrir ses positions mais en poussant tout de même l’autre camp à dévoiler un peu des siennes. Cependant les deux hommes que j’avais devant moi disposaient d’une arme que je n’avais pas : l’intimidation. Ils l’ont utilisée assez vite.
Ces deux types ne savaient pas ce que je savais, tout comme moi j’ignorais quelles informations ils pouvaient détenir. Cela nous mettait sur un pied d’égalité. L’exercice du journalisme apprend à gérer de ce genre de situations ; on avance ses pions prudemment, sans trop découvrir ses positions mais en poussant tout de même l’autre camp à dévoiler un peu des siennes. Cependant les deux hommes que j’avais devant moi disposaient d’une arme que je n’avais pas : l’intimidation. Ils l’ont utilisée assez vite.
« Vous ignorez dans quelle histoire vous vous êtes embarqué, et ne croyez pas que le fait d’avoir une carte de presse va vous mettre à l’abri de quoi que ce soit ». Leur ton était vite devenu menaçant. C’était notre deuxième rencontre. La première avait eu lieu dans une brasserie de la place Saint-Michel, au vu et au su de tous ; nous avions aimablement tourné autour du pot en buvant une bière. Ils m’avaient fixé un nouveau rendez-vous, cette fois dans un bâtiment proche des Invalides. J’avais été étonné de me retrouver dans un petit bureau sous les toits d’une annexe du ministère des Dom-Tom, en compagnie de ces deux hommes en blouson de cuir dont je m’étais soudain demandé s’ils n’allaient pas me passer à tabac.
Je connaissais mal le monde du renseignement. Mon seul contact avec ce milieu remontait à plusieurs années. Je m’apprêtais à partir aux États-Unis poursuivre mes études dans une université de Los Angeles. Ma demande de bourse avait été refusée. Durant l’été, j’avais reçu un coup de téléphone d’une personne se présentant comme fonctionnaire de je ne sais plus quel ministère. Elle était au courant de ma situation, affirmait pouvoir me proposer des solutions. Même topo : rendez-vous dans un bar très fréquenté puis dans un endroit plus discret. Et au bout du compte, la promesse d’une aide financière si j’acceptais d’envoyer de temps en temps des photocopies de documents que je trouverais incidemment à la bibliothèque de l’université. De la simple veille technologique, disaient-ils. Mon domaine à l’époque, c’était le traitement du signal numérique, une discipline nouvelle et effervescente qui intéressait beaucoup de monde, en particulier l’armée. La proposition était alléchante mais je n’étais pas complètement idiot. Je l’ai refusée. Sage décision : une fois sur place, des étudiants français m’ont dit avoir été approchés de la même manière et m’ont assuré que, pour certains d’entre eux, cela avait été le début d’un engrenage fatal car les types à Paris faisaient des demandes de plus en plus précises, de plus en plus pressantes, et il fallait y répondre sous peine de se voir balancer aux autorités américaines et de perdre son visa.
J’avais été prévenu, et pourtant cette fois, j’ai été incroyablement naïf. J’ai cru pouvoir m’engager dans un donnant-donnant, info contre info. Mais le seul objectif des deux types était de me faire taire. Ils en savaient beaucoup plus que moi, et me concernant, ils en savaient trop, même si, apparemment, ils ne savaient pas tout. Après m’avoir menacé, ils ont abattu leurs cartes. « Parlez-nous un peu de ce que vous faisiez à Accra en juin dernier. Êtes-vous toujours en contact avec Ilona Beirach ? ». Je me suis senti blêmir. De cela, ils étaient donc au courant. Il était illusoire de croire que mon passage à l’ambassade n’avait laissé aucune trace. J’ai refusé de répondre. Ils m’ont laissé partir en disant qu’on se reverrait.
Dans le colis en papier kraft, il y avait aussi un Post-it où était inscrit un simple nom, Jean-François Jenny, suivi de l’acronyme DCRI. La Direction centrale du renseignement intérieur ? Au journal, mon collègue chargé des affaires de renseignements ne connaissait personne du nom de Jenny et fut réticent à me donner un de ses contacts. Ce cher Jean-Dominique m’a seulement aiguillé vers un type tout à fait subalterne qui m’a assuré à son tour ne connaître aucune personne de ce nom à la DCRI. Ma question était idiote : allait-on me balancer le listing de tous les agents de la boîte ? Pourtant, deux jours plus tard, quelqu’un m’appelait pour me fixer un rendez-vous place Saint Michel. Puis on me parlait d’Ilona, on me demandait comment j’étais arrivé au Ghana et ce que j’y avais fait.
J’ai aussitôt appelé Ilona à Londres — depuis une cabine téléphonique, on n’est jamais trop prudent. Elle n’était au courant de rien, et personne n’avait essayé de la contacter. Elle ne m’a même pas demandé ce qui m’agitait : sa longue dégringolade dans la dépression se poursuivait. « Ces types que nous avons … tués, tu ne crois pas que… » etc. Moi, j’avais mis ça derrière moi, autant que possible. Il s’agissait de légitime défense, et de toute façon j’étais embringué dans une histoire suffisamment embrouillée pour que j’aie le temps de culpabiliser. Depuis mon rendez-vous aux Invalides, j’avais l’impression d’être suivi. Mon téléphone sonnait parfois pendant la nuit. Numéro inconnu, personne à l’autre bout de la ligne. J’étais clairement l’objet d’une tentative d’intimidation. Mes relations avec la direction de la rédaction s’étaient trop dégradées pour que je lui parle de mes mésaventures ; il aurait fallu que je raconte toute l’histoire, ils m’auraient pris pour un dingue. Aucun secours de ce côté-là, ni d’aucun autre d’ailleurs.
Puis, soudain, plus rien. Plus d’appels, plus de filature, réelles ou supposées. Ne restait qu’un grand malaise et beaucoup de questions. Qui m’avait envoyé le colis ? À quelle fin ? En quoi la Direction du renseignement intérieur pouvait-elle être concernée par cette affaire criminalo-spatiale ? Et pourquoi essayait-on de me faire taire ? J’avais l’impression d’être dans un épouvantable remake du Faucon maltais. Pas un mot sur la disparition de Myers dans les journaux ou sur le web. Celle des trois étudiants avaient l’objet de quelques lignes dans la presse américaine sous le titre : « Trois jeunes ethnologues se volatilisent en Amazonie ». Guère plus sur les deux photographes gallois, que les journaux britanniques présumaient morts en Libye. L’hôtel de Rolas avait rouvert comme si rien ne s’était passé. Aucune information n’avait filtrée à São Tome sur ce qui s’était produit sur l’îlot ; il n’y avait eu que de vagues rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, que personne n’avait prises au sérieux malgré le fait que l’on soit sans nouvelles de deux employés du Pestana Equador. Fin de l’histoire, apparemment.
Toutefois il subsistait des vestiges concrets de ces journées que je commençais à douter d’avoir vécues : la voix d’Ilona au téléphone, et surtout les documents qui m’avaient été envoyés anonymement. Leur message implicite était – j’ose à peine l’écrire – qu’il y avait un engin étrange autour de la terre, que son origine était inconnue et que l’information n’avait pas été rendue publique. Le reste, je le savais pour l’avoir vécu : des types s’étaient mis en tête d’entrer en contact avec cette chose par des moyens chimico-télépathiques. Ç’aurait été à pleurer de rire si l’affaire ne s’était pas terminé par un carnage.
Rendez-vous avec Rama, le livre dans le colis, n’est pas le meilleur roman d’Arthur C. Clarke. Il raconte l’arrivée d’un immense objet spatial non identifié dans le système solaire. Une mission d’exploration est envoyée à sa rencontre ; elle découvre à l’intérieur du monstrueux engin tout un monde en réduction : des villes, des mers, des montagnes ainsi qu’une technologie extrêmement avancée et pourtant vieille de plusieurs millions d’années. Je me demande pourquoi Clarke s’est laissé aller à tisser un récit aussi abracadabrant. Il aurait pu faire beaucoup plus simple et réaliste, imaginer un engin de taille plus réduite venant se placer en orbite autour de la Terre.
Mais Clarke n’était pas seulement romancier, c’était aussi un visionnaire. En février 1945, dans une lettre adressée au magazine Wireless World, il avait le tout premier à imaginer que des engins placés en orbite géostationnaire pourraient servir de relais de télécoms. Il suffisait d’utiliser un de ces V2 allemands pour aller accrocher là-haut un peu d’électronique. Trois charges utiles, suffisamment espacée autour de la Terre, permettraient d’établir une couverture radio de toute la planète. Il concluait son courrier par ces mots : « J’ai peur que cette idée ne soit d’aucune utilité à nos planificateurs d’après-guerre, mais je pense que c’est la solution ultime à ce problème (de communication) ». Crainte infondée puisque le premier satellite géostationnaire, l’américain Syncom 3, était lancé moins de vingt plus tard, le 19 août 1964. Depuis, l’orbite géostationnaire est aussi connue sous le nom de Ceinture de Clarke.
Quatre mois après la mise orbite de Syncom, lors d’un débat à la Mutualité organisé par la revue Clarté autour du thème « Que peut la littérature ? », Simone de Beauvoir clamait à la tribune que la littérature n’existait vraiment que lorsqu’un écrivain était capable de « manifester et d’imposer une vérité, celle de son rapport au monde, celle de son monde. » Évidemment, ceci n’avait aucun rapport avec cela, mais elle avait largement raison. Jules Verne a envoyé une fusée habitée vers la Lune un siècle avant que la Nasa n’y songe. Tintin a foulé le sol lunaire vingt ans avant Neil Armstrong. François Truffaut, improbable acteur des Rencontres du troisième type de Spielberg, a communiqué avec des extraterrestres avant que…
Édouard Launet
Quelque chose là-haut







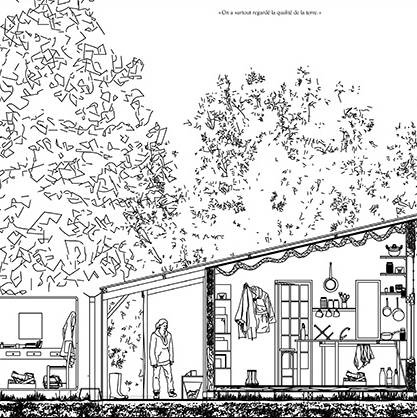

0 commentaires