Le genre idéal est noir. Comme un polar, un thriller, une enquête judiciaire ou un roman naturaliste. Et c’est de l’humain, de la tragédie grecque, du meurtre, en série, passionnel, accidentel, d’État, ordinaire parfois.
“Tobias ne le sait pas encore. Si on est trop près, on ne voit rien.” Ainsi pense un journaliste de faits divers, revenu de nulle part après avoir sombré en hôpital psychiatrique et qui accompagne un novice sur les lieux d’un drame, une vie terminée sur un bout de trottoir sous la lumière en cône d’un lampadaire. Un rond jaune dans le noir, premier et dernier coup de projecteur sur une vie jusque là totalement anonyme et destinée à le redevenir dès le lendemain une fois le journal fermé.
Pourquoi ce corps désarticulé plutôt qu’un autre éveille-t-il une telle empathie chez le professionnel des âmes perdues ? Pourquoi s’arrêter un soir sur le Köln Concert de Keith Jarrett et le réécouter sans cesse jusqu’à en intégrer les notes dans le sommeil ? Recevoir une émotion demeure un mystère. Être bouleversé ne s’explique pas toujours. De la même façon, la laideur en politique qui détermine du destin des personnes, n’avance pas à découvert avec des pustules sur les paupières. Elle peut être habillée comme un cardinal en civil et condamner ensuite les exclus de son troupeau à n’être que des bannis économiques, des subversifs à matraquer, des “pointés du doigt” condamnés à l’errance.
 L’Argentine Eugenia Almeida pose son récit à l’heure de la convalescence crépusculaire d’un pays martyrisé. L’espoir demeure dans le gris. Elle l’écrit, entre autres phrases : “Il existe toujours le risque que quelqu’un arrive et, de façon inattendue, devienne nécessaire.” Y compris dans le chaos, les brumes et les portes fermées d’une ville marquée par les non-dits. Ce quelqu’un est une inconnue de soixante ans dans un café. Une solidarité inattendue proposée dans une hémérothèque. Le courage gratuit d’un anonyme qui déchire une page. Il pourrait y avoir un peu d’Asphalt jungle dans ce roman par ailleurs servi d’une traduction si remarquable qu’elle donne l’illusion de le découvrir dans sa langue première. La poésie du sombre et des cœurs blessés y va de pair avec l’onirisme dans un pays jamais nommé. Cela pourrait être l’Argentine des enfants volés, la France restée après Vichy du côté de sa majorité silencieuse, l’Italie sous tutelle, la Pologne des pogroms refoulés ou l’Amérique post-dictature, mal guérie d’un triomphe des milices. Cela pourrait être une autre forme de Gotham city, les supers héros en moins ; l’équivalent en fiction de l’univers de Sokal où l’inspecteur traîne en imper, clope au bec, ses obsessions suicidaires ; un homme à tête d’animal issu des mêmes zones troubles et dangereuses que ceux qu’il traque, tous issus d’un passé les tirant de son poids vers le fond.
L’Argentine Eugenia Almeida pose son récit à l’heure de la convalescence crépusculaire d’un pays martyrisé. L’espoir demeure dans le gris. Elle l’écrit, entre autres phrases : “Il existe toujours le risque que quelqu’un arrive et, de façon inattendue, devienne nécessaire.” Y compris dans le chaos, les brumes et les portes fermées d’une ville marquée par les non-dits. Ce quelqu’un est une inconnue de soixante ans dans un café. Une solidarité inattendue proposée dans une hémérothèque. Le courage gratuit d’un anonyme qui déchire une page. Il pourrait y avoir un peu d’Asphalt jungle dans ce roman par ailleurs servi d’une traduction si remarquable qu’elle donne l’illusion de le découvrir dans sa langue première. La poésie du sombre et des cœurs blessés y va de pair avec l’onirisme dans un pays jamais nommé. Cela pourrait être l’Argentine des enfants volés, la France restée après Vichy du côté de sa majorité silencieuse, l’Italie sous tutelle, la Pologne des pogroms refoulés ou l’Amérique post-dictature, mal guérie d’un triomphe des milices. Cela pourrait être une autre forme de Gotham city, les supers héros en moins ; l’équivalent en fiction de l’univers de Sokal où l’inspecteur traîne en imper, clope au bec, ses obsessions suicidaires ; un homme à tête d’animal issu des mêmes zones troubles et dangereuses que ceux qu’il traque, tous issus d’un passé les tirant de son poids vers le fond.
Cela pourrait être partout où, de l’histoire des dictatures et des coups tordus, remontent des créatures à la gueule grand ouverte. Comme un avertissement involontaire aux conséquences de l’ordre moral, du recul des égalités et de la tentation de l’autorité pour tous ceux qui, à force d’en manquer, rêvent de s’y soumettre.
Le drame ? Une jeune femme sans passé et sans famille, après avoir braqué un homme à la sortie d’un bar, retourne son arme contre elle et se tire une balle entre les deux seins. Sa cible lui a tourné le dos sans se retourner, ni même accélérer au bruit de la détonation. Personne ne sait. Personne ne parlera. Mieux vaut privilégier la thèse de la violence faite à soi-même en ultime désespoir. La facilité du chagrin d’amour. Le suicide d’une femme.
Guyot, lui, veut comprendre. Plus exactement, cela s’impose. Régulièrement des chapitres scandent sa propre enquête et renseignent sur les forces de l’ombre qui le suivent, comme des fantômes derrière les murs, prêtes à venir le prélever du monde des vivants. Un flic est renversé pour avoir ouvert un dossier. Un autre martyrisé. Une guirlande de morts violentes ajoute régulièrement à son serpent de nouvelles ampoules grillées. Nouveau suicide. Accident de la route. Exécution sommaire. Rixe. Guyot avance vers son propre destin tel un fantôme de lui-même plus fort que les menaces. Plus vivant que n’importe qui dans son refus de la défaite humaine drapée sous les traits de la raison. Si la peur est au centre de tout, elle ne le concerne plus. Ni la crainte physique de la torture, ni l’angoisse du licenciement, ni celle de la disparition ou cette terreur banalisée inscrite dans les subconscients, jusqu’au magma de l’être. Ce n’est même pas du courage. Guyot erre le soir dans l’espoir de finir dans un bar à écouter l’histoire d’un autre, la voix d’un autre, la réponse d’un autre. Pour s’oublier, mais aussi forcer la fin des solitudes.
“Si on est trop près on ne voit rien.” Certes. Et si on est seul, on ne va nulle part. Ne pas laisser tomber. Quitte à remonter le temps, quitte à se confronter au pouvoir quasi surnaturel d’un homme terrorisant les plus durs. Les portraits sont fulgurants. L’auteur convoque l’uchronie, l’enquête, le roman noir et la politique fiction et donne vie au genre idéal dans une maestria propre et nette comme la découpe d’une lame au diamant. Eugenia Almeida laisse passer une lumière féroce. C’est magnifique et glaçant. La fille avait un prénom. Des voix conspirent à l’oubli. Des hommes tombent comme des bibelots des étagères. D’autres, tirés de la vase, sèchent comme des anguilles laissées au soleil. La même impunité demeure pour celui qui ne veut que sa tranquillité et s’arroge un droit de vie et de mort. N’est-ce pas finalement le plus horrible ? Cette facilité de tuer les gens d’une phrase, d’un trait, d’un chiffre, d’une décision ? En laissant à d’autres le soin d’exécuter les ordres.
Lionel Besnier
Le genre idéal
L’Échange, d’Eugenia Almeida, traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry, Métailié, 2016
[print_link]


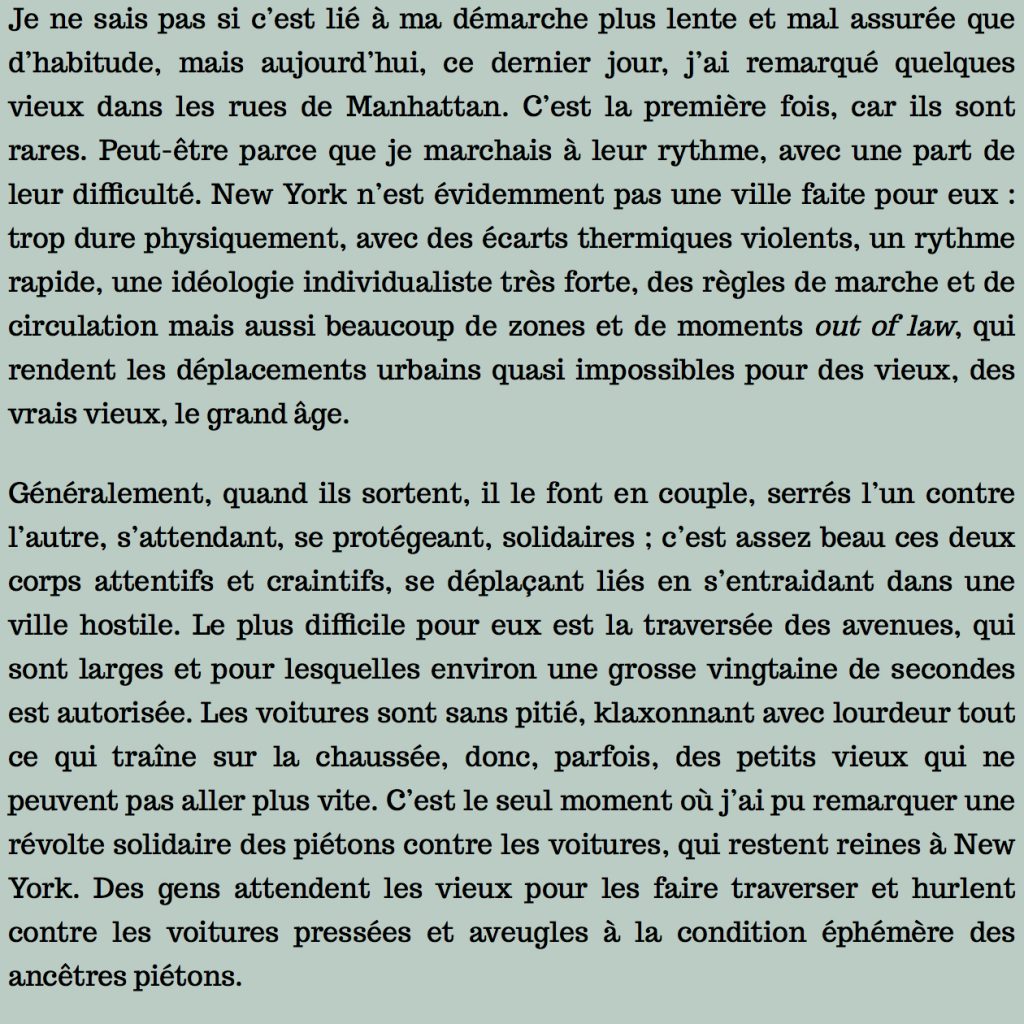





0 commentaires